Comment se construit le prix d'un vêtement ? Pourquoi de telles différences de
Comment se construit le prix d'un vêtement ? Pourquoi de telles différences de prix entre le luxe et le prêt-à-porter ? Plus que les coûts de fabrication, la stratégie des marques s’avère déterminante. Cinq cent soixante-quinze euros. C'est la différence de prix entre un T-shirt d'une marque de prêt-à-porter lambda et un T-shirt trônant dans le rayon d'une boutique ultra luxe. Comment expliquer cet écart considérable ? L'affaire semble simple au premier abord. Tous les acteurs du circuit invoquent un principe : le coût de revient. Celui-ci inclut les constituants physiques et non physiques (coupe, assemblage...) ainsi que les coûts induits par l'approvisionnement en matières premières. Une fois ce montant déterminé, la marque vend le produit deux fois plus cher au revendeur, qui, lui, multipliera le prix par 2,5 environ. Soit un rapport de 1 à 5. Un T-shirt dont le prix de revient serait de 7 euros avoisinerait donc les 35 euros en magasin. Mais la question ne tarde pas à se compliquer. "En réalité, ces marges sont empiriques. Elles sont une base, qui peut évoluer dans un sens ou dans l'autre", explique Patrick Bègue. Ce consultant en management stratégique apprend notamment aux élèves de l'Institut français de la mode à évaluer les prix de leurs futures créations. Le nerf de la guerre, explique-t-il, c'est la marge que décidera de prendre la marque. Selon nos interlocuteurs, c'est là que les chiffres s'affolent, et pas seulement dans le luxe - cette marge se répercutant implacablement sur les étapes suivantes, et donc sur le prix final. Il n'est alors pas rare que le x 2 théorique avoisine le x 10. Le prix de notre T-shirt peut alors atteindre les 100 euros. Le coût de la matière première Pour justifier le prix, la qualité de la fabrication et la noblesse des matières premières sont souvent avancées. Elles sont de moins en moins déterminantes. "Avec l'ouverture à l'international, il n'y a plus de règles", remarque Patrick Bègue, même si, nuance-t-il, le prix de ces matières premières augmente au gré des saisons et en fonction de nombreux facteurs, allant de la catastrophe naturelle à l'influence des marchés émergents, notamment chinois. Un designer de chez Vuitton se souvient : "Après l'ouragan Katrina, la plupart des élevages d'alligators de La Nouvelle-Orléans avaient été détruits, et l'alligator, plus rare, était devenu plus cher que le nautilus ou le porosus, deux espèces plus nobles." Toutes les marques ne sont toutefois pas logées à la même enseigne. Si celles de luxe peuvent parfois se permettre d'absorber les variations des coûts des matières premières, ces augmentations se retrouvent malgré tout, même minorées, sur l'étiquette. Pour les structures modestes, c'est encore plus difficile à gérer. Pauline Brosset, chapelière à son compte depuis deux ans, nous reçoit dans son petit atelier du Marais, à Paris, dont les murs sont couverts de ses créations, la plupart en feutre. Fièrement installée à l'autre extrémité de la chaîne alimentaire de la mode, elle s'insurge : "Depuis 2010, le feutre a pris 30 %. Jusque-là, je ne l'ai pas fait, mais je vais être obligée d'augmenter mes prix, c'est une question de survie !" Les petites marques ne peuvent pas activer le levier de la quantité pour faire baisser le prix de revient et augmenter leur marge. "C'est ce levier qui permet aujourd'hui à des monstres comme Uniqlo de sortir des choses d'une grande qualité à des prix très bas, comme la collaboration avec Jil Sander", explique Patrick Bègue. À l'inverse, lorsque les séries sont très limitées, le prix de revient peut grimper rapidement. Le lieu de fabrication est tout aussi déterminant. "Délocaliser la production peut faire baisser le coût de fabrication, mais cela induit des dépenses de transport, des frais de douanes, de fonctionnement de la plate-forme qui coordonne tout sur place, et réduit la souplesse de la production", soupire le styliste d'une marque qui fabrique en Europe de l'Est, en Asie et au Maghreb. Des marges qui s'envolent Si depuis quelques années on assiste à un retour timide du made in France, c'est loin d'être une règle dans le prêt-à-porter. Le prix en magasin s'en ressent forcément. "Certes nos pièces sortent un peu plus cher que la concurrence qui ne fabrique pas en France, explique Christophe Lepine, cofondateur de la marque Bleu de Paname début 2009, mais on essaie de faire un travail d'éducation de la clientèle sur la qualité : faire bosser l'industrie française est un acte citoyen." "Après tout, la mode est d'abord un fantasme", assène le directeur artistique d'une enseigne de prêt-à-porter française. Dans le secteur du luxe, le fantasme et la quête d'inaccessible se monnaient cher. Une étude menée par l'Institut français de la mode sur les consommateurs français de luxe en 2010 montre que ceux-ci ne placent le prix qu'en sixième position des critères d'achat d'un produit, derrière la qualité, le design ou la noblesse des matériaux. Une attitude dont sont bien conscientes les marques de luxe qui en abusent parfois. Résultat : les marges s'envolent. Comme chez Louis Vuitton dont les sacs en toile monogrammée sont des incontournables. "Cette toile, on doit en acheter des kilomètres tous les ans, et les coûts de développement sur ces modèles sont réduits au minimum, donc la marge est bien plus importante", raconte le designer maison. Mais, paradoxalement, les prix des produits de luxe sont dans leur majorité soumis à des marges similaires à celles qui régissent le reste de l'industrie. Concrètement, la marge sur un T-shirt à 20 euros peut être plus importante que celle d'un sac à 4 000 euros. "La vraie spécificité du luxe, c'est la valeur ajoutée immatérielle de ses produits", explique Patrick Bègue. Acheter un Speedy chez Vuitton ou un Chanel 2.55, au-delà de s'acheter un joli sac, c'est afficher à son bras l'étendard de la maison et dans le même temps intégrer un cercle d'initiés. "On a dû augmenter certains prix dans un souci de cohérence" Ces variations des marges au sein d'une collection ne sont pas l'apanage des maisons de luxe. Chez Lacoste Live, la ligne bis de la marque au crocodile, c'est sur le polo que l'avantage est pris. "La marge sur les polos nous permet de faire des tests sur d'autres pièces de la collection, avec des matières plus pointues, précise un des créatifs de la ligne, c'est une sorte de péréquation à l'échelle de la collection." Christophe Lepine ne dit pas autre chose : "Il arrive qu'on marge moins sur des produits précis, mais là où il ne faut pas se louper et où la marge doit être conséquente, parce que c'est ce qui va nous permettre de manger à la fin du mois, c'est sur les 20/80." Sous-entendu, les 20 % de la collection censés représenter 80 % du bénéfice, selon le principe empirique énoncé par l'économiste Pareto. "On a dû augmenter certains prix dans un souci de cohérence de collection. On ne pouvait pas vendre un jean 80 euros et une chemise 130", confie une ancienne cadre d'APC, présente le jour où l'augmentation du prix de la pièce qui a fait le succès de la marque a été décidée. À 135 euros, le jean brut fait toujours un carton. "Le bon prix, c'est la parfaite rencontre entre un calcul strict des coûts et le prix psychologique d'un marché, et si le curseur est trop proche de l'un ou de l'autre, cela peut se retourner contre la marque", résume Patrick Bègue. Une fois le coût de revient évalué, c'est le positionnement de la marque sur un créneau de prix qui détermine celui de vente au distributeur. Opacité vs transparence Dans ce contexte d'opacité des prix, certaines marques ont décidé de miser sur la transparence et l'éthique. Sébastien Kopp a cofondé Veja en 2005 : "Le parti pris était de faire des baskets en respectant l'environnement, y compris humain, et de les vendre à un prix raisonnable, sans que la communication soit surreprésentée, comme c'est trop souvent le cas." Production au Brésil dans une usine aux conditions de travail décentes, contribution à la reforestation, collaboration avec des centres de réinsertion sociale à plusieurs étapes du processus : une basket coûte trois ou quatre fois plus cher que celle produite dans des conditions lamentables en Indonésie ou au Bangladesh. "On se rattrape en faisant très peu de publicité", explique le patron de la marque. Sans stigmatiser les concurrents ni culpabiliser le client, Veja veut proposer "une alternative plus saine et plus transparente". Dans la même veine, le créateur Bruno Pieters, ancien designer chez Hugo Boss, a souhaité tout remettre à plat avec Honest by. Ce site de vente en ligne accueille ses créations et celles d'autres créateurs à la condition que tout, de la provenance à la composition, soit mentionné sur la page du produit. Une note détaille même le calcul de son prix de revient et les marges appliquées par le site. Ce genre d'initiative est salué de toutes parts, mais la grande majorité des marques continuent à n'indiquer que le prix final sur l'étiquette. Gino Delmas uploads/Marketing/ comment-se-calcule-le-prix-d-x27-un-vetement.pdf
Documents similaires

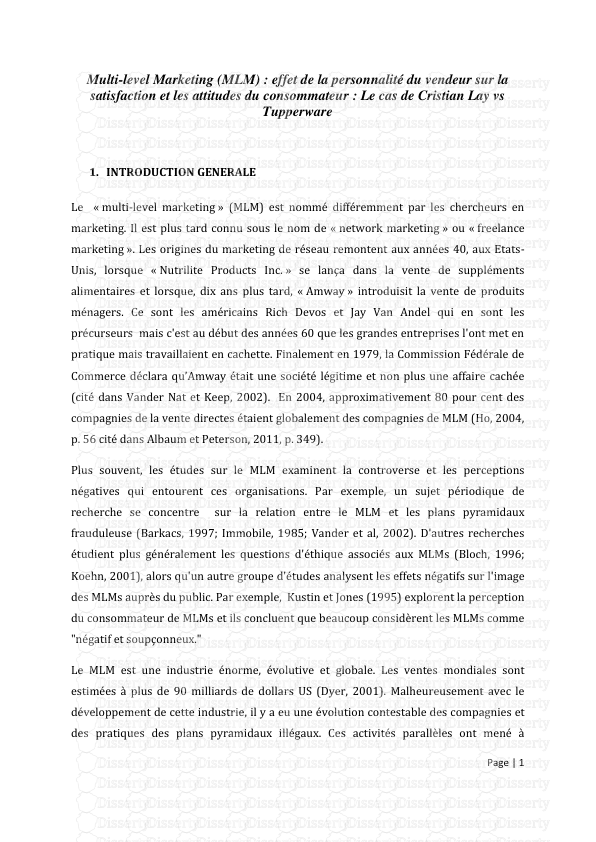








-
65
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 04, 2023
- Catégorie Marketing
- Langue French
- Taille du fichier 0.1060MB


