MIROIRS D'ENCRE rise à faire l'économie d'une traduction du spatial en narratif
MIROIRS D'ENCRE rise à faire l'économie d'une traduction du spatial en narratif qui, en tout état de cause, ne saurait être qu'un tissu de contresens. La topique de l'autoportrait, sa structure mnémonique et encyclopédique, les procédés de son invention, ne peuvent se dire qu'en termes d'espace, et c'est là ce qui fonde leur paradoxale modernité, comme le suggère Gérard Genette : Aujourd'hui, la littérature — la pensée — ne se dit plus qu'en termes de distance, d'horizon, d'univers, de paysage, de lieu, de site, de chemins et de demeure : figures naïves, mais caractéristiques, figures par excel- lence, où le langage s'espace afin que l'espace en lui, devenu langage, se parle et s'écrive '. Cet « espace » linguistique est certes celui de l'écriture, et celui qui se dit depuis l'Antiquité à travers la comparaison stéréotypée de la mémoire locale avec les tablettes de cire. Mais c'est surtout celui du livre, et particulièrement celui du livre typographique, qui permet la fixation permanente du texte, ou sa modification délibérée, au long d'éditions successives, par addition, suppression et auto-référence : les Adages d'Erasme aux multiples éditions sont sans doute le modèle, à l'aube de la typographie, de cette mise en scène du devenir dans l'es pace livresque. Les Essais de Montaigne nous en offrent un exemple plus familier et pertinent. Les Essais thématisent manifestement une amnésie et un rejet de la mémoire du savoir appris par coeur, de la mnémotechnie que la typographie a en effet rendus caduques. Ce rejet est compensé, dans les Essais, par la mise en place d'une « mémoire du livre », inhérente à sa disposition topique (non narrative), à sa malléabilité et à son unicité, puisque Montaigne a choisi de réviser obstinément un seul livre, plutôt que de produire une multiplicité d'opuscules comme il était courant de le faire à l'époque scribale2. Dans les Essais, l'écriture engendre sa propre mémoire, du fait qu'elle met en scène au cours d'éditions successives ses retouches, ses repentirs et ses ajouts, au point qu'on peut dire sans calembour que le livre de Montaigne introduit une variante livresque et typographique de la memoria sui augustinienne. 1. Gérard Genette, Figures, p. 108. 2. Il existe de curieux contre-exemples postérieurs : Torres Villarroel en Espagne au XVIII' siècle (voir : Guy Mercadier, Diego de Torres Villarroel, Masques et miroirs), et tout récemment en France : Roger Laporte. 2. La mémoire intratextuelle LES ESSAIS DE MONTAIGNE On ne peut donc manquer d'être frappé, en lisant les Essais de Mon- taigne, par l'abondance des remarques relatives à la mémoire. Ces énon- cés peuvent, à première vue, se répartir en deux catégories : les uns déplorent, ou du moins affirment, l'exceptionnelle amnésie de l'auto- portraitiste, tandis que d'autres opposent brutalement deux facultés qui, à la Renaissance, étaient habituellement envisagées dans une relation de complémentarité : le jugement et la mémoire. Cette opposition se résume, selon une lecture scolaire des Essais, dans le jugement de valeur où « la tête bien faite » l'emporte sur « la tête bien pleine » '. Quelle est donc la fonction, dans les Essais (plutôt que dans la « vie » de Montaigne ou dans sa réflexion pédagogique), d'un désaveu de la mémoire qu'on est tenté de dire systématique, ou du moins symptoma- tique. Dans son grand livre, Hugo Friedrich va droit à l'essentiel : « S'il affirme si souvent qu'il n'a pas de mémoire, ce n'est pas seulement une botte contre les pédants et leur science matérielle. C'est aussi une façon de répudier la rhétorique » (351). Friedrich place d'ailleurs cette remarque sur la mémoire dans le contexte de son analyse de la compo- sition et du style des Essais, qu'il rattache à la « forme ouverte » de Yordo neglectus. Ainsi les Essais transgresseraient-ils simultanément, et corrélative ment, trois des parties (ou « offices ») de la rhétorique : inventio, dispo- sitio et memoria, ce qui entraînerait, par contrecoup, la libération (Telocutio, c'est-à-dire du style. Après ce coup d'État, il ne reste plus grand-chose de la rhétorique traditionnelle dans les Essais. Peut-on 1. Parmi les critiques récents qui ont étudié le statut de la mémoire dans les Essais, il faut citer : Hugo Friedrich, Montaigne, p. 351; S. John Holyoake, « Montaigne's attitude to memory »; et Alfred Glauser, Montaigne paradoxal, p. 98 99. Il faut y ajouter le bel essai de Michel Charles qui recoupe certaines des observations faites ici : « Bibliothèques ». 113 MIROIRS D ENCRE cependant s'en tenir à une opposition entre rhétorique et liberté, entre préméditation et spontanéité? Examinons le commentaire de Friedrich : La mémoire (artificielle) reproduit le discours dans l'ordre de son plan et subit donc une contrainte. Dès lors, on comprend que Montaigne, aimant la liberté, trouve un argument de plus en faveur de la forme ouverte dans son refus d'un ordre prémédité, obligé de s'appuyer sur la mémoire : il y perdrait la fécondité de l'instantané, l'impulsion pre- mière de ses écrits (351). Friedrich fonde donc son argumentation sur une motivation psycho logique et extratextuelle : « ... Montaigne, aimant la liberté... » Mais il y a plus : dans la mesure où il oppose la contrainte de la mémoire (qui fixe l'invention et la composition) à la féconde spontanéité de la forme ouverte, Friedrich reste pris dans un discours dont le « terrorisme » (au sens de Jean Paulhan) est quelque peu anachronique lorsqu'il s'agit de Montaigne. Ce « terrorisme » fondé sur une idéologie de la spontanéité et de l'expressivité est d'autant plus inadéquat qu'il projette sur les Essais une ontologie du sujet qui leur est postérieure, ou étrangère. Il est vrai que ce qui relève de la mémoire artificielle et implique un effort, une technique de la remémoration, semble en quelque sorte étranger au sujet de renonciation spontanée. La mémoire, trésor de l'in- vention, ne lui appartient pas en propre, ne fait pas partie de ses pro- priétés, de ses prédicats, tandis que le jugement est une activité propre qui ne fait jamais défaut à moins que le sujet ne sombre dans l'in- conscience. Montaigne détaille cette opposition en II, XVII (a) : C'est le réceptacle et l'estuy de la science que la mémoire : l'ayant si défaillante, je n'ay pas fort à me plaindre, si ne je sçay guiere. Je sçay en gênerai le nom des arts et ce dequoy elles traitent, mais rien au-delà. Je feuillette les livres, je ne les estudie pas : ce qui m'en demeure, c'est chose que je ne reconnois plus estre d'autruy; c'est cela seulement dequoy mon jugement a faict son profict, les discours et les imagina- tions dequoy il s'est imbu; l'autheur, le lieu, les mots et les autres cir- constances, je les oublie incontinent (635). Dédain aristocratique envers ce qu'il y a d'encore besogneux et ser- vile dans les arts libéraux, et mépris pour les marques extérieures de l'érudition : sources, références, citations, etc. Plus intéressante est l'opposition nettement marquée entre Yétranger (le savoir livresque, par exemple), ce qui est le fait et reste la propriété d'autrui, et ce dont mon jugement s'est imbu. Ici, comme ailleurs dans les Essais, les efforts et les artifices de la mémoire volontaire sont bannis parce qu'ils creusent une « distance intérieure » et une différence entre l'invention propre et la citation empruntée, entre le texte et l'intertexte, ce dernier LA MEMOIRE INTRATEXTUELLE ne gagnant droit de cité que par la naturalisation et l'oubli de son origine étrangère. En somme, l'effort de « mémoire », et ce qui en conserve la trace dans le texte, dérobe au sujet et à son énoncé leur présence à soi dans renonciation. Dans la remémoration volontaire (a fortiori, dans la mise en œuvre d'une mémoire artificielle et d'une invention méthodique) mon passé, les discours que j'ai tenus et retenus et mes propres écrits antérieurs me deviennent aussi étrangers que les textes d'autrui : dans les Essais, du moins dans le passage cité, le propre ou, ce qui revient au même, Yapproprié (ce qui est entré en faisant corps) et le présent de renonciation sont seuls valorisés. Non pas que Montaigne nie la possibilité d'un retour soudain et contraignant du passé et de l'étranger; mais ce retour — incontrôlé, tyrannique — dérobe au sujet présent sa présence à lui-même et au monde, interposant entre les instances conscientes et la conscience de soi-même au monde (dans l'écriture par exemple) le surgissement d'une instance biologique ou psychique non consciente dont les manifestations revêtent la consistance hystérique de ce que Montaigne appelle, toujours péjorativement, Vimagination. L'effort, en particulier l'effort de remémoration, dissipe lui aussi l'euphorie de la présence à soi dans l'écriture, rompt le charme et tarit l'écriture. Albert Thibaudet a bien saisi le statut de cet effort chez Montaigne : « Tout ce qui est effort est chez lui frappé de déchéance, vient mal ' » et il cite à l'appui : « Je fuis le commandement, l'obligation et la contrainte. Ce que je fais ayséement et naturellement, si je m'or- donne de le faire par une expresse et prescrite uploads/Litterature/ beaujour-miroirs-d-x27-encre-montaigne.pdf
Documents similaires


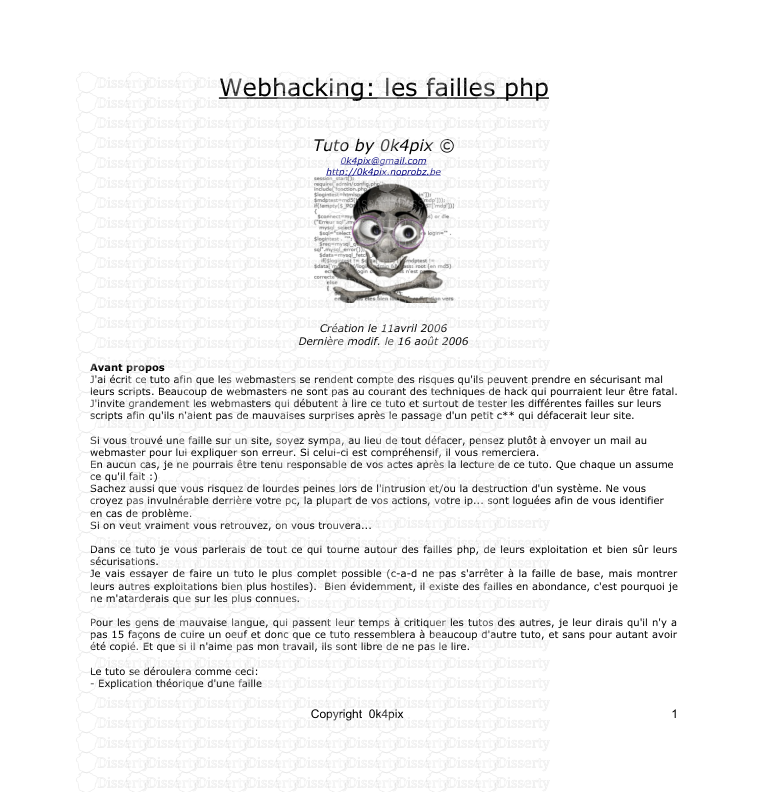







-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 18, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2034MB


