1 FICHE N° 1 : LA DUALITE JURIDICTIONNELLE I. ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE - Dossi
1 FICHE N° 1 : LA DUALITE JURIDICTIONNELLE I. ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE - Dossier « La dualité de juridiction lors du bicentenaire de la loi des 16-24 août 1790 », RFDA, 1990, p. 687 ; - Dossier « Débats sur l’avenir du dualisme juridictionnel », AJDA, 2005, p. 1760 ; - Dossier « La réforme du Conseil d’État », RFDA, 2008, p. 213 ; - Dossier « Conseil d’État fonction consultative et fonction contentieuse », RFDA, 2009, p. 885 ; - AGUILA Y., « La justice administrative, un modèle majoritaire en Europe », AJDA, 2007, p. 290 ; - GALLET J.-L., Rapport sur la réforme du Tribunal des conflits, AJDA, 2013, p. 2130 ; - JORAT M., « Supprimer la justice administrative … deux siècles de débats », RFDA, 2008, p. 456 ; - MASSOT J., « La répartition du contentieux entre les deux ordres », RFDA, 2010, p. 907 ; - PACTEAU B., « Vicissitudes (et vérification … ?) de l’adage « juger l’administration, c’est encore administrer » », Mélanges en l’honneur de Franck MODERNE, Dalloz, 2004, p. 317 ; - TRUCHET D., « Fusionner les juridictions administrative et judiciaire ? », Etudes offertes à Jean-Marie AUBY, Dalloz, 1992, p. 335 II. DOCUMENTS Le principe de dualité juridictionnelle Doc. 1 : Art. 13 de la loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III Doc. 2 : Cons. const., 22 juillet 1980, Loi de validation, GDCC, 15e éd., 2009, n° 21 Doc. 3 : Cons. const., 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, GAJA, 19e éd., 2013, n° 104, p. 794 La voie de fait Doc. 4 : CE Ord., 23 janvier 2013, Commune de Chirongui (v. la note de P. DELVOLVE, « Référé- liberté et voie de fait », RFDA, 2013, p. 299) Doc. 5 : T. confl., 17 juin 2013, Bergoend c/ ERDF Annecy Léman (v. la note de P. DELVOLVE, « Voie de fait : limitation et fondements », RFDA, 2013, p. 1041) L’emprise irrégulière Doc. 6 : T. confl., 9 décembre 2013, M. et Mme Panizzon c. Commune de Saint-Palais-sur-Mer (v. la note de P. DELVOLVE, « De la voie de fait à l’emprise : nouvelle réduction de la compétence judiciaire », RFDA, 2014, p. 61) Les conséquences de la dualité juridictionnelle Doc. 7 : T. confl., 30 juin 2008, Époux Bernardet (v. la note de B. SEILLER, « Pour quelques ajustements de la mécanique du dualisme juridictionnel », RFDA, 2008, p. 1172) Doc. 8 : Cour européenne des droits de l’homme, 18 novembre 2010, Claude Baudoin Doc. 9 : Cons. const., 26 novembre 2010, Mlle Danielle S., n° 2010-71 QPC Doc. 10 : Art. L. 3216-1 du Code de la santé publique (v. l’article de A. PENA, « Internement psychiatrique, liberté individuelle et dualisme juridictionnel : la nouvelle donne », RFDA, 2011, p. 951) Les questions préjudicielles entre juridiction administrative et juridiction judiciaire Voir : CE Sect., 17 octobre 2003, Bompard, GACA, 2e éd., 2009, n° 9 Doc. 11 : T. confl., 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c/ INAPORC, GAJA, 19e éd., 2013, n° 117, p. 956 Doc. 12 : CE, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux (v. la note de E. MARC, « L’application inversée et étendue de la jurisprudence SCEA du Chéneau », AJDA, 2012, p. 1583) Doc. 13 : Cass. civ. 1, 24 mars 2013, n° 12-18.180 (v. la note de J.-D. DREYFUS, « L’application par le juge judiciaire de la “jurisprudence établie” du juge administratif », AJDA, 2013, p. 1630) 2 Doc. 1 : Art. 13 de la loi des 16-24 août 1790 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Décret du 16 fructidor an III : Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelqu’espèce qu’ils soient, aux peines de droit. Doc. 2 : Cons. const., 22 juillet 1980, Loi de validation 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ; 7. Mais considérant que ces principes de valeur constitutionnelle ne s'opposent pas à ce que, dans l'exercice de sa compétence et au besoin, sauf en matière pénale, par la voie de dispositions rétroactives, le législateur modifie les règles que le juge a mission d'appliquer ; qu'ainsi le fait que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel intervient dans une matière ayant donné lieu à des recours actuellement pendants n'est pas de nature à faire regarder cette loi comme non conforme à la Constitution ; Doc. 3 : Cons. const., 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence - SUR LE TRANSFERT A LA JURIDICTION JUDICIAIRE DU CONTROLE DES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE : 15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles- mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ; 16. Considérant cependant que, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ; 17. Considérant que, si le conseil de la concurrence, organisme administratif, est appelé à jouer un rôle important dans l'application de certaines règles relatives au droit de la concurrence, il n'en demeure pas moins que le juge pénal participe également à la répression des pratiques anticoncurrentielles sans préjudice de celle d'autres infractions intéressant le droit de la concurrence ; qu'à des titres divers le juge civil ou commercial est appelé à connaître d'actions en responsabilité ou en nullité fondées sur le droit de la concurrence ; que la loi présentement examinée tend à unifier sous l'autorité de la cour de cassation l'ensemble de ce contentieux spécifique et ainsi à éviter ou à supprimer des divergences qui pourraient apparaître dans l'application et dans l'interprétation du droit de la concurrence ; 18. Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle, justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice, ne méconnaît pas le principe fondamental ci-dessus analysé tel qu'il est reconnu par les lois de la République ; 19. Mais considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel a pour effet de priver les justiciables d'une des garanties essentielles à leur défense ; 20. Considérant en effet que le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que le recours formé contre une décision du conseil de la concurrence "n'est pas suspensif" ; que cette disposition n'aurait pas fait obstacle à ce que, 3 conformément à l'article 48 de l'ordonnance n° 45- 1708 du 31 juillet 1945 et au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, le Conseil d'État pût, à la demande du requérant, accorder un sursis à l'exécution de la décision attaquée si son exécution risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissaient sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; 21. Considérant au contraire, que la cour d'appel de Paris, substituée par la loi présentement examinée au Conseil d'État, saisie d'un recours contre une décision du conseil de la concurrence, ne pourrait prononcer aucune mesure de sursis à exécution ; qu'en effet, la loi a laissé subsister dans son intégralité le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'a pas donné à la cour d'appel le pouvoir de différer l'exécution d'une décision de uploads/S4/ fiche-1-la-dualite-juridictionnelle-2014-2015.pdf
Documents similaires

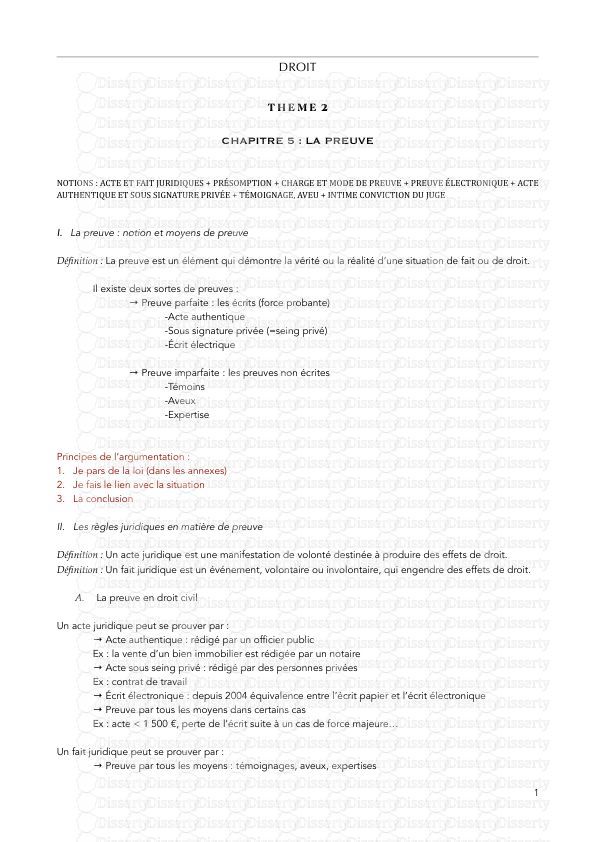








-
109
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3348MB


