Droit international public 2017-2018 Olivier CORTEN et François DUBUISSON DROI-
Droit international public 2017-2018 Olivier CORTEN et François DUBUISSON DROI-C4001 2 Table des matières 1. L’ordre juridique international .......................................................................................... 4 A. Qu’est-ce que le droit international ? Une perspective historique ................................................................. 5 B. Le droit international est-il du « droit » ? ....................................................................................................... 9 C. Qui peut et comment doit-on interpréter le droit international ? .................................................................. 12 D. Discussion : C.I.J., Avis consultatif sur les Armes nucléaires ..................................................................... 14 2. La création de l’État .......................................................................................................... 16 A. Les éléments constitutifs de l’État, une question de fait ? ........................................................................... 16 B. L’existence de l’État, une question de droit ? .............................................................................................. 18 C. La reconnaissance d’État.............................................................................................................................. 22 D. La succession d’États ................................................................................................................................... 23 E. Discussion : C.I.J., Avis consultatif sur l’Indépendance du Kosovo ............................................................ 24 3. Les frontières de l’État ...................................................................................................... 26 A. L’accord comme critère fondamental de délimitation : la relativité de la frontière ..................................... 26 B. Cas de la succession d’États : le principe général de l’uti possidetis comme substitut à l’accord ............... 28 C. Le cas de la mer et de l’espace extra-atmosphérique : « patrimoine commun de l’humanité » ? ................ 31 D. Discussion : C.I.J., Affaire du Différend territorial Libye/Tchad ................................................................ 34 4. L’exercice de la souveraineté............................................................................................. 35 A. Une souveraineté encadrée par l’ordre juridique international : un paradoxe ? ........................................... 35 B. Les compétences nationales des États confrontées aux impératifs de la coopération .................................. 36 C. Le principe de non-intervention : une limite générale à l’exercice par les États de leur souveraineté ? ...... 38 D. Des limites spécifiques : immunités, entre aspiration universaliste et consécration du pouvoir des États... 41 E. Discussion : C.I.J., Affaires des Immunités juridictionnelles All./Italie ....................................................... 44 5. Les organisations internationales ..................................................................................... 46 A. La définition et la personnalité juridique de l’organisation internationale : institution propre ? ................. 46 B. Les compétences de l’organisation internationale : attribution par les États ou pouvoirs autonomes ? ....... 51 C. L’ONU, incarnation de la « communauté internationale » ? ........................................................................ 52 D. Discussion : C.I.J., Affaire Lockerbie .......................................................................................................... 56 6. Les personnes privées ......................................................................................................... 58 A. Le développement des droits de la personne : portée et limites de l’universalité ........................................ 58 B. Les mécanismes de mise en œuvre : au-delà de l’État ? .............................................................................. 62 C. Le développement des obligations pour les individus : un droit de la « communauté internationale » ? .... 65 D. Discussion : C.E.D.H., Affaire Issaïeva ...................................................................................................... 69 7. La coutume .......................................................................................................................... 70 A. La place de la coutume dans le système des sources : approches volontariste et objectiviste ..................... 70 B. Les éléments constitutifs de la coutume : comment un fait peut-il se transformer en droit ? ...................... 74 C. L’évolution de la coutume : les paradoxes d’une source à la fois dynamique et stabilisatrice .................... 77 D. Discussion : C.I.J., Affaire des Activités militaires au Nicaragua ............................................................... 78 3 8. Les traités ............................................................................................................................ 80 A. La définition et la validité des traités : l’accord, une construction ? ............................................................ 80 B. Les conditions de naissance, d’extinction ou de suspension des obligations conventionnelles ................... 85 C. Le principe de relativité des traités et ses limites ......................................................................................... 88 D. Discussion : C.D.H.N.U., Affaire Rawle Kennedy ...................................................................................... 91 9. Les autres sources ............................................................................................................... 92 A. Les engagements unilatéraux ....................................................................................................................... 92 B. Les actes obligatoires des organisations internationales .............................................................................. 97 C. Les principes généraux de droit : une source autonome ? ............................................................................ 99 D. La jurisprudence et la doctrine : moyens auxiliaires de détermination du droit ? ...................................... 101 E. Discussion : C.I.J., Affaire des Activités armées au Congo c. Rwanda...................................................... 104 10. Le droit international et la guerre ................................................................................ 106 A. La portée de l’interdiction du recours à la force : jus contra bellum ou jus ad bellum ? ........................... 106 B. La légitime défense, un « droit naturel » ? ................................................................................................. 111 C. Le droit des conflits armés (jus in bello) : peut-on humaniser la guerre ? ................................................. 115 D. Discussion : C.I.J., Affaire des Activités armées au Congo c. Ouganda ................................................... 119 11. La responsabilité internationale ................................................................................... 120 A. Les difficultés liées à l’attribution du comportement d’un État ................................................................. 120 B. Les « circonstances excluant l’illicéité » : une consécration du réalisme ? ................................................ 124 C. La mise en œuvre aléatoire de la responsabilité internationale .................................................................. 127 D. La responsabilité limitée des organisations internationales ....................................................................... 130 E. Discussion : C.I.J., Affaire du Personnel diplomatique et consulaire ........................................................ 131 12. Règlement pacifique des différends .............................................................................. 133 A. Un principe juridique autonome ? .............................................................................................................. 133 B. Un droit souverain : un libre choix entre les divers moyens pacifiques de règlement ?............................. 135 C. Une limitation par le droit ? La Cour internationale de Justice comme juridiction universelle ................. 136 D. Le développement des modes juridictionnels de règlement : une fragmentation du droit international ? . 141 E. Discussion : Affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force ............................................................... 142 4 1. L’ordre juridique international L’hymne de L’Internationale diffusé au cours prône dans ses paroles un droit universel, déterminé par les valeurs. Cependant, ce projet idéaliste fait face à une réalité tout autre, celle d’une loi qui triche et d’un droit favorable aux riches. Ainsi, une tension s’exerce entre un pôle éthique universaliste en faveur d’un droit du genre humain et un pôle politique qui fait primer sur le terrain les intérêts des États et leurs droits nationaux. C’est à travers cette tension que le droit international tente de trouver un juste milieu : aveuglé par l’éthique, la naïveté et la déconnexion de la réalité le menacent, tandis que l’autre extrême le ferait tomber dans le cynisme d’une réalité inamovible. L’extrait diffusé du film Le pont de la rivière Kwai (David Lean, 1957) constitue une autre illustration de cette opposition, lorsque les « lois du monde civilisé » défendues par le colonel britannique font face au code d’honneur brandi par son homologue japonais. Pôle éthique Pôle politique Universalisme Particularisme Droit providence Droit libéral Utopiste Apologétique Idéaliste Réaliste Le pôle éthique est celui d’une morale et d’un droit universels représentant la justice et appliqués uniformément dans le monde, tandis que le pôle politique considère que le droit international est confronté et soumis aux contingences et aux rapports de force. Le conflit entre universalisme et particularisme est visible notamment dans la Déclaration des droits de l’Homme qui, si elle se veut universelle, n’a pas été ratifiée par tous les pays et subit en quelque sorte le particularisme de ceux-ci. Le droit international est un droit providence en ce sens qu’il est destiné à développer des valeurs universelles mais il est également un droit libéral centré sur la coexistence puisqu’il renonce à imposer un modèle unique aux États, ceux-ci ayant des conceptions différentes de la justice. L’universalisation de la justice constitue un projet utopiste mais le fait de résumer le droit à la volonté des États est un autre extrême apologétique qui ne donne plus de limites à leur éventuel pouvoir. La tension entre idéalisme et réalisme interroge la capacité du droit international à améliorer les relations internationales. L’optique idéaliste encourage les conventions, traités, etc. tandis que le réalisme au sens théorique rappelle que les États ne respecteront le droit international que s’ils y retrouvent leur propre intérêt. 5 A. Qu’est-ce que le droit international ? Une perspective historique Il est important de noter que si chaque période est marquée par une tendance dominante vers le pôle éthique ou le pôle politique, aucune des deux philosophies n’est jamais totalement occultée par l’autre. Aussi, cette histoire du droit international n’adhère pas aux théories évolutionnistes selon lesquelles l’évolution vers un idéal (et donc vers le triomphe du droit international) est inexorable. I. Le droit international classique doctrinal (15e-16e) : droit mondial, chrétienté et papauté Le monde du 15e siècle est un monde d’États en construction dominé par l’Espagne et le Portugal. Il n’y a alors pas lieu de parler de droit international car la seule règle qui s’applique est celle de la Bible. En effet, les références bibliques sont caractéristiques de la période et témoignent de son caractère éthique : il s’agit d’interpréter la parole de Dieu pour aboutir à des règles, comme l’illustrent les réflexions théologiques de Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, Relectiones Theologicae, 1557, pp. 429-430. « Il y a une et une seule juste cause qui permet de déclencher une guerre : un dommage subi. Cela découle d’abord de l’autorité de Saint- Augustin (Liber 83 Quaestionum, …) mais aussi de celle de Saint-Thomas (Secunda Secundae, qu. 40, art. I) ainsi que de l’opinion de tous les autres penseurs… Il ne peut y avoir de vengeance s’il n’y a pas de faute et de dommage préalables… Il est donc clair que nous ne pouvons tourner notre épée contre ceux qui ne nous blessent pas, le massacre d’innocents étant interdit par le droit naturel. Je réserve ici tout ordre contraire que Dieu pourrait donner dans un cas particulier, car Il est le Maître de la vie et de la mort et Il est de Sa compétence d’édicter toute règle ou décision qu’Il jugerait uploads/S4/ droit-international-public-2017-2018-pdf.pdf
Documents similaires


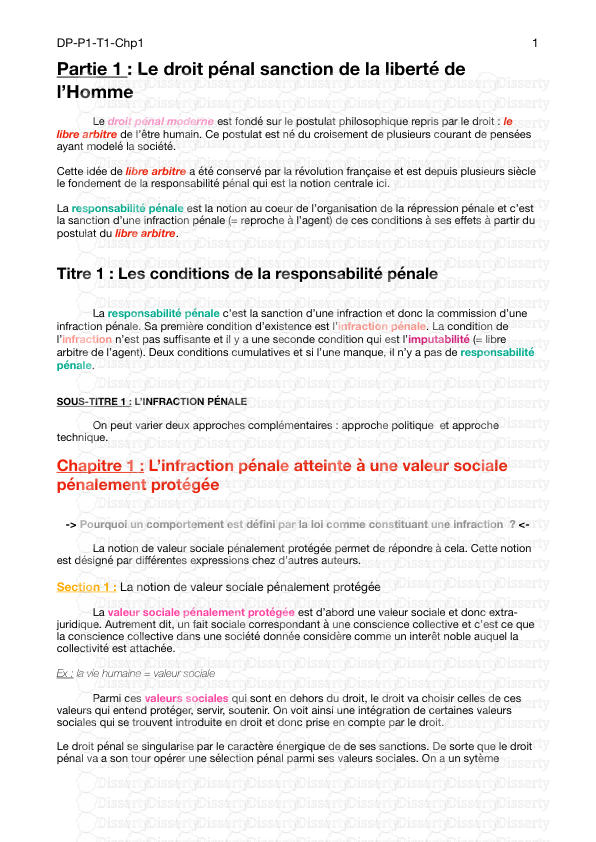







-
23
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 03, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.7527MB


