PPROGRAMME DES TRAVAUX DIRIGÉS Thème 1 : Questions de méthode Méthode personnel
PPROGRAMME DES TRAVAUX DIRIGÉS Thème 1 : Questions de méthode Méthode personnelle de travail : assimilation des connaissances, préparation des fiches, entraînement à l’examen. Méthode du chargé de travaux dirigés. La lecture de décisions juridictionnelles comme pré-requis. Travaux à partir des règles de méthode de la fiche 1 et d’éléments de contenu de la fiche 2 ou de la fiche 3. Thème 2 : La juridiction administrative Les juridictions. Notions quantitatives. Accès. Recours au fond. Sursis à exécution. Thème 3 : La compétence juridictionnelle : régime de principe, régimes dérogatoires Le principe de répartition des compétences. Questions préalables et questions préjudicielles. Cas des dommages de travaux publics. Dommages causés par les véhicules. Emprise. Voie de fait. Art. 136 C. Pr. Pén. Attroupements. Fautes de surveillance dans les établissements d’enseignement. Recherche biomédicale. Thème 4 : Les sources de la légalité Normes constitutionnelles. Conventions internationales. Lois. Principes généraux du droit. Clauses contractuelles ? Thème 5 : La sanction du principe de légalité : l’illégalité de l’acte Formes de l’illégalité, nature et degré du contrôle juridictionnel. Thème 6 : La notion de service public Identification. SPA et SPIC. Principes de fonctionnement du service public Thème 7 : Le pouvoir réglementaire Le pouvoir réglementaire général. Le pouvoir réglementaire des ministres, des autorités administratives indépendantes, des collectivités territoriales. Thème 8 : La police administrative Les différentes polices administratives. Le contrôle juridictionnel des pouvoirs de police. L’obligation d’exercer les pouvoirs de police. Cours de droit administratif INTRODUCTION : Sous chapitre 1 er : Définition : Weil : « le droit administratif français relève du miracle ». L’administration qui a des prérogatives de puissance publique voit son activité limitée par le droit et surtout par le principe d’égalité. Cette limitation de l’administration est une garantie du citoyen contre l’arbitraire administratif. L’administration qui ne serait pas limitée par le droit pourrait être injuste. Il faut également que des juridictions viennent appliquer ce principe de légalité pour obliger l’administration a respecter les droits fondamentaux du citoyen et à condamner l’administration quand elle a fait une faute. Section 1 : Caractère du droit administratif : C’est un droit du déséquilibre, c’est également un droit non écrit c’est à dire marqué par la jurisprudence. I) Un droit déséquilibré : Le droit administratif s’applique a des rapports sociaux déséquilibrés : d’un côté une personne privée, de l’autre l’administration. Il y a des choses qui ne sont pas comme dans le droit privé car si en droit privé c’est l’individuel qui est pris en compte, en droit administratif on prend en compte l’intérêt général, collectif. Cela entraîne un droit différent du droit privé. Quand un particulier est débiteur d’un autre particulier, c’est le juge judiciaire qui est compétent et les 2 parties seront égalitaires. En droit administratif, l’administration pour satisfaire l’intérêt général dispose de procédures différentes du droit privé. Le juge administratif est là pour limiter le abus de pouvoir de l’administration, obligeant celle-ci a respecter la C, les lois ou les règlements. II) Un droit non écrit : Un droit écrit c’est un droit fixé et explicité par un organe habilité à créer le droit. Ca peut être le législateur ou le gouvernement qui a un pouvoir réglementaire. Les lois et règlements existent en droit administratif mais ils sont moins nombreux qu’en droit privé et la jurisprudence joue un rôle fondamental dans la création du droit. La jurisprudence est faite surtout par le conseil d’Etat (plus petite juridiction administrative) qui rends des arrêts. Le juge administratif interprète différemment la règle de droit car il devra adapter cette règle aux différentes espèces qui lui sont soumises et souvent l’imprécision de la loi devra être complétée par la jurisprudence du conseil d’Etat. Section 2 : Le droit administratif c’est tout d’abord un droit qui intervient et régit l’organisation de l’Etat dans le domaine administratif. L’Etat central c'est-à-dire le statut du président, du 1er ministre et du gouvernement sont des autorités politiques mais également des autorités administratives. Le droit administratif c’est également l’étude des services déconcentrés de l’Etat c'est-à-dire le statut des organes de l’Etat placé dans les régions, départements, communes qui agissent au nom de l’Etat. Le droit administratif c’est également l’étude des établissements publiques c'est-à-dire ceux qui ont la personnalité morale de droit public, qui disposent de moyens d’administration propres et qui ont un budget propre, qui ont une certaine autonomie ; bien que celle-ci est plus ou moins grande en fonction des textes de lois régissant le statut. L’objet du droit administratif c’est également l’étude des moyens par lesquels l’administration agit. Elle peut agir de deux façons : - par le biais de l’acte unilatéral : autorité de l’administration - par la voie contractuelle car l’administration passe des contrats avec des entreprises privées ou avec d’autres administrations. Il y a parfois des interférences entre le droit administratif et certaines matières de droit privé et public. Dans certains cas, le droit administratif emprunte des solutions au droit privé. Normalement, ils sont différents mis dans certains domaines c’est la règle de droit privé qui est empruntée par le juge administratif (art 1792 cc : respect des architectes). Quand l’administration est victime d’un dommage de construction d’une entreprise privée, le litige devra être porté devant le juge administratif car c’est un contrat de droit administratif. Le juge administratif appliquera les mêmes règles de responsabilité que celles qui sont dans le code civil. Ex : pour le droit du travail il y a un droit du travail administratif jugé par les tribunaux administratifs. Ce droit du travail concerne les fonctionnaires, agents publics. Le juge administratif va parfois emprunter des règles du code du travail pour sanctionner l’administration. Sous chapitre 2 : L’autonomie du droit administratif Le droit administratif français est un droit considéré comme dérogatoire du droit commun, c’est-à-dire un droit fondamentalement distinct du droit privé, du droit judiciaire. 2 questions : en quoi consiste ce principe d’autonomie ? Et est-il absolu ? Comment expliquer cette autonomie du droit administratif Section 1 : Le principe d’autonomie : son contenu L’autonomie signifie UE DANS DE TRES NOMBREUX DOMAINES LE DROIT ADMIN est différent du droit privé. Cette différence a été renforcée par une séparation radicale des juridictions administratives et des juridictions judiciaires. Elle découle d’une loi, des 16 et 24 août 1790, qui précise, dans son article 13 « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni cité devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. Cette loi a été reprise dans un autre texte, la loi du 16 fructidor de l’an 3, qui relevait que défense sont faites au tribunaux judiciaires de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, au peine de droit… » Cette distinction absolue entre juridictions judiciaires et administratives a renforcé le particularisme du droit administratif, qui été déjà il est vrai marqué, dans la mesure ou on ne pouvait pas appliqué le même droit à l’administration et aux particuliers. Cette singularité française ne se retrouve pas dans les pays anglo-saxons en particulier, ou c’est le même droit et les mêmes tribunaux qui sont amené à juger particuliers et administrations. Dans les pays anglo-saxons il existe certes des textes particuliers, applicables à l’administration, mais l’interprétation et l’application de ces textes se feront par les tribunaux ordinaires. En France le système est totalement différent puisque le droit administratif est dérogatoire au droit commun, c’est ce qu’on appelle l’autonomie du droit administratif par apport au droit privé. Ce principe a été consacré par la jurisprudence du Conseil d’Etat dans de nombreux arrêts, et notamment des arrêts relativement anciens qui ont fixé ce principe d’autonomie dans la jurisprudence. Dans un arrêt du tribunal des conflits, du 8 février 73, à propos de la responsabilité de l’administration : « la responsabilité de l’administration ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, mais elle a ses règles spéciales dont il aura lieu de tenir compte… » Arrêt Blanco. Dans un arrêt du 25 novembre 1921 du Conseil d’Etat ( arrêt Sabonerie Henry Olive ), le Conseil d’Etat a considéré que les règles applicables dans les litiges entre particuliers à propos de la répétition de l’indu ne sont pas transposables telles quelles en droit administratif. Le commissaire du gouvernement relevait dans cet arrêt « s’il est intéressant pour vous, juges administratifs, de connaître les applications que font du code civil en matière de répétition de l’indu, les tribunaux judiciaires, vous ne saurez oublier qu’ayant à trancher non pas un litige entre particuliers mais un litige ou l’Etat est partie, votre décision peut d’inspirer de principes différent, vous êtes maître de votre jurisprudence… » Si le droit civil peut inspirer le droit administratif, la solution retenue sera nécessairement différente de celle du droit privé, compte tenu du particularisme administratif. Dans son étendue, le principe d’autonomie est-il un principe absolu, ou peut-il y avoir des transpositions du droit privé en droit administratif. Dans certains domaines l’autonomie est absolue, ce sont notamment uploads/S4/ droit-admine.pdf
Documents similaires

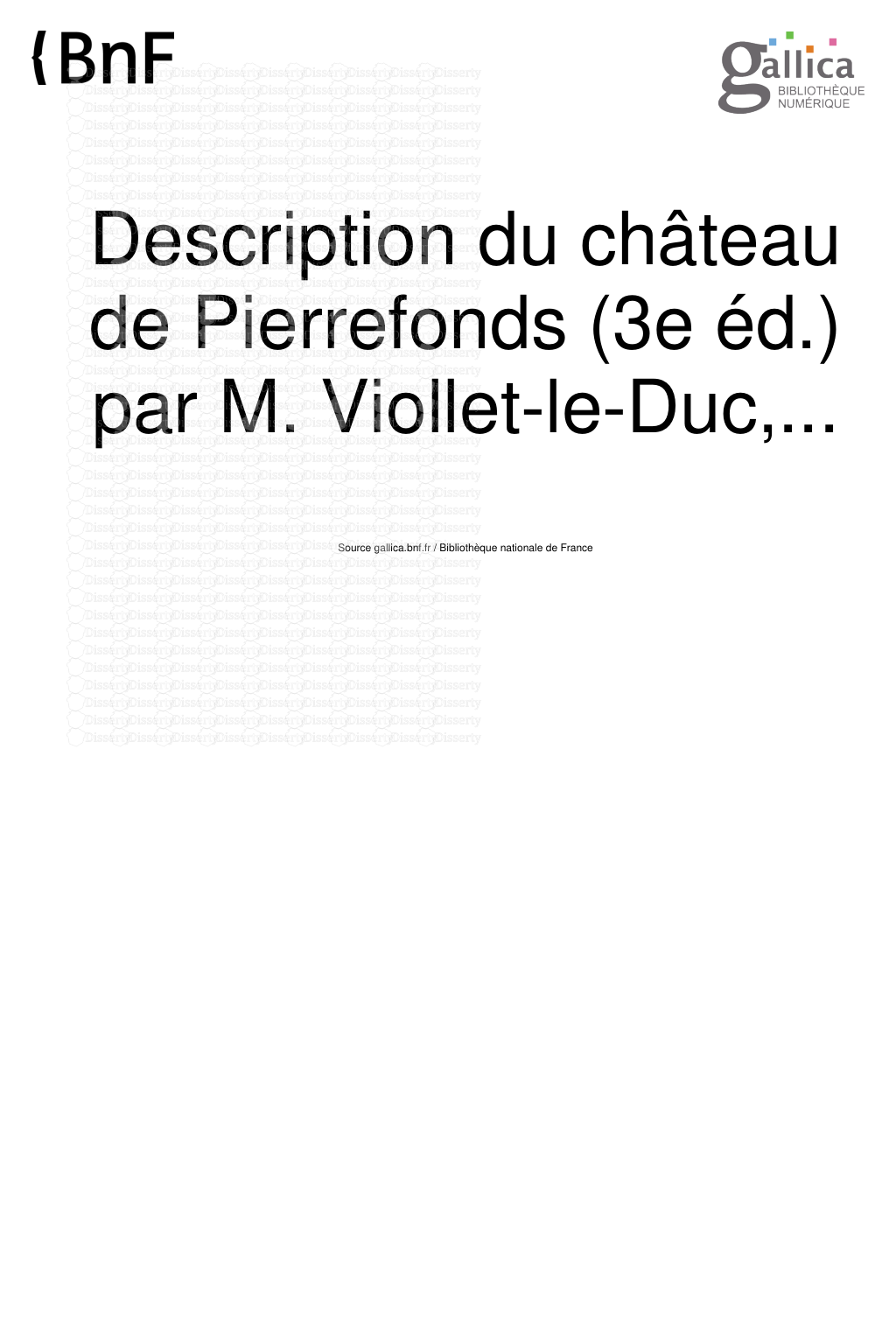








-
94
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 09, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4184MB


