LAAC – DUNKERQUE MUSIQUE À VOIR 2 | 3 Cette édition est produite par la directi
LAAC – DUNKERQUE MUSIQUE À VOIR 2 | 3 Cette édition est produite par la direction des musées de la Ville de Dunkerque dans le cadre de l’exposition Musique à voir présentée au LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine, du 29 avril au 17 septembre 2017 et a bénéficié du soutien de la communauté urbaine de Dunkerque et du Casino de Dunkerque Groupe Tranchant.. Commissariat d’exposition Jean-Yves Bosseur, compositeur et musicologue Production Sophie Warlop, directrice-conservatrice des musées Assistante d’exposition Sophie Dzierzynski Suivi éditorial Sophie Warlop, Sophie Dzierzynski, Anne Rivollet, Richard Schotte Conception graphique Sébastien Morel & Alexie Hiles Impression Nord Imprim © Ville de Dunkerque - 2017 C ompositeur de musique électro expérimentale et musicologue, musicien nomade, Jean-Yves Bosseur, témoin direct d’une grande partie de l’art du XXe siècle, a étudié avec Karlhein Stockhausen, a travaillé avec John Cage et Merce Cunningham, Pierre Henry... Ces rencontres nourrissent la conviction de Jean-Yves Bosseur qu’aucune cloison entre les disciplines n’est à respecter ou à subir. Les tensions, les chocs issus de la coexistence des arts permettent l’invention, la surprise et évitent l’imitation. En concevant l’exposition Musique à voir, présentée au LAAC du 29 avril au 17 septembre 2017, il nous propose une approche des relations entre les arts plastiques et la musique, à partir des productions artistiques de Jean Tinguely, Yves Klein, Nam June Paik, John Cage, Vasarely, Pierre Bastien, Céleste Boursier- Mougenot... soit 150 œuvres visuelles, sonores et installations. Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque, à l’initiative de ce projet, est naturellement le partenaire essentiel du LAAC pour offrir une riche programmation musicale qui accompagne l’exposition. Musique à voir se prolonge au Frac Nord-Pas de Calais avec l’exposition Le son entre, proposée du 29 avril au 31 décembre. Édito Musique à voir ou comment se laisser déborder par le syndrome Bouba Kiki… Dans nos sociétés hyper- rationnelles, peu de place est laissée à la sensibilité. Pourtant, nos sens nous guident, nous tiennent en éveil, nous alertent… Ils sont le vecteur des plus grandes sur prises et du monde ordinaire. Ils s’accordent, se compen sent et se combinent naturel lement. Dans le but de comprendre même ce qui semble irrationnel et particulier à chacun, les neuroscienti fiques étudient leur faculté d’interagir. Ils ont découvert des standards mais aussi des exceptions. Le syndrome Bouba Kiki toucherait 98 % de la popu lation. Il démontre que la majorité des personnes sou mises aux tests associent les mêmes sons aux mêmes formes : « bouba » à une forme arrondie et « kiki » à une forme anguleuse. D’autres études parviennent à la conclusion qu’une musique rapide et rythmée est géné ralement associée à des cou leurs chaudes (jaune, orange, rouge) et une musique lente à des couleurs froides ou sombres (bleu, violet, bleu- vert). Les rapports sons/images nous concernent tous, et naturellement de nombreux plasticiens ou musiciens. Depuis plus d’un siècle, des travaux sur les perceptions ont donné lieu à des expé riences sur les correspon dances harmoniques entre son et couleur. Le visuel investit ainsi la musique, et le son : le visuel. Certains artistes ont voulu créer une unité polysensorielle, cherchant des données objectives comme celles de la théorie vibratoire des couleurs ou au contraire purement subjectives, auto suffisantes et singulières. De nouveaux médias telle la vidéo ont investi ce champ. Les réflexions sur le rythme comme une organisation de l’espace mais aussi du temps sont déterminantes. Des machines-œuvres ont vu le jour. Les systèmes d’écriture du son deviennent aussi un terrain de création visuelle. Mais plus encore, pour vous, le bruit est-il par nature invisible ? Une image est-elle sonore ? L’audition colorée est un don un peu étrange mais parfai tement naturel pour une part infime de la population. La synesthésie est une particula rité neurologique involontaire, consciente, permanente et immuable. Elle justifie une forme de subjectivité de la perception. Certains sont capables de percevoir nettement un son en voyant une image, d’autres associent les consonnes et voyelles à des colorations très précises... La synesthésie n’est pas une pathologie mais une simple caractéristique phy sique qui élargit le champ des perceptions et de ce fait les facultés créatrices. Wassily Kandinsky voyait des couleurs en mouve ment lorsqu’il écoutait de la musique. Auguste Herbin associait naturellement des phonèmes à des couleurs et des formes d’où son alphabet plastique... Le LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine et le Conser vatoire de Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque se sont tout naturellement associés pour vous proposer Musique à voir, une exposition étonnante, en invitant Jean- Yves Bosseur, compositeur et musicologue, spécialiste de ces questions. Musique à voir : un voyage au cœur des sens, pour se laisser déborder par des syndromes qui pourraient vous rendre heureux ! Sophie Warlop conservatrice / directrice des musées de dunkerque Régis Kerckhove directeur du conservatoire de musique et d'art dramatique de dunkerque 3 Sommaire Musique à voir P. 4 Entretien avec Jean-Yves Bosseur P. 8 L'exposition P. 14 La création sonore contemporaine : une double perspective P. 26 Le son entre P. 30 Remerciements & crédits P. 34 Couverture : From here to hear © Céleste Boursier-Mougenot. Courtesy Museum of Old and New Art (MONA), Hobart, Tasmania. © ADAGP, Paris, 2017 4 | 5 L es tentatives d’échange, voire d’osmose entre les domaines du visuel et du sonore n’ont cessé de se ramifier et se diversifier à notre époque. Face à une telle floraison, on ne peut que s’interroger sur les formes d’ex pression artistique qui jouent délibérément sur le paradoxe que suppose toute ambition de classification, aussi bien au niveau de leur conception que de leur perception. Nombreux sont en effet les compositeurs qui ont pris pour source d’inspiration une œuvre picturale ; encore plus nombreux sont les peintres qui ont adopté la pensée musicale, ou bien une partition en parti culier, comme base de réflexion, ou d’imprégnation sensorielle, pour leur propre pratique. Le temps deviendra ainsi une com posante concrète d’un travail plastique ; l’espace sera envisagé comme une dimension à part entière d’un projet musical ; un objet sonore sera considéré sous le double aspect de son appa rence visuelle et de ses conséquences acoustiques... Il s’est donc avéré nécessaire d’organiser l’espace de l’expo sition autour de quelques grandes orientations générales. Or les salles que le LAAC consacre à ses expositions temporaires nous permettaient précisément de concevoir la disposition des œuvres par rapport à cinq thématiques principales. Les relations les plus souvent évoquées entre ces disciplines artistiques demeurent de l’ordre de l’analogique, du métapho rique alors que, lorsque l’on envisage les centres d’intérêt des peintres pour le domaine musical, on s’aperçoit qu’il existe quasiment autant d’interprétations de tels rapports que d’ar tistes et que la quête d’un simple parallélisme entre les modes d’expression concernés demeure relativement mineure. De plus, des personnalités comme Kandinsky, Scriabine ou Klee étant le plus fréquemment citées à ce sujet, il nous a semblé nécessaire de montrer que bien d’autres artistes ont avancé des hypothèses d’échange originales, susceptibles d’inviter à de multiples formes de prolongement, de ramification, voire de détournement. Et cela paraît d’autant plus important que, après le foisonnement d’idées et les bouleversements esthétiques qui se sont opérés au début du XXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale, on peut à nouveau observer un certain cloi sonnement des disciplines artistiques tandis que, dans le même temps, les développements médiatiques et technologiques les plus récents devraient plutôt inciter à transgresser toute atti tude frileuse de repli sur les catégories conventionnellement associées à l’histoire de l’art. Les cinq thématiques centrales de Musique à voir sont les équivalences sensorielles, le rythme entre temps et espace, les correspondances structurelles, la plasticité de la notation musicale, les interactions effectives entre modes d’expression ; chaque tendance présentant des formes de résonance jusqu’à aujourd’hui. Il ne s’agit bien sûr là que de directions schéma tiques, certaines œuvres intervenant à la croisée de plusieurs d'entre elles. Les relations entre musique et arts visuels continuent en effet à s’articuler autour de ces grandes familles de préoccupations, quels que soient les moyens techniques utilisés. C’est ainsi que des notions telles que la vibration, le rythme, la variation, le collage, la série, le hasard... peuvent être envi sagés dans leurs relations ambivalentes au temps et à l’espace, dans le souci de préserver un caractère fondamentalement interrogatif. C’est avec le romantisme que le questionnement d’un art par un autre en vient à remettre en cause les certitudes admises, donc les académismes, et à s’interroger sur les racines communes à toute expression artistique, en deçà des savoir-faire propres à chaque discipline. Sans doute devra-t-on y voir la nostalgie d’un âge d’or, de la fête primitive, d’une unité originelle, antérieure à la séparation des sens, seule capable d’opérer une authentique fusion avec la nature. Musique à voir JEAN-YVES BOSSEUR, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION Ci-contre : Auteur, titre, Année « Comme la musique, la peinture a son propre alphabet. » Auguste Herbin 6 | 7 « À l’origine à la fois de la musique expérimentale et des arts sonores, source d’inspiration uploads/s3/ musique-a-voir.pdf
Documents similaires




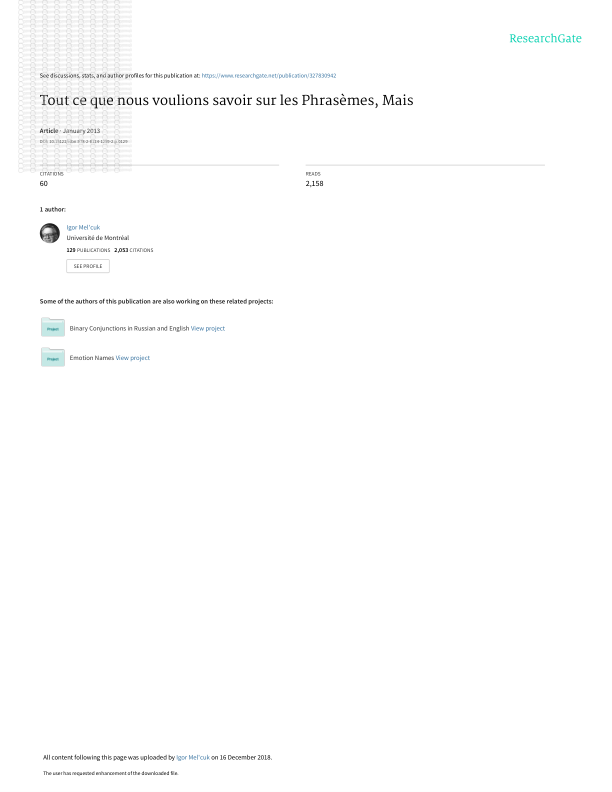





-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 08, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.8676MB


