E.N. KODJO – Cours de Philo, Epist. et Morale –USB G1 FAG ET MED – 2020-2021 Pa
E.N. KODJO – Cours de Philo, Epist. et Morale –USB G1 FAG ET MED – 2020-2021 Page 1 0. INTRODUCTION GENERALE 0.1. Objectifs du cours Destiné aux étudiants des 1ères années de graduat, ce cours de Philosophie, Epistémologie et Morale a pour objectif général de rendre l’étudiant capable de transformer sa vie et sa société par sa culture de la vérité et son sens éthique, grâce à une approche critique du réel. Il a trois séries d’objectifs liés à chacune de ces parties. Ainsi, à l’issue de la 1ère partie de ce cours portant sur la philosophie, l’étudiant de 1er graduat sera capable : - de comprendre et d’expliquer la spécificité et la valeur de la philosophie dans le domaine du savoir ; - d’exercer un esprit analytique et critique sur la réalité ; - d’apprécier la spécificité de la philosophie africaine. La 2e partie, portant sur l’épistémologie, vise essentiellement à conduire l’étudiant à la culture de la vérité scientifique. A cet effet, elle introduire ce dernier : - à la connaissance des exigences fondamentales d’une connaissance humaine vraie ou qui se rapproche davantage de la Vérité ; - aux thèmes et aux grands courants de l’épistémologie, d’après l’appellation française; - à la capacité de juger le savoir suivant les critères de scientificité ; La 3e partie du cours, centrée sur la morale, entend mener l’étudiant à acquérir : - une compréhension scientifique de la vocation de l’être humain du Bien moral - la capacité d’évaluer correctement la moralité des actes humains ; - une adhésion comportementale manifeste aux grandes valeurs morales. 0.2. Contenu du cours La première partie du cours comprendra trois chapitres portant successivement sur : - le concept de philosophie - les grandes doctrines philosophiques de l’histoire - l’essentiel de la philosophie africaine La seconde partie du cours aura quatre chapitres portant successivement sur : - la signification et l’importance de l’épistémologie - les notions fondamentales de la science et de la connaissance humaine E.N. KODJO – Cours de Philo, Epist. et Morale –USB G1 FAG ET MED – 2020-2021 Page 2 - la question de vérité : problème, critères et diversité (vérités scientifique, philosophique, religieuse, théologique, esthétique, morale, politique, etc.) - quelques courants épistémologiques majeurs. La troisième partie du cours développera les thèmes ci-après : - La spécificité de l’éthique comme science de la morale ; - Les grands courants éthiques de l’histoire - Les principes et les critères de la moralité des actes humains 0.3. Dispositions méthodologiques Pour l’apprentissage des étudiants, le cours utilisera comme procédés les exposés de l’enseignant, les discussions dans les séances de cours et les recherches des étudiants. Les acquis cognitifs des étudiants seront évalués à travers au moins une Interrogation, des travaux pratiques et l’examen. 0.4.Bibliographie sélective - BALIBAR E. et MACHEREY P., « Epistémologie », dans Encyclopaedia Universalis, Volume 6. Paris, Encyclopaedia Universalis France, 1980, p. 370-373. - CUVILLIER, A., Précis de philosophie. Paris, Armand Colin, 1961. - DE RAEYMAEKER Louis, Introduction à la philosophie, sixième édition. Louvain, Publications Universitaires de Louvain, 1967. - FOULQUIE Paul, La connaissance. Cours de philosophie, Cinquième édition revue et corrigée. Paris, Editions de l’école, 1961. - FRANKENA K. William, Ethics, Second Edition. New Delhi, Prentice-Hall of India, 2007. - FURROW Dwight, Key Concepts in Philosophy. London, Continuum, 2005. - GRANGER, G.-G., La science et les sciences. Paris, PUF, 1995. - HÖFFE Otfried (éd.), Dictionnaire de Morale. Paris, Cerf, 1983. - JOLIVET Régis, Traité de philosophie. I. Introduction générale, logique, cosmologie. Paris, Emmanuel Vitte, 1962. - KASONGO YAMBO François-Stéphane, Initiation à la philosophie. Kinshasa, Médiaspaul, 2016. - LADRIERE Jean, Les enjeux de la rationalité. Le défi de la science et de la technologie aux cultures. Paris, Aubier-Montaigne/Unesco, 1977. E.N. KODJO – Cours de Philo, Epist. et Morale –USB G1 FAG ET MED – 2020-2021 Page 3 - LEAHY L., L’homme…ce mystère. Pour une philosophie de l’homme. Kinshasa, Publications de l’Institut S. P. Canisius, 1981. - MABASI BAKABANA Frédéric-Bienvenu, « Les limites d’une théorie de la rationalité », dans Léonard SANTEDI Kinkupu et Modeste MALU Nyimi (dir.), Epistémologie et théologie. Les enjeux du dialogue foi-science-éthique pour l’avenir de l’humanité. Mélanges en l’honneur de S. Exc. Mgr Tharcisse TSHIBANGU Tshishiku. Kinshasa, Facultés Catholiques de Kinshasa, 2006, p. 413-447. - MABIKA NKATA J., La mystification fondamentale. Merut ne maât. Aux sources négrides de la philosophie. Lubumbashi, Presses Universitaires de Lubumbashi, 2002. - MAIDIKA ASANA Jules, Notes de philosophie et logique. Institut Supérieur Pédagogique de Bunia, Année académique 2016-2017, inédit. - RUSS Jacqueline & LEGUIL Clotilde, La pensée éthique contemporaine. Paris, Presses Universitaires de France, 1994. - RUSS J. & FARAGO F., Philosophie. Les auteurs, les œuvres. Paris, Bordas, 2003. - TOWA Marcien, «La philosophie africaine dans le sillage de la négritude », dans Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle. Yaoundé, Clé, 1971. - VAN PARYS Jean-Marie, Une approche simple de la philosophie africaine. Kinshasa, éd. Loyola, 1993. - VAN STEENBERGHEN, F., Epistémologie. Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1965. - VERNAUX, R., Epistémologie générale ou critique de la connaissance. Paris, Beauchesne et ses Fils, 1959. E.N. KODJO – Cours de Philo, Epist. et Morale –USB G1 FAG ET MED – 2020-2021 Page 4 PREMIERE PARTIE : NOTIONS ELEMENTAIRES DE PHILOSOPHIE CHAPITRE PREMIER : CONCEPT DE PHILOSOPHIE 1.1.Signification et valeur de la philosophie 1.1.1. Origine et étymologie du mot « philosophie » Le mot « philosophie» vient du grec philosophia : amour (philia) de la sagesse (sophia). Il fut inventé par Pythagore, sage et mathématicien grec du 6e siècle (570-490 av. Jésus-Christ).1En ce sens, le philosophe (philosophos) est donc un ami de la sagesse. Le mot « sagesse », chez les grecs de l’Antiquité, signifiait un savoir et en même temps l’art de vivre conformément à la morale. De la sorte, la sagesse a une double fonction. D’une part, il y a la fonction théorique ou cognitive qui vise la connaissance de la vérité, la science, le savoir, l’acquisition d’une conception d’ensemble de l’univers. D’autre part, il y a la fonction éthique et pratique, qui vise l’élaboration d’une règle de vie et l’adoption d’une attitude réfléchie en vue d’une conduite juste dans la société.2 Etre ami de la sagesse signifie être un assoiffé et un chercheur dévoué de la sagesse dans la double fonction de celle-ci, une personne qui fait de la recherche de la sagesse son souci permanent, voire sa priorité. Et avec François-Stéphane KASONGO, il sied de noter l’importance qu’accorde Pythagore à l’humilité du vrai philosophe : ce dernier ne doit jamais prétendre posséder la sagesse ou la vérité, que Dieu seul, en tant qu’Etre suprême, peut posséder. Le philosophe, en tant qu’homme, ne peut que rechercher la vérité et s’en approcher.3 1.1.2. Sens vulgaire de « philosophie » Est-il correct de dire que « tout homme est philosophe » ?Oui et non. La réponse est « oui », si l’on reconnaît avec Aristote que l’homme est un « animal raisonnable », en ce sens qu’il est doué de raison (intelligence) grâce à laquelle il peut, à sa manière, s’interroger, penser, raisonner, s’approcher de la vérité. De ce point de vue, la philosophie de tout homme ou groupe humain est à comprendre au sens large du mot : une approche ou vision du monde. Ici, on parlerait d’une « philosophie spontanée », pour désigner « une conception générale de l’univers, un ensemble d’opinions, une sagesse individuelle ou collective ».4 1 François-Stéphane KASONGO YAMBO, Initiation à la philosophie, Kinshasa, Médiaspaul, 2016, p. 13. 2 Jules MAIDIKA ASANA, Notes de philosophie et logique, Année académique 2016-2017, inédit, p. 5. 3 François-Stéphane KASONGO YAMBO, Ibid. 4Jules MAIDIKA, p. 12. E.N. KODJO – Cours de Philo, Epist. et Morale –USB G1 FAG ET MED – 2020-2021 Page 5 Par contre, il est incorrect de dire que « tout homme est philosophe » si l’on considère la philosophie dans son sens strict, comme recherche de la vérité par une réflexion critique, une approche rationnelle systématique des réalités.5 En effet, il ne suffit pas d’une belle tournure de pensée ni d’un raisonnement énigmatique (difficile à pénétrer) pour être philosophe. « La qualité essentielle du philosophe est donc l’esprit critique. Il n’accepte rien de manière naïve, mais il fait passer au crible de la raison toutes les certitudes que nous tenons pour évidentes (…) La philosophie n’est pas un pur refus ou un scepticisme, mais une exigence de preuve. »6 1.1.3. La philosophie comme science 1.1.3.1.Concept de la science Du mot latin scientia (=connaissance), la science est à entendre comme une somme actuelle des connaissances, une activité de recherche et une méthode d’acquisition d’un savoir7complexe, mais précis, que réalise et possède l’homme. Par la science, l’être humain, sur base de sa compréhension perfectible (à améliorer), tente de re-créer ce monde pour le rendre plus confortable et l’habiter autrement que les animaux inférieurs qui, eux, se contentent d’être dans le monde tel qu’il est8. La science comporte un ensemble de démarches, notamment : 1) la recherche et l'acquisition systématique de connaissances sur les objets, le monde, l’homme et Dieu ; 2) l'organisation et la synthèse de uploads/Philosophie/ philo-g1-fage-et-med-2020-21.pdf
Documents similaires







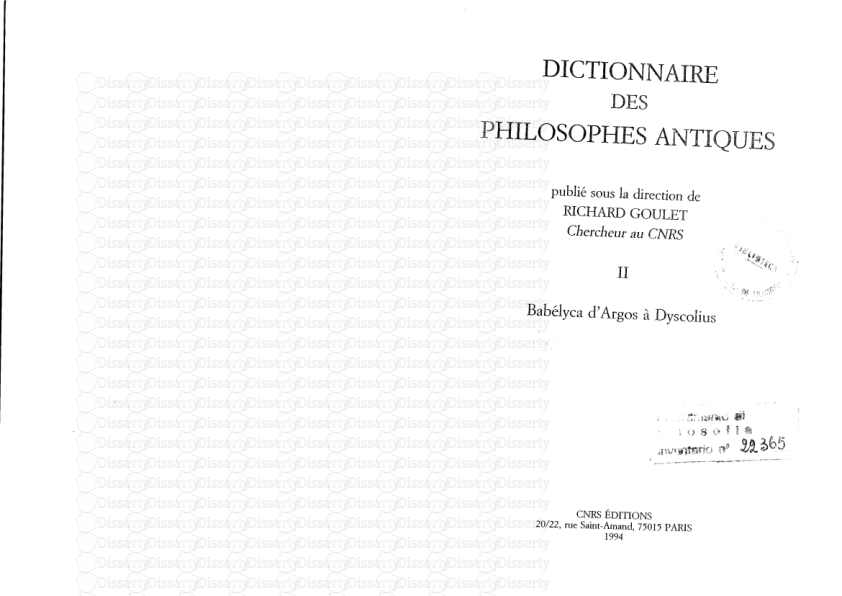


-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 21, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.2190MB


