Évaluation de l’impact social, économique et environnemental des risques majeur
Évaluation de l’impact social, économique et environnemental des risques majeurs d’inondation : cas des villes algériennes Fatma-Zohra HARIDI Maitre de conférence Université de Guelma Algérie Fatma-Zohra HARIDI, maitre de conférence à l’université de Guelma (Architecte urbaniste), de formation. Titulaire d’un doctorat es science algérien et d’un doctorat en urbanisme français. Poursuivant des recherches ponctuelles depuis l’année 2000 sur la mise en œuvre locale du concept universel « développement durable » dans certaines villes en Algérie, telles que les oasis de la région de la Saoura, la ville de Guelma et d’Annaba. Les travaux de recherche entrepris sont des bilans prospectifs sur le mode de vie sociale, économique, environnementale et culturelle des populations résidentes en milieu d’espaces protégés par rapport aux paramètres de l’écotourisme dans le cadre du laboratoire d’architecture et développement durable à l’Université d’Annaba. Ayant participé à plusieurs colloques internationaux concernant les effets du développement durable sur les environnements protégés et publier plusieurs articles concernant le thème le « développement durable et l’écotourisme en milieu protégé ». Résumé L’Algérie est un pays à risques multiples. C’est un pays particulièrement exposé à plusieurs phénomènes qui résultent de raisons diverses telles que le taux élevé d’accroissement de la population, surtout dans les centres urbains et les régions souffrant d’une migration urbaine très forte. La dégradation progressive de l’environnement par l’étalement urbain qui induit une occupation anarchique des zones inondables. Ajoutons à ces causes le passif d’autres facteurs comme l’occupation des lits des oueds par des constructions, ordures ménagères et déchets des charges des matériaux de construction qui aggravent les conséquences du sinistre. La multiplication de ces facteurs incontrôlés rend difficiles la prévention et l’intervention rapide. À cela s’adjoint les effets du changement climatique qui à lui seul remet en question toutes orientations politiques de la gestion du risque. Aujourd’hui en Algérie, on rencontre plus de 50% des villes algériennes, sans distinction de situation géographique, sont astreintes aux risques d’inondations. Notamment, les villes du Sud, dont vingt-trois (23) d’entre elles ont déjà subi les conséquences de ce sinistre. En fonction de cette situation, les hommes et l’environnement sont de plus en plus touchés. Par ailleurs, la fréquence et la gravité de ces catastrophes s’intensifient de manière alarmante, alors que les dispositifs et les actions de prévention mis en place restent inopérants et incapables de répondre de manière adéquate. Pendant une dizaine d’années, les incidences économiques, sociales et environnementales engendrées entrainent des dommages supplémentaires aux retombées très lourdes. Mots-clés : Prévention, inondation, risque, impact, Algérie 1. Introduction Contribution à la réflexion sur la reconnaissance du risque L’objectif en ce cas, est d’inciter les collectivités locales à engager une réflexion préalable et globale sur les conséquences du risque. Cette réflexion s’impose, car les effets induits par le renouvellement de ce phénomène sont énormes. De telles perceptions, malgré l’existence de mesures réglementaires et législatives permettent néanmoins d’orienter l’attention sur les évaluations de l’importance du risque et à l’interprétation de l’impact social, économique, environnemental du risque. Et par ce fait même, cette réflexion tient à reconnaitre le sinistre de manière unanime. Dès lors, on peut s’interroger sur la valeur du risque et ses conséquences, en effet : - qu’est-ce qu’un risque et comment connaître les effets de ce risque sur le territoire inondé et sur la population habitante? Quel est le contenu minimal d’un plan d’urgence? Quelles personnes impliquer dans les opérations et actions d’intervention? Du point de vue formation et sensibilisation des populations : - comment former les acteurs impliqués? Mais aussi comment sensibiliser les populations aux risques si les moyens mis en place sont très limités pour mettre en œuvre les actions nécessaires? Dans la perspective d’une contribution réflexive sur l’évaluation globale de l’impact social, économique et environnemental du risque encouru, cela suppose : une identification du risque sous ses diverses natures et particulièrement politique et juridique, En revanche, cette réflexion ambitionne de passer au-delà d’un simple diagnostic des nombreux problèmes qui entravent la bonne marche des actions de prévention, mais cherche à s’ouvrir aux connaissances de la situation conjoncturelle vécue dans presque toutes les villes algériennes face aux conséquences du risque d’inondation. Cette réflexion est nécessaire à plus d’un titre, car elle incite à prend en compte les opportunités de prévention et focalise son intention sur les solutions qui font avancer les politiques de la gestion du risque. Ainsi, quelles connaissances préconise-t-on pour identifier et reconnaitre les sources et caractéristiques du risque afin de faciliter leurs gestions? 1.1. Sources du risque d’inondation En Algérie, les pluies répétées, même sous forme d’averses courtes, leurs intensités sont majoritairement les principales causes des inondations. En secteur urbain où le ruissellement fait obstacle à l’écoulement normal des précipitations aux débits très importants, cause nécessairement un débordement qui renforce les coulées de boue. L’imperméabilisation des sols par la conception de l’urbanisation et des réseaux d’assainissement bloqués est aussi un facteur d’aggravation qui rend les opérations d’intervention difficile. Ainsi, le lien entre les sources du risque et la vulnérabilité des sites inondables dépend de facteurs particulièrement liés aux crues oueds; c’est-à-dire aux inondations fluviales (M; Cote, 2005 : 59) et à la problématique de l’influence humaine sur le régime de l’eau en modifiant les caractéristiques des crues (Y. Nédélec, 1999). Le renouvellement périodique de ce sinistre encouru ne se limite pas à une surcharge d’eau provenant des pluies d’orage, il se rattache aux problèmes d’évacuation par rapport à la durée temporelle de l’opération. L’autre facteur dangereux est le mouvement de masse qui produit des glissements de terrain capables en quelques heures de déverser des coulées de boue de plusieurs dizaines de millions de mètres cubes. Ces écoulements de boues oblitèrent tous les réseaux d’assainissement et aggravent l’état catastrophique surtout sur le plan économique. 1.2. Nature du risque La question de la nature du risque se pose progressivement surtout sur le plan sociopolitique. En Algérie, l’introduction la nature du risque dans le contenu préventif, met en évidence l’une des caractéristiques du risque. Ce n’est qu’une fois la détermination scientifique de la nature effectuée que le risque devient un objet de nature politique et juridique. Finalement l’identification de la nature du risque comme un phénomène potentiellement dangereux au regard duquel l’enjeu économique est susceptible d’être évalué à chaque catastrophe. Selon toutes les études d’estimations, en pertes annuelles imputables aux inondations, la marge de l’impact socio-économique, locale et nationale est très importante. À défaut d’agir sur les manières de gérer les risques d’inondations notamment, celles prises par la réglementation, ce préjudice peut fausser toues les études d’évaluation, que soit le défi du secteur de l’eau par rapport aux perspectives préventives. 2. L’impact économique des conséquences du risque En Algérie, le risque encouru par les inondations connaît des conséquences économiques très lourdes tant sur le plan humain que matériel et des coûts financiers considérables. La volonté de maintenir le développement local et ignorer l’importance de la progression du risque réduit la valeur économique des quartiers sinistrés. La remise en question, principalement de la valeur foncière de ces quartiers. Le coût économique, social et environnemental du risque d’inondations progresse chaque année, citons à l’exemple les inondations qui ont ravagé le quartier de Bab El Oued, à Alger (2001), causant des dégâts évalués par la Compagnie centrale réassurance (CCR) à 544 millions de dinars1. Ainsi dans de nombreuses villes algériennes, tous les quartiers touchés par le sinistre laissent apparaitre des signes d’une dégradation très avancée. La nature de ces calamités constitue une atteinte à l’image de la ville algérienne par l’aggravation de la pauvreté et la marginalisation des populations sinistrées. Cette image généralisée renforce l’appréhension d’inquiétude des collectivités locales pour développer économiquement ces quartiers sinistrés. Au niveau national, ces dégâts entravent l’activité économique du pays et ralentissent tout développement structurel programmé. Toutefois, un grand nombre de villes ont adopté des stratégies de développement crédibles et à long terme pour pallier à cette situation. Devant l’ampleur des dommages enregistrés, l’occurrence économique demande l’engagement de tous responsables, gestionnaires, autorités locale et nationale, associations et citoyens pour réduire les coûts des risques et prendre conscience de manière pragmatique et transparente. Par ailleurs, l’implication effective de la réglementation et de la participation citoyenne peut également être capable de fournir une amélioration au développement économique dans le respect des objectifs du développement durable afin de maintenir la sécurité sanitaire et les équilibres naturels. 1 Cf. La disposition de données fiables concernant les catastrophes causées par les inondations de toutes les villes algériennes sont rares et les références dont on a accès ne rendent pas compte des dommages et leur impact social du point vue de vie humaine, de moyens d’existence, d’endommagement de l’infrastructure et les communications du point de vue d’impact environnement. 2.1. La portée politique du risque et ses aspects juridiques La lutte contre les conséquences des inondations mise sur des politiques de gestion du risque fondées sur les résultats obtenus des diverses instances d’évaluation, qu’elles soient étatiques, privées ou indépendantes. Ainsi, la lutte contre le risque varie en fonction de la portée politique formulée autour de la sémantique préventive sous ses différents aspects juridiques. On peut ajouter qu’en uploads/Management/haridi-texte-impact-plan-orsec-pdf.pdf
Documents similaires






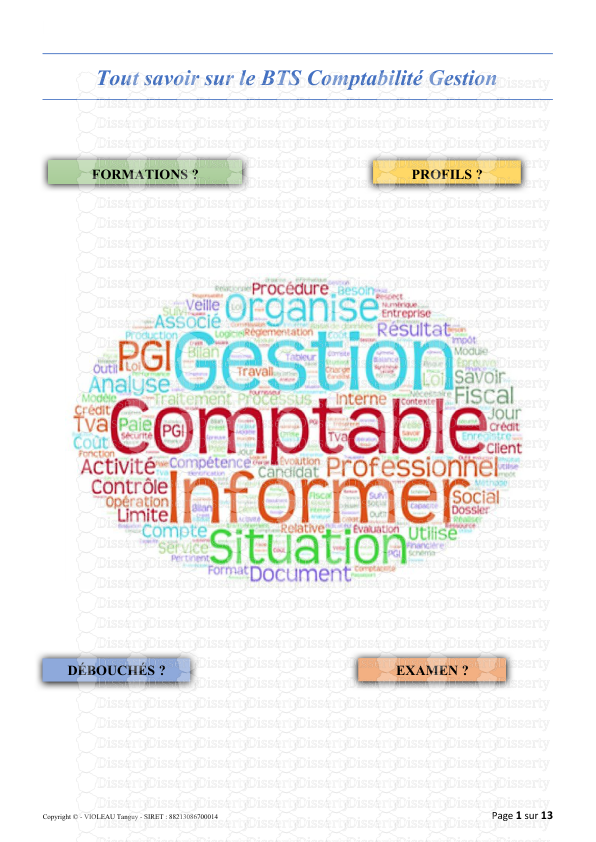



-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 20, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.8599MB


