1 I. COMMENTAIRE DU TEXTE DE RÉFÉRENCE Le texte de référence définit l’épreuve
1 I. COMMENTAIRE DU TEXTE DE RÉFÉRENCE Le texte de référence définit l’épreuve de langue. Chacun des alinéas de la définition en précise un aspect particulier. 1. L’OBJECTIF : Il est évalué les compétences d’expression et de communication des élèves, autrement dit, des compétences de production et de réception des textes. 2. LE SUPPORT : Le texte est précédé ou non d’un chapeau. Il est un texte littéraire ou non, écrit en français moderne et comportant 250 à 400 mots. Les textes d’étude sont donc des textes de tout type, de tout genre, requérant de la part de l’élève des compétences de lecture au sens plein du terme. 3. LE CONTENU : L’épreuve comprend quatre rubriques portant sur les items du programme. 3.1. LA COMMUNICATION : Elle concerne tout ce qui touche aux actes d’énonciation : la relation interlocutive, les marques de l’énonciation, les choix énonciatifs, la visée, la communication iconique ou verbale, etc. 3.2. LA MORPHOSYNTAXE : Cette rubrique s’intéresse à l’organisation du texte, à la construction des phrases, à ses modalités ou types de phrases, aux temps verbaux, aux différents signes intervenant dans un texte, etc. 3.3. LA SÉMANTIQUE : Elle se rapporte essentiellement, et pour le niveau secondaire, aux choix lexicaux du scripteur ou du locuteur par rapport à la visée énonciative à l’organisation lexicale des textes. 3.4. LA STYLISTIQUE OU RHÉTORIQUE DES TEXTES : L’attention se porte ici sur les figures de style aux quelles le scripteur / énonciateur a recours pour donner un relief particulier à ses idées. La quatrième rubrique de l’épreuve s’occupe également des procédés d’écriture mis en œuvre dans un texte et, partant, de toutes les implications de son inscription générique. En somme, l’élève doit pouvoir montrer comment les potentialités de la langue sont actualisées dans un énoncé, comment la langue se fait parole. DES OBJECTIFS DU COURS DE LANGUE A la fin des études secondaires, l’élève ayant reçu des enseignements de langue française devrait être capable : de s’exprimer aisément et correctement, oralement et par écrit. de manier des structures grammaticales complexes et un vocabulaire riche pour traduire sa pensée, ses sentiments ou des concepts ; de commenter directement, résumer un document écrit, oral ou iconique ; d’expliquer comment s’élabore un message en relation avec une situation donnée et un objectif à atteindre. 5ème PARTIE Langue française 2 4. FORME DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES L’enseignant, pour sa part évaluera la capacité de chaque candidat à repérer, analyser, interpréter les phénomènes à l’œuvre dans un acte énonciatif. II. LES SOUS-COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À LA RÉSOLUTION DES QUESTIONS DE LANGUE 1. OBSERVATION : examen attentif et méthodique du texte 2. REPÉRAGE : découverte, identification, désignation des indices ou éléments d’étude. 3. CLASSEMENT : inscription des indices textuels dans des catégories ou sous- catégories permettant non seulement de mieux les appréhender mais encore d’en faciliter l’exploitation. N.B. : Les choix du genre littéraire, du type de texte par un scripteur ne sont jamais innocents. La visée ou l’intention de ce dernier se matérialise précisément à travers des procédés, de stratégies d’écriture. En classe de première, la 4ème rubrique porte uniquement sur la stylistique. 4. ANALYSE : mise en évidence des relations existant entre les éléments disséminés dans le texte, de même que leurs principes organisationnels. 5. INTERPRÉTATION : traduction des effets produits par le fonctionnement ou, mieux, par le « comportement » des faits observés et analysés, dans le texte. Établissement d’un lien entre les faits et la signification du texte. D’où le bien–fondé de cette recommandation « la consigne établira clairement un lien entre le repérage et la construction du sens ». 6. LA RÉDACTION DES RÉPONSES : Les réponses seront « entièrement » rédigées, cela implique nécessairement la proscription des « abréviations » et du style, « télégraphique ». L’enseignant correcteur pourra alors apprécier la maitrise active que chaque candidat a de la langue française. III. LA GESTION DU TEMPS L’élève, en situation normale d’évaluation dispose de deux heures pour : lire, comprendre le texte et les questions, répondre aux questions posées, relire l’ensemble du devoir. Aussi importe-t-il de gérer le plus efficacement possible l’enveloppe horaire allouée au traitement de l’épreuve de langue. Nous pouvons en dégager trois moments : 1. LA LECTURE DE L’ÉPREUVE / 15 à 20 minutes Cette importance phase prendra 15 à 20 minutes. Il s’agira pour l’élève de prendre intégralement connaissance de l’épreuve : Le texte-support : les éléments paratextuels ; (type de texte et sujet abordé). 3 Le questionnaire : identification des difficultés. 2. LES RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES / 1H 30 MINUTES. Il est recommandé de commencer par une identification préalable de l’objet de chaque question. Les exigences fondamentales d’une évaluation quelle qu’elle soit mettent en avant le respect des items du programme. Le travail se poursuit dans l’examen de la consigne. Cette opération (ou activité) permettra de déterminer avec exactitude la tâche à exécuter, donc le type de réponse attendue. Les réponses pourraient alors être structurées ainsi qu’il suit : repérage - identification des indices et relevé des occurrences. (classement) analyse - interprétation. 3. LA RELECTURE / 10 à 15 minutes Compte tenu des exigences de clarté et de corrections linguistiques expressément formulées dans le texte de référence, 10 à 15 minutes seront accordées à la relecture de l’ensemble du devoir. L’élève se « livrera » pendant ce laps de temps à une « traque » systématique des erreurs, des coquilles et autres négligences orthographiques voire stylistiques. Car une pénalité de 02 points sanctionne ces manquements. VI. QUELQUES TYPES DE CONSIGNES RELEVÉES DANS LES ÉPREUVES DE LANGUE Qui « parle » dans le texte ? A quels indices reconnaissez-vous sa présence ? Quel est le référent de ce texte ? Est-il explicitement exprimé ? Justifiez votre réponse. Quel effet produit la répétition de l’adjectif qualificatif « … » dans le texte ? Analysez la métaphore dans le premier paragraphe et déterminez l’effet produit. Étudier la situation d’énonciation. Explicitez les sous-entendus contenus dans le passage. Caractérisez le vocabulaire utilisé. Quelles sont ici les principales intentions de communication du locuteur Repérez puis identifiez les figures du signifié (comparaisons, métaphores, personnifications, hyperboles) employés par l’énonciateur. Quels effets sont ainsi Déterminez le champ sémantique d’un mot et précisez les sentiments que révèlent les différentes significations données à ce mot. A partir du repérage du type de lexique récurrent, figures de style et procédés d’écriture employés, déterminez la tonalité dominante du texte. Relevez et analysez le champ lexical de… Repérez, identifiez et classez les éléments qui autorisent à parler de tonalité lyrique à propos de ce texte. Quelle est l’utilité de cette tonalité par rapport au destinataire de l’énoncé ainsi produit ? A partir du repérage du type de lexique récurent, des figures de style et des procédés d’écriture employés, déterminez la tonalité dominante de ce 4 créés ? Par quels procédés l’énonciateur s’efforce-t-il d’impliquer ses différents destinataires dans son énoncé ? A quelle fin précise ? passage. Quels effets de sens le texte tire de l’emploi de cette tonalité ? VII. DEUX PROPOSITIONS DE RÉPONSES RÉDIGÉES 1. Relever et analyser un champ lexical Quand on vous demande de relever un champ lexical, vous devez : - faire le relevé, - le présenter en une phrase, - mettre les mots entre guillemets. Pour analyser le relevé, il faut dire en quoi le lexique contribue à construire le sens du texte (mise en valeur d’un thème essentiel ou d’une idée dominante). CONSIGNE : Relevez et analysez le champ lexical dominant dans le texte. RÉPONSE : Dans ce texte, le champ lexical dominant est celui du froid. Il est constitué des mots et expressions suivants : ‘‘rude hiver, gela, de grandes neiges, ensevelit, la neige, la chute lente et entêtée des flocons, grelotter’’ [relevé]. Il permet de mettre en valeur l’hostilité des éléments naturels et doit être mis en relation avec la présentation du personnage : la fillette de neuf ans [analyse et effet produit]. 2. Analyser une figure de style et déterminer l’effet produit Tout relevé, toute analyse d’une figure de style ne sont jamais gratuits. Analyser une figure de style, c’est comprendre comment les mots sont associés ou opposés ou mis en valeur et indiquer en quoi cette figure de style éclaire le sens. Déterminer l’effet produit, c’est préciser les effets de sens qui construisent la signification du texte. CONSIGNE : Analysez la figure de style dans : ‘‘Le sang lui monta au visage, et ses yeux brillèrent comme ceux du chat sauvage.’’ Quel est l’effet produit ? RÉPONSE : La figure de style utilisée est une comparaison. Les yeux de Vautrin (élément comparé) sont mis en relation avec ceux d’un chat sauvage (élément comparant), à l’aide de l’outil de comparaison comme. L’élément commun est la sauvagerie [analyse]. Vautrin apparaît comme une bête sauvage effrayante, comme le champ lexical utilisé dans les phrases qui suivent : ‘‘il bondit ; il uploads/Management/ langue-francaise-lbbpp-m-tchoumi-1.pdf
Documents similaires
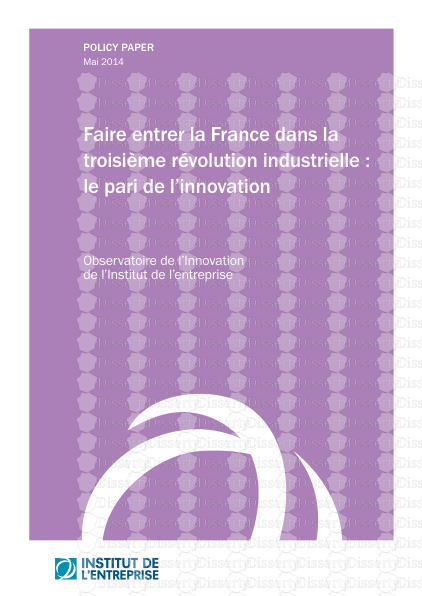









-
83
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 04, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.7242MB


