ISBN 978-2-02-129641-9 © Éditions du Seuil, septembre 2015 Le Code de la propri
ISBN 978-2-02-129641-9 © Éditions du Seuil, septembre 2015 Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. www.seuil.com À la mémoire de Jacques Le Goff (1924-2014) Un événement fondateur Le 13 octobre 1131 ne compte pas au nombre des « Trente journées qui ont fait la France », pour reprendre le titre d’une ancienne et célèbre collection d’ouvrages consacrés aux événements fondateurs de l’Histoire de France. C’est aujourd’hui une date oubliée, inconnue des livres scolaires et des manuels universitaires, et même ignorée de tous les médiévistes de profession. Et pourtant… Pourtant, ce jour-là le destin de la dynastie capétienne et de la monarchie française a pris une orientation nouvelle, totalement imprévue et réellement inquiétante. Alors qu’il chevauchait avec plusieurs compagnons dans un faubourg de Paris, le jeune prince Philippe, fils aîné du roi Louis VI le Gros, fit une grave chute de cheval et mourut quelques heures plus tard dans la maison où il avait été transporté. Il était âgé de presque 15 ans. Accourus aussitôt, le roi Louis, la reine Adélaïde, l’abbé de Saint-Denis Suger, plusieurs prélats et quelques barons assistèrent à son agonie. Aux dires des chroniqueurs, tous en éprouvèrent une douleur immense. En lui-même, l’événement n’a rien d’exceptionnel. Au Moyen Âge, les chutes de cheval mortelles sont fréquentes, et les fils de roi qui meurent dans leur adolescence ne sont pas rares. Mais plusieurs circonstances confèrent à ce fait divers une dimension peu ordinaire, très grave même pour la dynastie et le royaume. Tout d’abord le drame se produit à un moment où le pape Innocent II se trouve en France et s’apprête à ouvrir à Reims un concile général de l’Église, destiné à destituer l’antipape Anaclet II, qui a des partisans en Italie. Cette mort inattendue est de mauvais augure. En second lieu, le prince Philippe n’est pas seulement le fils aîné du roi de France. Il est lui aussi roi de France. Selon l’usage en vigueur chez les premiers rois capétiens, il avait en effet été nominalement associé au gouvernement du royaume dès l’âge de 3 ans, puis sacré et couronné roi à Reims neuf ans plus tard, le dimanche de Pâques 1129. Dès lors, tous les documents de la chancellerie royale le qualifient, très légitimement, de « roi désigné » (Philippus rex designatus) ou de « jeune roi » (Philippus rex junior). Cet usage consistant à associer au trône, du vivant du père, le fils aîné du souverain permettait aux premiers rois capétiens de transformer de facto la monarchie, encore plus ou moins élective, en une véritable institution héréditaire. Une telle pratique inaugurée par Hugues Capet peu après sa propre élection, en 987, dura presque deux siècles. Enfin, et surtout, le cheval n’est pas seul en cause dans l’accident. Un autre animal se trouve être à l’origine de la chute, un animal fort peu noble, sale, immonde, un animal vagabond, remplissant comme tous ses congénères vivant en zone urbaine un rôle d’éboueur : un cochon domestique ! C’est en effet un vulgaire porcus – que Suger, abbé de Saint-Denis et principal conseiller de Louis VI, qualifie de diabolicus dans son récit de l’événement1 – qui s’est jeté dans les pattes du cheval, faisant rouler celui-ci à terre et précipitant le cavalier sur une pierre. Le jeune roi Philippe, sacré et couronné depuis deux ans, a été tué par un cochon ! « Mort infâme », « mort ignoble », « mort honteuse », « mort misérable » écrivent les chroniqueurs au sujet de la disparition de ce prince qui offrait à la dynastie et au royaume les meilleures espérances. * Au XIIe siècle, la frontière zoologique qui sépare le porc domestique du porc sauvage est biologiquement perméable : à l’automne, les truies domestiques vont parfois frayer dans la forêt avec les sangliers. Les deux animaux sont conspécifiques et interféconds. La frontière symbolique, en revanche, est absolument imperméable. Pour la culture et les systèmes de valeurs de l’époque féodale, le sanglier ne se confond nullement avec le cochon de ferme. Le premier passe pour un animal vigoureux, courageux, que l’on a plaisir à chasser et à affronter, parfois au corps à corps. Le second, au contraire, est une bête vile et impure, symbole de saleté et de gloutonnerie. Mourir à la chasse en combattant un sanglier est une mort héroïque et glorieuse, une mort de chasseur et de guerrier, une mort de prince et de dynaste. De fait, plusieurs ducs et même quelques rois ont laissé ou laisseront (Philippe IV le Bel, par exemple, en 1314) leur vie en chassant le porc sauvage. Mourir dans un faubourg de Paris par la faute d’un simple pourceau est en revanche une mort honteuse, indigne d’un roi, fût-il un jeune homme de 15 ans associé au trône de son père. Par cette mort abjecte, qui aux yeux de certains contemporains apparaît comme une punition divine, la dynastie capétienne et la fonction monarchique semblent marquées d’une souillure indélébile, même si tout est rapidement fait pour l’effacer : l’abbé Suger fait enterrer le jeune prince à Saint-Denis, dans la nécropole royale, cinq jours après le drame ; une semaine plus tard, son frère cadet, le prince Louis, primitivement destiné à l’état ecclésiastique, est sacré et couronné roi à Reims, en plein concile, par le pape lui-même. Cela semble de bon augure. Mais est-ce suffisant pour effacer l’abominable souillure et atténuer ses conséquences ? Rien n’est moins sûr. Six ans plus tard, c’est ce même Louis – devenu Louis VII – qui monte sur le trône à la mort de son père et devient seul roi de France, fonction à laquelle il est mal préparé. Son très long règne (1137- 1180) est marqué par une suite de désordres et de désastres : piété excessive du souverain, tragique incendie de l’église de Vitry-en-Perthois2, échec de la deuxième croisade conduite par le roi lui-même, difficulté pour avoir un héritier mâle, divorce d’avec la reine Aliénor, remariage de celle-ci avec le futur roi d’Angleterre, guerres stériles du roi de France contre ce dernier. Assurément, du point de vue politique et dynastique, le règne interminable de Louis VII est un des plus malheureux de l’histoire de France. * En ce 13 octobre 1131, par la faute d’un simple cochon girovague, le destin du royaume a donc basculé dans le drame. L’historiographie s’en est longtemps souvenue puisque la mort du jeune Philippe est rapportée par la plupart des annales médiévales puis par de nombreuses histoires de France imprimées jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Il faut attendre les ouvrages de la seconde moitié du XIXe siècle – notamment la grande Histoire de France d’Ernest Lavisse3 – pour que cet événement aux conséquences multiples soit totalement passé sous silence. L’histoire savante et positiviste alors en vigueur ne veut plus s’encombrer d’un animal aussi trivial, fût-il l’instrument du destin. À ses yeux, les animaux – particulièrement ceux de la ferme – n’ont rien à faire sous la plume des historiens. Le porc régicide, qui avait infléchi le cours de la grande Histoire, fut donc, dans un premier temps, abandonné à la « petite histoire » et aux recueils d’anecdotes, puis, peu à peu, totalement oublié. Aujourd’hui l’attitude des historiens vis-à-vis des animaux a changé. Grâce aux travaux pionniers de quelques-uns, et grâce à la collaboration de plus en plus fréquente avec des chercheurs venus d’autres horizons (anthropologues, ethnologues, linguistes, zoologues), l’animal est enfin devenu un objet d’histoire à part entière. Son étude se situe même souvent à la pointe de la recherche et au carrefour de nombreuses disciplines. Envisagé dans ses rapports avec l’homme, l’animal touche en effet à tous les grands dossiers de l’histoire sociale, économique, matérielle, juridique, religieuse, culturelle. Il est présent partout, à toutes époques, en toutes circonstances, et pose toujours à l’historien des questions essentielles, nombreuses et complexes. Le présent livre s’inscrit dans le prolongement des travaux que je consacre depuis près d’un demi-siècle à l’histoire de ces rapports entre l’homme et l’animal. Après avoir exposé les événements de 1131 et leurs prolongements, je souhaiterais rendre à ce porc régicide la place qui lui revient sur le devant de la scène historique : la première. Je souhaiterais également m’interroger sur les notions de pur et d’impur à l’époque féodale. Pourquoi certains animaux sont-ils rangés dans le bestiaire du Christ et d’autres dans celui du Diable ? Pourquoi le porc, qui entretient avec l’être humain un étroit cousinage biologique, est-il une bête impure ? Je souhaiterais enfin montrer comment la chute de cheval d’un jeune prince capétien à l’automne 1131 n’appartient pas seulement à l’histoire dynastique et politique ; elle relève aussi et surtout de l’histoire symbolique. La souillure causée par le porcus diabolicus est telle qu’elle ne pourra être effacée par la monarchie uploads/Litterature/ le-roi-tue-par-un-cochon-une-mort-infa-me-aux-origines-des-emble-mes-de-la-france-pdfdrive.pdf
Documents similaires

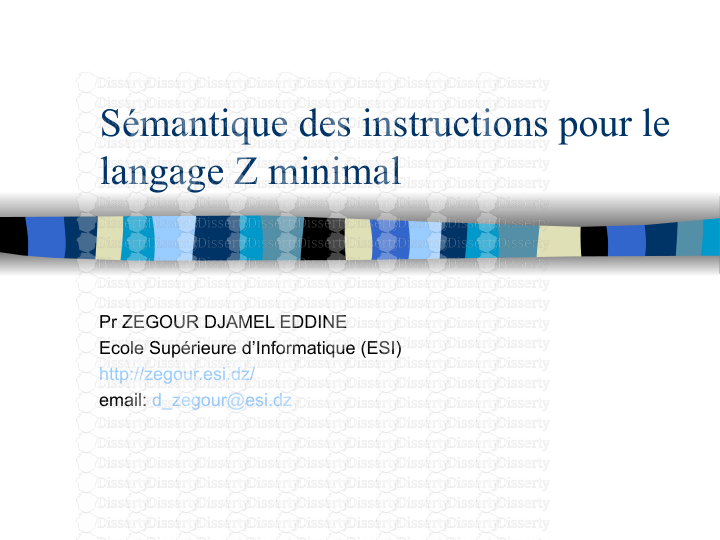








-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 14, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 8.0765MB


