l A Monsieur M. de Zayas en témoignage de mon amitié reconnaissante C(}.f,LEClI
l A Monsieur M. de Zayas en témoignage de mon amitié reconnaissante C(}.f,LEClIelN.J -LEBÈGUE JEAN CAPART Directeur de la Fondation Égyptologlque Reine Élisabeth Conservateur en chef honoraire des Musées Royaux d'Art et d'HJstolre JE LIS LES HIÉROGLYPHES 7 me Série - N0 74 OFFICE DE PUBLICITÉ, S. C. ANO. ÉTAJlL.J. LEBÈGUE & CIO, ÉDITEURS 36. rue Neuve. Bruxelles 1946 l' ! ri DU M1tME AUTEUR: Le MM8G{1ede la Viei& Él11IPte (Collection Lebèll"Oe. n· 1) La BeauU. él11lPlienne (CollectIon Lobègue. nO 10) Tous droits réservés pour lous pays Hiéroglyphes, notation de la langue égyptienne. Littré nous dit : « Ce sont des hiéroglyphes· pour moi,· c'est-à-dire c'est une chose à laquelle je ne comprends rien 1» Et cependant, une longue familiarité avec les hiéro- glyphes, familiarité qui remonte presque à mon enfance, me donne l'illusion de croire que les hiéroglyphes n'ont plus de secrets et que je pourrais en donner une explication même aux personnes qui ne savent pas un mot de la langue égyptien~e. « Hiéroglyphe (du grec hiéros, sacré, et gluphein, graver): nom donné par les Grecs aux caractères qu'ils voyaient gravés sur les murs des monuments de l'Égypte et qui servaient aux Égyptiens à écrire les mots de leur langue. » (Larousse). J'ai soutigné : écrire les mots de leur langue, car il est essentiel que dès le début le lecteur puisse se convaincre que les hiéroglyphes sont étroitement liés à la langue égyptienne et non pas, comme on le croit volontiers, à des idées qui pourraient se traduire en n'importe quelle langue. Si je vois au-dessus de la porte d'une auberge un tableau représentant. un cheval blanc, je puis lire cette inscription: « Au Cheval Blanc» ou « In het Witte Paard », ou « In the White Borse », etc. Si les hiéroglyphes égyptiens, à une époque très lointaine, que nous n'atteindrons jamais sans doute, ont été une pictographie de l'espèce, ils avaient de bonne heure subi une complète évolution dans laquelle seules des traces de ce stade primitif se sont maintenues, à côté des innombrables signes phonétiques. Écriture sans voyelles. Mais il faut dès maintenant aussi que je marque un caractère surprenant de cette écriture des mots de la langue égyptienne; jamais on n'y trouve la notation des voyelles, 1 l -6- c'est-à-dire de ces sons qui donnent aux langues leur couleur la plus caractéristique : les hiéroglyphes sont pour nous sans vocalisation, et c'est bien fâcheux. Qu'arriverait-il si, par miracle, on ressuscitait une momie? Les paroles qu'elle prononcerait auraient toutes chances de n'être pas comprises même par l'égyptologue le plus savant en philologie pharaonique. Et vraiment celui-ci serait bien embarrassé de dire quelque chose à notre Égyp- tien vivant. Ils se trouveraient l'un en face de l'autre, un peu comme des sourds, incapables de donner un sens aux sons prononcés; mais ils auraient la ressource immédiate de recourir à l'écriture et je crois qu'alors la communication pourrait être aisément rétablie. On peut imaginer ce qu'aurait de pittoresque cette reprise dans l'échange des idées après dix-huit cents ans d'interruption dans l'emploi du système. En effet, les hiéroglyphes égyptiens ont cessé d'être pratiquement en usage au me siècle de notre ère. Mais pourquoi, dira-t-on, les Égyptiens n'écrivaient-ils que les articulations consonantiques de leur langue, sans tenir compte des voyelles? Celles-ci sont essentielles dans nos langues indo-européennes. Si j'écris P.1. r cela ne peut éveiller en mon esprit aucune idée précise parce que le même squelette s'adapte à des mots multiples qui n'ont rien de commun comme idées: pâlir, polir,. peler, piler, épeler, épiler, plier, pâleur, et bien d'autres. Si dans une transcription rapide, quasi sténographique, j'ai noté seule- ment p.l.r, le contexte seul peut me permettre de rétablir les voyelles en devinant le mot exact. Il n'en va pas de même dans des langues appartenant à d'autres familles, en hébreu,en arabe, en égyptien, etc. Tout le monde a vu des exemplaires de la bible hébraïque. Les lettres sont accompagnées, au-dessus et en dessous, de petits points, de petites lignes : ce sont les voyelles. Nous avons là le résultat des longs travaux des savants juifs appelés massorètes, « maîtres de la tradition J) et ',' " -7- dont le point culminant est le texte du Rabbi Aaron ben Asher qui vivait. au xe sièCle de notre ère. Le travail des massorètes avait pour objet de conserver, de transmettre le texte consonantique des livres sacrés, ma,is aussi d'en assurer l'exacte prononciation. Sans les massorètes noU3 serions, devant un texte hébraïque, dans la même situatioI\. que devant des hiéroglyphes, ces signes reproduisant uni- quement la structure consonantiqùe des mots. Radicaux consonantiques. Quelle est la raison de cet état de choses bizarre à pre- mière vue? C'est que les« squelettes» de mots représentent des radicaux, très souvent trilittères, c'est-à-dire à trois consonnes et qui expriment chacun une idée fondamentale, dont toutes les variations possibles se marqueront précisé- ment par les vocalisations différentes. Soit un radical verbal comme q.LI en hébreu; celui-ci va pouvoir par un jeu des voyelles, par la réduplication des consonnes, par l'adjonction d'affixes et de. suffixes exprimer tous les temps, tous les modes d'une extrême richesse du verbe tuer. Si je prends le radical k.t. b en arabe, celui-ci me donne l'idée fondamentale d'écrire, katab, et je dirai: yiktib, j'écris; kitdb, livre et koutoub, livres; koutlJi, libraire; kateb, scribe; koutab, école; maktoub, inscription, etc. En égyptien, le radical ss qui s'écrit par le signe fidlsigni- fiera: la palette du scribe, le verbe écrire, l'écrit, le docu- ment, la peinture, la lettre, le livre, le scribe, le papier à écrire, le bâtonnet d'encre... Consonnes et voyelles. Il est bon que je dise, dès maintenant, puisque je me suis lancé dans ces arcanes philologiques, au risque d'effrayer le lecteur auquel je demande un peu de patience, que la distinction qui vient d'être faite ici entre les consonn'es et les voyelles n'est pas aussi tranchée qu'on pourrait le croire. -8- Il Ya un petit nombre de sons qui, suivant les circonstances, peuvent être considérés soit comme des consonnes, soit comme des voyelles; on les appelle des semi-voyelles ou aussi des consonnes faibles. On va les rencontrer constam- ment dans les hiéroglyphes et leur existence a donné lieu pendant longtemps à de savantes controverses entre ceux qui affirmaient· que l'écriture égyptienne ne contenait que des consonnes et ceux qui, au contraire, déclaraient avec force arguments, qu'elle notait également les voyelles a, a, i et u. On est généralement d'accord pour admettre la base consonantique du système mais à condition d'adopter pour ces consonnes qui ressemblent parfois à des voyelles, des signes particuliers qu'il est indispensable de retenir. ~ est transcrit 1 et correspond à une « occlusive laryn- gale » (l'attaque dure d'une voyelle); en pratique nous lisons le plus souvent a léger. Q est transcrit i ou 1'. Pensez au prénom Jean, en flamand Jan, qui présente à l'attaque un i ou un i. -li est transcrit r. C'est un son guttural très particulier (une spirante laryngale sonore) inconnu à nos langues, correspondant au raiin arabe. On le transcrit souvent par a, un a long. .} (un oiseau d'espèce indéterminée, appelé parfois le «POtlSsin» des hiéroglyphes) est transcrit w. Pensez au mot ouate et demandez-vous si le son d'attaque est un w con- sonne ou une voyelle u qui doit être pourtant prononcée ou comme en latin et en italien. Voilà un point des plus important déblayé et le lecteur ne s'effraiera pas, j'espère, lorsque je devrai transcrire des mots égyptiens avec ces signes: par exemple imn pour Amon, ou même rI pour le mot égyptien qui signifie grand. Un autre mot pour grand est wr qui est prononcé en pratique our. -9- Alphabet. Mais, dira-t-on, quelle chose étrange que ces signes, représentant des hommes, des animaux, des objets de toute espèce, et qui cependant se bornent, le plus souvent, à figurer les sons de la langue. Nous nous servons pour écrire d'un petit nombre de signes qui sont nos lettres et que nous appelons, dans leur ensemble, l'alphabet. Qu'est.:ce que cela signifie? Ouvrons Larousse. Alphabet: Réunion de toutes les lettres d'une langue, disposées dans un ordre conventionnel. Petit livre contenant les lettres et les élé- ments de la lecture: Mettre un Alphabet entrfJJles mains d'un enfant. c( Disposées dans un ordre conventionnel », n'est peut-être pas très exact et il faudrait dire plutôt « traditionnel », car là où l'alphabet hébreu dit Yod, Khaf, Lamed, Mem, Noun, nous disons encore 1 et J, K, L, M, N. Il ya eu entre les deux Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu... Mais tout le monde sait aussi que le mot alphabet est la combinaison des deux premières lettres de l'alphabet grec Alpha et Bêta. Oui; mais Alpha ni Bêta n'ont de sens dans la langue grecque, sinon comme désignation de ces deux lettres. Alors il nous faut remonter plus haut et nous rappeler le héros légendaire Cadmus qui fut l'auteur de cette écriture qu'on appelait lettres cadméennes ou phéniciennes, parce qu'elle avait été empruntée au· peuple maritime et commerçant des cÔtes uploads/Litterature/ je-lis-les-hieroglyphes.pdf
Documents similaires






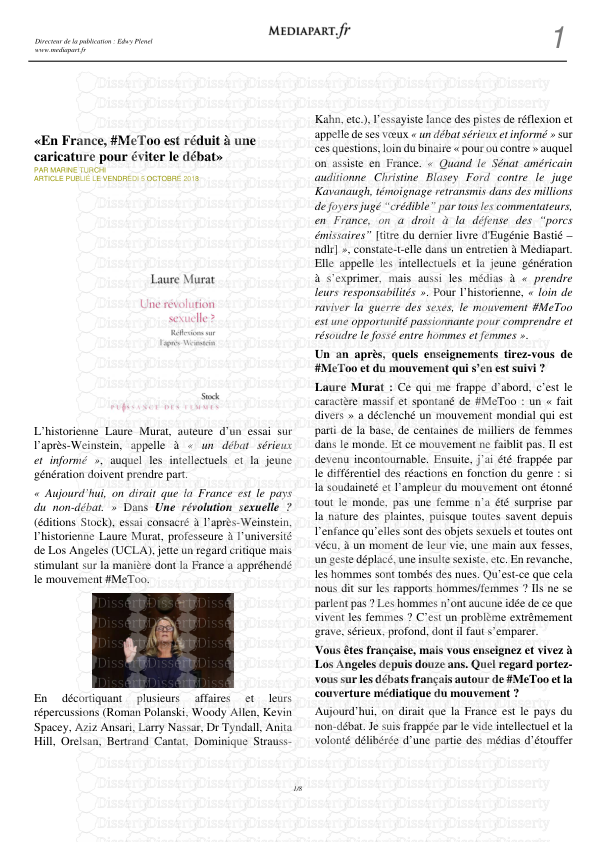



-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 07, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 25.7664MB


