183 RICHARD KEARNEY ECRIRE LA CHAIR : L’EXPRESSION DIACRITIQUE CHEZ MERLEAU-PON
183 RICHARD KEARNEY ECRIRE LA CHAIR : L’EXPRESSION DIACRITIQUE CHEZ MERLEAU-PONTY « Je voudrais », me dit (Merleau) un jour, « écrire un roman sur moi ». « Pourquoi pas », demandai-je, « une autobiographie ? » « Il y a trop de questions sans réponses. Dans un roman, je pourrais leur donner des solutions imaginaires. Que ce recours à l’imagination ne trompe pas : je rappelle ici le rôle que la phénoménologie lui attribue dans le mouvement complexe qui s’achève par l’intuition d’une essence ». Jean-Paul Sartre, « Merleau-Ponty vivant »1 Pour Merleau-Ponty il existe plusieurs niveaux d’expression allant de la perception et de la parole jusqu’à la peinture, la poésie et la pensée. Chacun de ces niveaux représente une manière singulière d’exprimer la chair – de faire sens en faisant du sens à partir des sens, partant du plus vécu jusqu’au plus philsophique. Mon hypothèse ici est que toutes ces formes d’expression partagent une certaine fonction « diacritique » – une fonction qui est, sinon langage, au moins structurée comme un langage (même si c’est avant le langage parlé ou écrit). Autrement dit, le sens se trouve là où l’expression diacritique croise l’expérience de la chair. C’est précisément ce croisement que Merleau-Ponty analyse dans certains de ses cours des années cinquante au Collège de France sous le mot « diacritique » et qu’il nomme ensuite (parmi d’autres termes), « l’entrelacs du chiasme » dans la quatrième partie du Visible et l’invisible. Autour de ce dernier, Merleau- Ponty nous révèle que l’expression diacritique se compose à travers des écarts – nommés librement, négativités, brèches, plis, latences, absences, silences, césures, lacunes, secrets, vides, creux, sillons, sillages, blancs, invaginations, abîmes, élisions. Et il prétend que ces écarts font partie d’une ontologie négative. Autrement dit, l’expression diacritique est toujours « indirecte » tout comme l’ontologie qui la fonde et l’alimente. « On ne peut faire de l’ontologie directe », affi rme Merleau-Ponty. « Ma méthode ‘indirecte’ (l’être dans les étants) est seule conforme à l’être – philosophie négative comme ‘théologie négative’… le ‘monde invisible’ – le non-être dans l’être-objet : le Seyn »2. C’est précisément cet « être » négatif et indirect qui s’exprime à travers la « texture charnelle » de nos expériences – une texture qui, précise-t-il, nous « présente l’absente de toute chair ; c’est un sillage qui se trace magiquement sous nos yeux, sans aucun traceur, un certain creux, un certain dedans, une certaine absence, une négativité qui n’est pas rien »3. Soyons clair : la phénoménologie du langage, pratiquée par Merleau- Ponty, n’est pas une déconstruction du langage, ni une sémiotique en tant 184 que simple technique linguistique des signes. La phénoménologie des signes, pour Merleau-Ponty, reste toujours fi dèle à la chair, à une certaine présence incarnée qu’on ne trouve ni chez les déconstructionnistes (tel Derrida) ni chez les structuralistes (tels Saussure ou Lévi-Strauss – avec qui Merleau-Ponty dialoguait dans son œuvre tardive). Mon texte se déroulera en deux temps. D’abord j’essayerai d’expliquer ce que Merleau-Ponty veut dire exactement quand il parle de « l’expression diacritique ». Ensuite, je m’interrogerai sur l’écriture littéraire comme chassé- croisé entre la peinture et la pensée – c’est-à-dire comme « langage indirect » ou « voix du silence». I. Qu’est-ce alors que l’expression diacritique? Merleau-Ponty développe ce terme dans ses cours au Collège de France dans des années cinquante. Ici je me limiterai surtout au cours intitulé Le Monde sensible et le monde de l’expression, prononcé en 1953, juste après la publication de son essai majeur « Le langage indirect et les voix du silence » (paru en deux parties dans Les Temps Modernes, juin-juillet, 1952)4. Ce dernier était déjà une élaboration d’une version antérieure de l’essai qui s’intitulait simplement, « Le langage indirect », contenu dans son manuscrit La Prose du monde (inédit pendant sa vie) – projet qu’il avait envisagé en grande partie comme réponse au texte de Sartre, Qu’est-ce que la littérature? (1947). Tandis que Sartre avait opposé « prose » et « poésie » d’une façon binaire et idéologique, Merleau-Ponty s’efforce de montrer comment ces deux genres se croisent dans l’écriture littéraire. En 1948-49 (comme nous l’explique Claude Lefort), Merleau-Ponty avait fait un résumé critique assez détaillé du texte polémique de Sartre pendant qu’il préparait La Prose du monde. Il écrit : « Il faut que je fasse une espèce de ‘Qu’est-ce que la littérature?’ avec une section plus longue sur le signe et la prose, pas toute une dialectique de la littérature, mais cinq études littéraires : Montaigne, Stendhal, Proust, Breton, Artaud »5 ; et il laisse comprendre que ces études seraient elles-mêmes un pas vers un ouvrage plus développé – en quelques volumes – qui aurait pour tâche d’appliquer ses nouvelles catégories de prose-poésie à des lectures 1) de la littérature, 2) de l’amour, 3) de la religion et 4) de la politique. Ainsi on trouve déjà une ébauche d’un nouveau modèle d’expression qui marierait l’imaginaire et le réel, la perception et la signifi cation, la « poésie » et la « prose » (alors que Sartre les opposaient). Il est à noter, en passant, que le terme diacritique n’est pas utilisé dans la première ébauche du « Langage indirect », mais seulement dans la deuxième (apparue dans Les Temps modernes en 1952), après qu’il ait décidé d’appliquer certaines idées de la linguistique Saussurienne à la phénoménologie de Husserl et de Sartre. (Heidegger, bizarrement, n’y fi gure pas. Bien qu’avec 185 le « ventriloquisme » célèbre de Merleau-Ponty, on ne sait jamais si sa voix silencieuse ne résonne pas entre les lignes). Alors comment comprendre ce mot « diacritique » ? Réinterprétant Saussure, Merleau-Ponty utilise ce terme en se référant à la perception autant qu’à l’expression. Selon lui, l’un n’existe pas sans l’autre. Ce qui m’intéresse surtout ici c’est de voir comment la structure diacritique fonctionne dans ce que Merleau-Ponty nomme « les arts du langage » – autrement dit, dans les signes indirects et les voix silencieuses (1952), ou plus précisément dans l’écriture littéraire. Comme nous l’avons déjà signalé, on trouve dans le cours de 1953, Le Monde sensible et le monde de l’expression, certaines formulations fort révélatrices du terme diacritique. Donc je propose de commencer par quelques mots sur ce texte peu connu de 1953 (récemment rédigé par Emmanuel de Saint Aubert) avant de revenir au texte plus célèbre de 1952. Voici un passage clef du cours de 1953 – note intitulée, « Conception diacritique du signe perceptif » – c’est l’idée qu’on peut percevoir des différences sans termes, des écarts par rapport à un niveau qui lui-même n’est pas objet – seul moyen de donner de la perception une conscience qui lui soit fi dèle et qui ne transforme pas le perçu en ob-jet, en sa signifi cation dans l’attitude isolante ou réfl exive6. Merleau-Ponty interprète la perception ici comme témoin d’un écart fondamental dans notre expérience sensible en tant qu’expression implicite. Et ceci faisant, il transforme l’idée centrale de Saussure que chaque mot ne signifi e quelque chose que par sa différence avec les autres, car son sens n’est jamais compris isolément, mais toujours porté « en sursis » dans les plis de la « différenciation d’un mouvement global de communication »7. Merleau- Ponty développe cette thèse centrale de Saussure en montrant que si « la langue parlée ou vivante » exprime un sens relatif vis-à-vis de la langue, la perception elle-même fonctionne elle aussi comme « écart ». Bien qu’il ait déjà mentionné cette idée brièvement dans son cours de 1950, « La conscience et l’acquisition du langage », c’est dans le cours de 1953 que cette idée trouve une explication plus détaillée. Dans une note de travail intitulée, « Perception diacritique », il précise : Percevoir une physionomie, une expression, c’est toujours user de signes diacritiques, de même que réaliser avec un corps une gesticulation expressive. Ici chaque signe n’a d’autre valeur que de le différencier des autres, et des différences apparaissent pour le spectateur ou sont utilisées par le sujet parlant qui ne sont pas défi nies par les termes entre lesquels elles ont lieu, mais qui au contraire les défi nissent8. Emmanuel de Saint Aubert contraste cette idée de percevoir diacritiquement par différentiation avec l’idée classique de percevoir par l’identité : 186 La logique perceptive est étrangère à l’approche classique de la différence sur fond d’identité. L’identité des termes se dessine dans la tension de leurs différences, les contours émergent de l’empiètement des choses. Merleau-Ponty sort du cadre épistémologique de la défi nition aristotélicienne, typique de la démarche rétrospective de l’intelligence projective : le défi ni toujours défi ni sur fond de la positivité préalable d’un genre au sein duquel se dessine la différence spécifi que. La conscience d’écart révèle enfi n combien le mythe du face à face de la conscience et de l’objet est une illusion rétrospective : il n’y a jamais un objet, mais toujours plusieurs choses – ne serait-ce que la fi gure et le fond, avec la possibilité et même l’imminence uploads/Ingenierie_Lourd/ ecrire-la-chair.pdf
Documents similaires






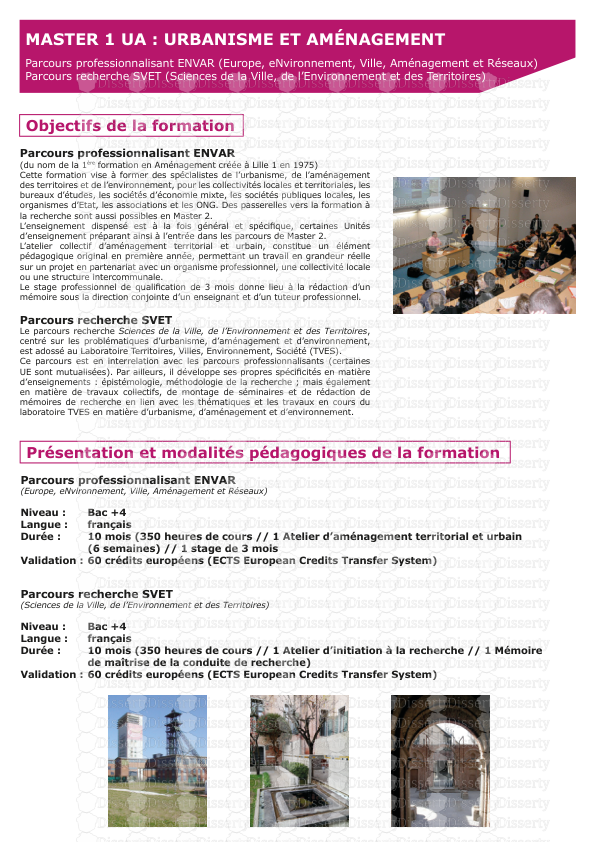



-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 02, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1521MB


