DU MÊME TRADUCTEUR HEGEI, L'esprit du chrßtianísme et son destin, traduction, p
DU MÊME TRADUCTEUR HEGEI, L'esprit du chrßtianísme et son destin, traduction, présentation etnotes, Paris, Pocket, 1992. Scueltmc, Introduction à l'Esqußse d'un système de philosophie de la nature, traduction, présentation et notes (en collaboration avec Emmanuel Renault), Paris, Le Liwe de Poche,200l. Fichte et Hegel. La reconnaissance, Paris, P.U.F., 1999. Du commencement en philosophie. Étud" srr Hegel et Schelling,Pans, Vrin, 1999. Fondement du droit naturel. Fichte, Paris, Ellipses, 2000. L'être et I'acte. Enquête sur les fondements de I'ontologie moderne de I' agir, P ans, Y nrt, 2002. La production des hommes. Marx avec Spínoza, Paris, P'U.F-, 2005. TEXTES & COMMENTAIRES Directeur : Jean-François CounrrNp MARX MANUSCRITS ECONOMTCO-PHTLOSOPHTQUES DE 1844 Traduits présentés et annotés par Franck FISCHBACH PARIS LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. VRIN 6, Place de la Sorbonne, Ve 2007 116 MANUSCRTTsÉcoNoMlco-pHrt-osopHteuEsDE 1844 [Tnavarl ar-lÉNÉ er pRopRrÉre rnrvÉe] x¡I ,l lNous sommes partis des présuppositions de l'économie nationale. Nous avons accepté sa langue et ses lois. Nous avons admis la propriété privée. la séparation entre le travail, Ie capital et la terre autant que celle entre le salaire du travail, le profit du capital et la rente foncière, de même Ia séparation du travail, Ia concurrence, le concept de la valeur 'échange, etc. A partir de l'économie nationale elle-même, dans les sont les nous avons montré que le travailleur est ¡ahaissé de et de la marchandise Ia plus misérable, que la du travailleur est en rapport inverse de la purssance et de la grandeur sa production, que le résultat nécessaire de la concurrence est I'accumu_ du capital en un petit nombre de mains. et ainsi Ie plus terrible réta_ blissement du monopole, et que finalement la différence entre le capitaliste et le propriétaire foncier, comme celle entre le paysan et I'ouvrier de manufacture disparaît en même temps que la société entière doit se diviser entre les deux classes des-tro,et¡lleurs¿an A part du fait de la propriéré privée. Elle ne nous é l'explique pas. Elle perçoi le matériel de la propriété privée que - processus celle-ci parcourt dans la réalité et elle I'exprime en fomules-géaéraþs, aÞstraitçs qui valent ensuite pour elle en tant queJoit Elle ne c onç_o it' .pas ces lois, c'est-à-dire qu'elle nemontrepas commentces lois proviennent de I'essence de la propriété privée. L'économie nationale ne nous donne aucune explication quant à la raison de la séparation du travail et du capital, du capital et de la tene. par exemple, lorsqu'elle détermine le rapport du salaire du travail au profit du capital (364), vaut pour elle comme raison ultime I'intérêt p,ropriétrires,. I fL' éc onomi e n ati on ale 'L7n,4) du capitaliste; ce qui signifie qu'elle suppose cela même PREMIERcAHIER-TRAVAILALTÉ¡¡ÉerpnopnrÉrÉpnrvÉB l1'l ence s'insinue de Partout' Elle eures. Quant à savoir dans s, aPparemment contingentes' nt nécessaire: là-dessus' l'éco- us avons vu de quelle manière n fait contingent' [P'511] Les , mette en mouvement sont la es, Ia concurrence' onale ne conçoit Pas I'enchaî- exemPle Pas oPPoser la théorie delaconcurrenceàcelledumonopole'lathéoriedelalibe*édumétierà celle de la corporation, la théorie àe la divisiõíde la propriété foncière-à ,.tt" O" t" grunde propriété foncière, parce que la concurrence' la liberté du m¿ti", "t îa ¿ivision de la propriété foncière n'étaient développées et ;;"ç*t que comme aes consequences contingentes' intentionnelles' im- porå", pár la violence et non pL to-tnt des conséquences nécessaires' inévitables et naturelles du moìopole' de la corporation et de la propriété lr r I nel, comme le fait ir une exPlication' Un tel état originel n'explique rien. Il déplace seulement grii et nébuleux. Il admet sous la forme d'une ient cela même qu'il doit déduire, à savoir le r tre la division du travail I'origine du mal par le péché originel' ce qui signifie fait'ious une forme hiitorique' cela même qu'il doit expliquer. I Nous pa¡tons d'un fait national-écono a Le tavatlleur devient d'autant plu mondedeschoses s'accroît { de I'homme. Le travail ne Produit lui-même ainsi que le 118 MANUSCRITS ECONOMI CO-PHII-OSOPHIQUES DE 1844 PREIVIIER CAIIIER - TRTq.VAIL ALIÉNÉ ¡T PNOPN¡ÉTÉ TruVÉE 1 1 9 lA( Le t¡avaltleur ne peut rien engendrer sans la tuûure' sans le monde îxtérieur sensible. Cedernier est le matériau à même lequel son travail se réalise, dans lequel son travail esf actif, à partir duquel et au moyen duquel ilproduir ) li vrui, ¿" même que la nature offre au travail son moyen de subsistance, uí ,"n, où le travail ne peut pas suåsist¿r sans des objets à même lesquels il -est exercé (366) tp.5l3l, de même [a nature offre-t-elle aussi d'autre part urt moyen de subsistance, au sens plus étroit du moyen de la subsistance physiquedurravailleurlui-même. s,d¡ "ì..¿';. .,;¡ i¡' o" sorte que plus le travailleur s'ai2prctiiie par son travail le monde extérieur, la nature sensible, et plus il se soustrait de moyen de subsistance, et cela sous un double aspect: premièrement, en ce que le monde extérieur sensible cesse de plus en plus d'être un objet appartenant à son travail' un moyen de subsistance deìon ravail ; deuxièmement, en ce que le même ,nond" extérieur sensible cesse de plus en plus d'être un moyen de subsistance au sens immédiat, à savoir au sens d'un moyen en vue de la 120 MANUSCRITS ÉCONOMICO.PHILOSOPHIQUES DE I844 ì Q O PREMIER CAHIER _ TRAVATL ALIÉNÉ ET PROPRIÉTÉ PP¡VÉE 121 n'est pas son travail propre, mais lejlIavgi!!_Un-a¡Íre, en ceci qu'il ne lui appartient pas, en ceci qu'en lui il ne s'appaftient pas à lui-même mais appartient à un aufie. De même que, dans la religion, I'autoactivité de _ I'imagination humaine, du cerveau humain et du cæur humain agit ì, indépendamment de I'individu, c'est-à-dire agit sur lui comme une activité étrangère, en tant qu'activité divine ou diabolique, de même I'activité du travailleur n'est-elle pas son autoactivité. Elle appartient à un autre, elle est I lapertede soi-même. f 12 Nous en arrivons ainsi au résultat que I'homme (le travailleur) ne se sente plus comme librement actif que dans ses fonctions animales (manger, boire et procréer, tout au plus encore dans I'habitation, la parure, etc.), [p.515] et qu'il ne se sente plus qu'animal dans ses fonctions humaines. L'animal devient I'humain et I' humain devient I' animal. J1 Manger, Fplre et procréer, etc., sont certes également des fonctions véritablemendhumaines. Mais, dans I'abstraction qui les sépare du reste du cercle (368) de I'activité humaine et qui en fait les derniers et uniques buts fìnaux, elles sont animales. .ly' Nous avons considéré l'acfe de I'aliénation de I'activité pratique humaine, c'est-à-dire du travail, sous deux aspects. 1) Le rapport du travail- leur au produit du travail comme à un objet étranger et ayant barre sur lui. Ce rapport est en même temps le rapport au monde extérieur sensible, aux objets naturels comme à un monde étranger se tenant face à lui de manière hostile. 2) Le rappolt du travail à l' acte de la production, à l'infé.rieur du travail. Ce rapport est le rapport du travailleur à sa propre activité comme à une activité étrangère. ne lui appartenant pas: c'est I'activité comme souffrance, la force comme impuissance, la procréation comme castration. Lapropre énergie physique et spirituelle du travailleur, sa vie personnelle - car qu'est-ce que la vie, sinon I'activité? - comme une activité tournée contre lui-même, indépendante de lui, ne lui appartenant pas.L'aliénation desoi,comme,pl io^<, . í | Nous avons entes une détermination du irl.L't^' = ?/ L'homme est füäh¿Jì pour objet sien, de façon pratique et théorique, le genre - aussi bien le sien propre que celui des autres choses -, mais aussi - et cela n'est qu'une autre expression pour la même chose - en ce qu'il se rapporte à lui-même comme au genre présent et vivant, en ce qu'il se rapporte à soi comme à un être univ e rs e I ef donc libre. --7 Lavie générique, aussi bien chez I'homme que chez I'animal, consiste d'abord physiquement en ceci que I'homme (comme I'animal) vit de la 122 MANUscRlrs Écolotr¡lco-pgtlosopHleuEs DE I8,14 flâtUr€ non org¡nirlre, et I'homme étant olus oue I'animal d'autant plus universelle est la région de la nature non organioue dont vit I'homme. De même que les plantes, les animaux, les pierres, I'air, la lumière, etc., constituent au plan théorique une partie de la conscience humaine, pour uneparten tantqu'objets de la science de Ia nature, pour une autre part en tant qu'objets de I'art - ce sont là sa nature non organ_Klue soirituelle- qu'il lui faut lui-même apprêter en même ils constituent au plan pratique une partie de Ia vie humaine et de l'activité humaine. Physiquement, I'homme ne vit que de ces produits de la nature, qu,ils apparaissent maintenant sous la forme de la nourriture, du chauffage, de I'habillement, de I'habitation, etc.Ilniversalité de &amne apparaît [p. s16] de faço4_lfatique oréci sémEnt dans I I u rii versalité qui fait de la netttre entière son corls non organiqLl,, aussi bien dans la mesure où la nature est 1) un moyen de subsistance immédiat, que dans la mesure où elle la matière et I'outil de son activité viøle. La nature est le corps organique de I'homme - où il faut entendre la nature dans la ses moyens de uploads/Industriel/ 14-marx-travail-aliene-et-propriete-privee.pdf
Documents similaires




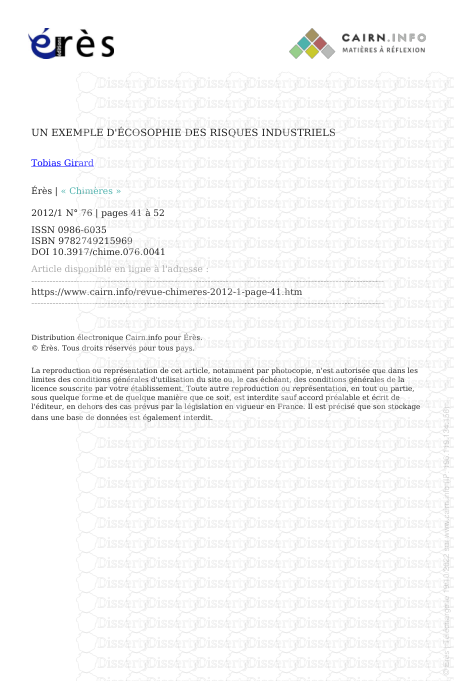





-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 04, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9935MB


