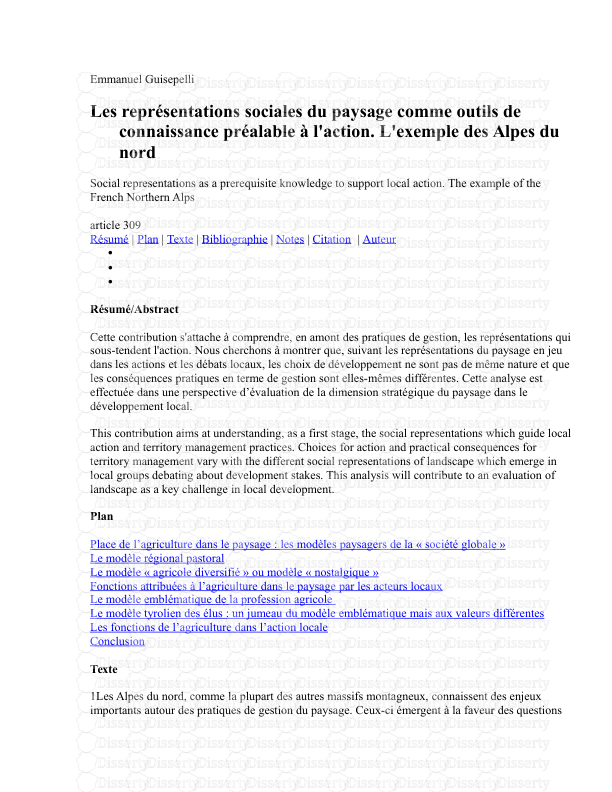Emmanuel Guisepelli Les représentations sociales du paysage comme outils de con
Emmanuel Guisepelli Les représentations sociales du paysage comme outils de connaissance préalable à l'action. L'exemple des Alpes du nord Social representations as a prerequisite knowledge to support local action. The example of the French Northern Alps article 309 Résumé | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur Résumé/Abstract Cette contribution s'attache à comprendre, en amont des pratiques de gestion, les représentations qui sous-tendent l'action. Nous cherchons à montrer que, suivant les représentations du paysage en jeu dans les actions et les débats locaux, les choix de développement ne sont pas de même nature et que les conséquences pratiques en terme de gestion sont elles-mêmes différentes. Cette analyse est effectuée dans une perspective d’évaluation de la dimension stratégique du paysage dans le développement local. This contribution aims at understanding, as a first stage, the social representations which guide local action and territory management practices. Choices for action and practical consequences for territory management vary with the different social representations of landscape which emerge in local groups debating about development stakes. This analysis will contribute to an evaluation of landscape as a key challenge in local development. Plan Place de l’agriculture dans le paysage : les modèles paysagers de la « société globale » Le modèle régional pastoral Le modèle « agricole diversifié » ou modèle « nostalgique » Fonctions attribuées à l’agriculture dans le paysage par les acteurs locaux Le modèle emblématique de la profession agricole Le modèle tyrolien des élus : un jumeau du modèle emblématique mais aux valeurs différentes Les fonctions de l’agriculture dans l’action locale Conclusion Texte 1Les Alpes du nord, comme la plupart des autres massifs montagneux, connaissent des enjeux importants autour des pratiques de gestion du paysage. Ceux-ci émergent à la faveur des questions de développement durable où le « local »1 intervient comme une échelle de décision grandissante en induisant un partenariat accru entre des acteurs de plus en plus diversifiés. 1 Le local désigne ici des structures intercommunales constituées ou en voie de l’être. 2Dans cette perspective, le paysage, à l’interface entre Nature et Société (BERTRAND, 1995), semble être un objet de discussion privilégié pour cristalliser – au moins en partie – les enjeux sociaux, économiques et environnementaux que la notion de développement durable met en cohérence par principe. On constate en effet, dans les enquêtes auprès de différents acteurs et dans les projets locaux d’aménagement ou de développement, que le paysage ressort comme une préoccupation centrale et passe pour être un objet fédérateur de l’action locale parce qu’il permet de mobiliser les intérêts d’acteurs variés. 3Pourtant, dans les débats locaux, l'acception donnée au terme de paysage a souvent tendance, sans définition collective préalable, à intéresser essentiellement les espaces agricoles au nom de la qualité de « l'offre environnementale »2 pour le tourisme (GUISEPELLI & al., 2000), tout en attribuant dans le même mouvement, une fonction centrale à l'agriculture et en particulier à l'élevage. Aussi, les débats insistent-ils souvent sur la nécessité de préserver des espaces agricoles ouverts et sans friche. Mais la volonté de conservation de paysages « propres » pour le tourisme, scandée par les discours politiques locaux, est-elle réellement partagée par les touristes à qui cette offre est destinée ? En outre, la notion de « paysage ouvert » dans l’action locale est-elle aussi consensuelle que les plans d’actions sur le paysage le laissent entendre ? 2 Termes utilisés par les élus. Ces termes présentent une ambiguïté notoire puisque la notion (...) 4L’absence de définition collective du paysage fait émerger des interrogations non seulement sur le statut et la validité du paysage dans l’action locale mais aussi sur le positionnement réciproque des acteurs qui le gèrent : que révèlent les réflexions locales sur le paysage en terme de stratégies de développement ? Quel(s) paysage(s) veut-on et quelles sont les pratiques - en particulier agricoles – qui en découlent ? Quelles sont la place, dans les représentations sociales du paysage, et les fonctions, dans l’action, attribuées à l’agriculture ? 5Nous proposons un éclairage de cette question de la place et du rôle attribués à l’agriculture à travers les représentations sociales du paysage. Par cette entrée, nous nous attachons à comprendre comment l’agriculture est perçue dans ses fonctions paysagères à différents niveaux de la société en mettant en exergue les convergences et les décalages pouvant exister entre ce qu’une société locale cherche à montrer et ce qui est perçu de l’extérieur. Nous formulons en conclusion quelques conséquences de cette analyse en termes de pratiques et de gestion des exploitations agricoles. Place de l’agriculture dans le paysage : les modèles paysagers de la « société globale » 3 6Les paysages alpins sont, depuis plus deux siècles, objets de représentations sociales. Celles-ci émanent souvent des élites sociales et culturelles qui, par leur regard ont institué de véritables "modèles paysagers"4 qui ont été diffusés dans toutes les couches sociales par différents relais médiatiques au cours du XIXè et du XXè siècle (LUGINBUHL, 1989 ; de la SOUDIERE, 1991 ; CADIOU, LUGINBÜHL, 1995). Ces modèles paysagers « globaux » côtoient des représentations locales (qui peuvent parfois être des modèles) en se superposant plus ou moins avec celles-ci. Mais nous nous intéressons moins ici aux facteurs concourant à la formation des modèles paysagers qu'à leur expression dans le jeu social. 3 Nous entendons par « société globale », la société urbaine dans son ensemble ou les (...) 4 Modèle paysager : Schème cognitif permettant de lire un espace et de la qualifier en tant que (...) 7Les acteurs locaux (élus, agriculteurs…) ont le présupposé que les « attentes de la clientèle touristique » (selon leurs propres termes) sont les mêmes que les leur. Un certain nombre d'actions intentées sur les paysages sont donc supposées répondre aux demandes de cette clientèle. Mais la manière dont les touristes parlent du paysage et le regardent intéresse en réalité d'autres objets de l'espace que ceux des acteurs locaux. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de paysage pour les touristes ? Pour les résidents ? Pour les élus ? Pour les agriculteurs ? 8Des enquêtes effectuées auprès de ces différentes catégories d’acteurs5 (GUISEPELLI, FLEURY, 2000 ; GUISEPELLI, 2001), nous ont permis de faire ressortir différentes modèles paysagers puisant leur racine dans des époques plus ou moins lointaines mais profondément liées aux rapports que chacun entretient avec le terrain. Ces modèles, plus ou moins esthétiques et symboliques, constituent la toile de fond de la plupart des débats locaux sur les paysages dans les Alpes du Nord. 5 Action « attentes et perceptions » du programme GIS II, 1995-1999. Enquêtes semi- directives (...) Le modèle régional pastoral 9Parmi les types de paysage auxquels les touristes6 font référence, le modèle régional pastoral compte parmi les plus répandus. C’est le modèle de référence des touristes pour reconnaître le paysage type des Alpes du Nord. On y voit associées des composantes de paysage de la moyenne montagne (prairies, vaches, chalets, forêts) et de la haute montagne (neige, roche) en même temps qu’une évocation du caractère « authentique » des productions agricoles et de la typicité du bâti. 6 Touristes en situation de vacances, interrogés sur des chemins de randonnée. Cette méthode a (...) 10Les critères principaux de reconnaissance pour qualifier le paysage sont : les sommets enneigés en toile de fond, les prairieset les alpages, les vaches(plus secondairement les chèvres) qui restent les éléments principaux pour repérer l’agriculture dans le paysage (notons que jamais les races ne sont mentionnées), les forêts de conifères essentiellement (les feuillus sont rarement évoqués pour qualifier la végétation de montagne), les chalets (il n’est pas fait référence à un style précis : les chalets savoyards, suisses, bavarois ou tyroliens sont indifféremment mis dans le même style architectural, sauf pour une minorité plus avertie), les fonds de vallée agricoles, les fleurs (rarement, toutefois, les espèces sont mentionnées). 11Ces éléments sont présentés ici de façon exhaustive, mais pour faire « Alpes », il suffit de faire figurer un sommet enneigé, une vache dans une prairie et éventuellement un chalet. Ce modèle paysager, qui embrasse donc la totalité des versants du sommet minéral au fond de vallée agricole, est assez universel au sens où il traverse toutes les catégories sociales : des professions libérales aux ouvriers en passant par les cadres moyens et supérieurs. 12La présence agricole est reconnue comme une nécessité sans constituer pour autant l’élément central. L’agriculture est une composante faisant partie d’un ensemble plus global ; elle est davantage perçue à travers le cheptel et ses produits qu’à travers son action d’entretien du paysage. Photo 1 : Le modèle régional des touristes : un idéal de montagne pastorale reprise en masse par les cartes postales 13Les discours sur le modèle régional sont de plusieurs ordres. Ils relèvent autant de considérations paysagères visuelles que de considérations sur les odeurs (de l’air, des conifères, voire des bouses), les sensations tactiles (toucher la nature, les prairies, les arbres, les bestiaux d’élevage), le goût (les fromages sont considérés comme ayant meilleur goût dans les uploads/Geographie/ emmanuel-guisepelli.pdf
Documents similaires










-
82
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 23, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4480MB