RECENSION D ARTICLE MICHELE METIVIER M2 CCS UE 1 HISTOIRE ANTIQUE Article : Heu
RECENSION D ARTICLE MICHELE METIVIER M2 CCS UE 1 HISTOIRE ANTIQUE Article : Heullant-Donat Isabelle, Bresc Henri. Pour une réévaluation de la « révolution du papier » dans l'Occident médiéval. In: Scriptorium, Tome 61 n°2, 2007. pp. 354-383. DOI : https://doi.org/10.3406/scrip.2007.4226 www.persee.fr/doc/scrip_0036-9772_2007_num_61_2_4226 Des écrivains chercheurs ont apporté des nouvelles lumières sur la place du papier dans la documentation médiévale au XIXe siècle. Messieurs Charles-Moïse Briquet et Alfred Giry ont trouvé plusieurs archives dans des fonds européens afin de répondre à cette question dans l’espace géographique les régions autour de la méditerranée plus particulièrement la péninsule italienne, Byzance et l’Espagne. On a souvent à l’esprit que le support de l’écriture au Moyen-Âge est le parchemin. Cette idée vient des communications autour des manuscrits de valeur et de livres précieux, terrain privilégié jusque-là des chercheurs. Or le papier est bien présent et cet article nous montre certains usages de celui-ci, sa diffusion, certaines techniques et les centres de sa fabrication. Une première avancée sur « une civilisation du papier » de provenance arabe s’inscrit dès les premières lignes de cet article et nous oriente vers une zone géographique autour du bassin méditerranéen et reprenant la typologie même des documents sur la façon dont les hommes du XIIe et XIIIe siècles utilisaient le papier. Un bel exemple, un dictionnaire du XIIIe siècle le Catholicon de Giovanni Balbi fut écrit sur papier. Ce livre destiné aux bibliothèques des écoles fut exploité par les étudiants durant des années, et reproduit à environ une vingtaine de copies avant 1500. D’ailleurs G. Balbi reprend dans son livre l’étymologie du terme papier par papyrus, ce qui appuie le peu de place qu’avaient ce support. Le nom de charta bombicinata indiquera mieux le nom du papier, celui-ci venant de la ville de la boucle de l’Euphrate où sa fabrication était connue au Xe siècle étant un grand centre textile à l’époque. On est souvent étonné de voir que les historiens font l’impasse sur certaines sources comme les zones géographiques toutes aussi importantes que celles dont les recherches ont abouti. Dans un espace où les villes se touchent d’une seule ligne frontière, le monde byzantin est oublié à l’instar de la péninsule ibérique et italienne. Il en va de même de données factuelles tel que l’état de conservation qui permet un traçage chronologique dans une région donnée. L’information typologique est aussi une approche indispensable à la recherche de l’usage du papier, qu’il soit comptable, judiciaire scellé ou non l’origine du document est la clé fondamentale afin de trouver les cibles recherchées. Rappelons que la solennité accordée au livre par l’aspect qu’il revêt, souvent le parchemin pour les feuilles et le travail qu’il a fourni, sont les éléments essentiels évoqués lors de la valeur de celui-là. D’après les auteurs de l’article, le Bréviaire latin de Silos en Espagne est un « jalon » un repère car des pages en parchemin et papiers sont intégrées ensembles dans ce manuscrit, ce qui le rend unique. Il serait le plus ancien conservé en Occident. La particularité de ce manuscrit tient à cet usage du double emploi du support de l’écrit, la question posée sur le fait que ce soit pour protéger les feuilles papier est judicieuse, plus que toute autre question sur l’esthétisme. Enfin la question des techniques de conservations afin d’améliorer l’existence des livres est abordée. Le point sur lequel des manuscrits hébreux copiés en Espagne, en Italie et dans le monde byzantin de la même façon que le bréviaire de Silos est important car cela prouve que des cultures différentes, tel que les croyants de religion juive, une communauté minoritaire, abordaient les mêmes problèmes et qu’une certaine classe sociale d’érudit travaillait comme aujourd’hui à trouver le moyen de conserver leurs archives. De même que pour la circulation des prières sur papier, les voyageurs juifs (des professeurs) entre le VIIe et le IXe siècle portaient sur eux des fragments de prières tirées de la Thora (catalogue de l’exposition de la BnF 1991 sur les manuscrits hébraïques). Cela démontre que le papier venait de région différente et qu’il était fabriqué plus ou moins de la même façon (lisse, glacé, collé, régulier) malgré des échanges de marchandises difficiles souvent liés aux moyens de transports très aléatoires pour les marchands et surtout pendant les périodes de conflits. Au XIIIe siècle, les manuscrits sur papier sont plus importants. Ils sont pour la plupart d’origine grecque sur les thèmes de la liturgie, théologie, philosophiques et des traités de grammaire. On trouvera ce type de papier oriental dans des régions du sud et de la péninsule entre 1205 et 1260 où on distingue une grande population grecque à la fin du siècle. Au palais impérial, le patriarche et les administrations de 1052 à 1453, 321 produisaient des actes en parchemin et 293 en papier soit un rapport pratiquement équivalent. Dans les actes en papier on compte des actes impériaux et aucun en parchemin. A compter de 1259 et jusqu’en 1453 les rôles s’inversent le parchemin reprend sa place de support privilégié pour les chrysobulles notamment. On notera que suivant la hiérarchie sociale, que l’on soit césars ou hommes d’église, le parchemin a une place privilégiée auprès de ces derniers dès le XIe siècle dans le sud de l’Italie, en Sicile. Au palais de Palerme le papier était en usage pour les actes « qui ne méritaient pas la perpétuité ». La fragilité et la destruction du papier étaient des problèmes très présents à l’esprit des scribes de l’époque. Sous le règne de Frédéric II, la chancellerie n’hésite pas à recopier en 1222 des mandements, grands nombres de ceux-ci seront perdus détruits par vetustate comsumpte. On décidera ensuite de rédiger des actes sur parchemin uniquement en raison de la fragilité du papier. Celui-ci sera utilisé pour des ordres à portée immédiate dans l’importance n’avait pas besoin d’être archivée. Les qualités du papier étaient aussi indéniables, sa légèreté, moins épais, plus pratique, ont fait partie plus tard des éléments qui ont fait le succès et remplaça le parchemin. De certains actes consultés sur la région de la péninsule italienne, entre les registres notariés de Gênes en 1155 et un registre des Uglini, marchands-banquiers de Sienne, et les actes espagnols de la même époque, l’Italie apparaît précurseur (tableau II). Les échanges commerciaux sont la clé de cette différence déjà très en place au départ de Gènes. Néanmoins les actes relevés dans ce tableau démontrent que les notaires de la région méditerranée écrivaient sur du papier, la source en est l’absence de ceux-ci relevés dans des attestations. Notons quand même que quelques notaires continuaient à travailler sur parchemin en Lombardie et dans le milanais encore jusqu’au XIIIe siècle. Le fait que les maîtres universitaires de Bologne proches des milieux notariaux ont certainement eu une incidence sur la pérennité du parchemin grâce à la pecia fortement utilisé pour la copie des élèves et dont la solidité devait être à toute épreuve. En France, en Anjou en 1266 et 1380, la chancellerie utilisa le papier en grande majorité durant le règne de Charles Ier (1265-1380). Au XIIIe siècle l’utilisation simultanée du papier et du parchemin dans les actes notariaux et administratifs de différentes villes italiennes étaient courante. Si la question de l’utilisation du papier est largement explicitée, la question de la production devient alors la condition essentielle de la mise en place de ce support et de sa propagation. C’est en péninsule ibérique sous la conquête musulmane que la fabrication du papier après le XIIe siècle apparait. Xativa, dans la région de Valence dans le sud de l’Espagne, tient un rôle important car déjà au XIIe siècle cette ville produisait un papier de qualité. Des actes de 1261 et 1274 fixent des taxes par rames. Les villes de Murcie et de Valence sont citées dans l’exportation de papier venant de Xativa de technique arabe le zarf. Ce papier s’est exporté vers la Grèce, la Sicile et la Provence ceci est attesté dans des actes de commandes barcelonaises en 1260. L’Italie du sud supplantera le papier de Xativa dont la technique sera dépassée. C’est à Gènes que l’on découvre une attestation de la plus ancienne fabrication de papier dans un contrat entre trois personnes dans ce commerce. Selon Pierre Tschudi1 reprenant les études de Jean Irigoin, la force hydraulique et l’utilisation de maillets lourds sur pivots a fait progresser l’épaisseur du papier ainsi que les presses des drapiers permettant des feuilles plus résistantes. Le collage à la gélatine animale a permis l’imperméabilité aux insectes. La fabrication du papier à Fabriano est attestée à partir de 1280. Un fabricant de papetier est signalé dans un registre de notaire en 1283. On retrouve des filigranes dans des villes comme Bologne, à Macerata et Fabriano en 1293. On recense au conseil municipal des prieurs de Fabriano une trentaine de fabricants dans le métier du papier sous le nom très pertinent de Arte della carta bambagina entre 1310 et 1360, on passe à une expansion industrielle avec quatre millions de feuillets produits par une quarantaine de moulins à papier. D’autres uploads/Geographie/ article-heullant-donat-isabelle-bresc-henri-pour-une-reevaluation-de-la-revolution-du-papier.pdf
Documents similaires





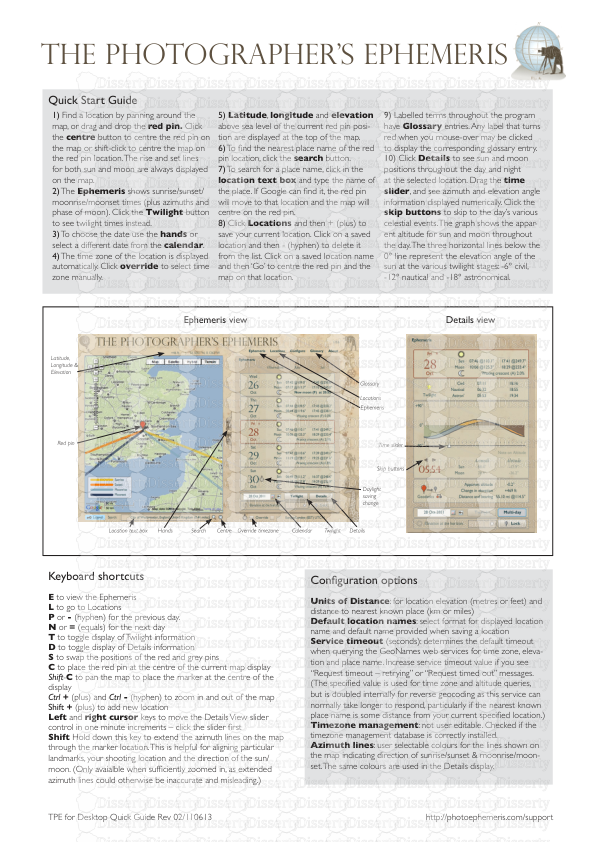
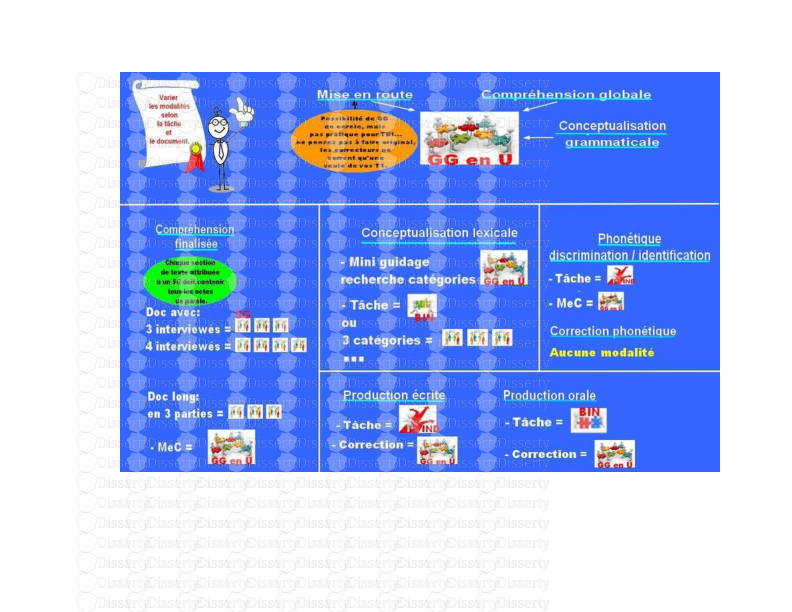



-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 22, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0793MB


