ASPECTS DU DROIT TUNISIEN DE LA CONCURRENCE Cours en construction Cours dispens
ASPECTS DU DROIT TUNISIEN DE LA CONCURRENCE Cours en construction Cours dispensé aux étudiants en master de recherches en management et stratégie Janvier – Avril 2013 Les années 90 se sont caractérisées en matière de droit de la concurrence et de la distribution par la promulgation de nouveaux textes d'inspiration libérale. L'article 3 de la loi du 1er juillet 1991, relative au commerce de distribution dispose que “ l’exercice de l’activité de commerce de distribution est libre et n’est pas soumis à agrément ”. La loi du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix consacre le principe de la liberté des prix et de libre concurrence. Ces deux textes s'inscrivent dans le droit fil de la politique d'ajustement structurel (privatisation des entreprises publiques, libération du commerce extérieur et de la législation de change, libéralisation du régime des investissements) entreprise par les pouvoirs publics depuis 1987. Ces deux textes ont subi des modifications et ont été complétés par la promulgation d'autres relatifs notamment à la protection du consommateur, à l'encadrement des opérations de promotion commerciale et la suppression du régime d’autorisation administrative de plusieurs activités économiques et son remplacement par le régime d’adhésion à des cahiers des charges approuvés par le ministre chargé du secteur concerné. La loi du 29 juillet 1991, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, contient deux séries de dispositions que nous nous proposons d’étudier dans ce cours. - Celles concourant à la protection du marché à laquelle est attaché le contrôle des concentrations et le contrôle des comportements associé à l’interdiction des ententes et l’exploitation abusive de position de domination ou de dépendance (I). - Celles concourant à la protection des contractants et des concurrents (II). I.- LA PROTECTION DU MARCHE La loi du 29 juillet 1991 prévoit un double contrôle : - un contrôle sur les structures auquel est attaché le contrôle des concentrations (Section première) ; - un contrôle des comportements auquel est attaché le contrôle des ententes, de l’exploitation abusive de position dominante ou et d’abus de dépendance économique (Section deuxième à cinquième). Les deux types de contrôle présentent des spécificités tant sur le plan des autorités qui sont en charge que sur le plan des sanctions. Les autorités de contrôle ne sont pas les mêmes. Ainsi dans le cas d'une opération de concentration économique, l'Autorité administrative, en l'occurrence le ministre chargé du commerce, est compétente (le ministre doit, toutefois, requérir l'avis du conseil de la concurrence). Alors que dans les cas des pratiques anticoncurrentielles, c'est le Conseil de la concurrence qui intervient (Section sixième). Une autre différence peut être relevée. Le contrôle des concentrations s'exerce a priori1[1] alors que celui des ententes et abus de domination s'effectue ex post. Le contrôle a priori des concentrations débouche soit sur une autorisation de l'opération, conditionnelle ou non, soit sur un refus d'autorisation. Le contrôle a posteriori des ententes et des abus de domination débouche sur une double sanction : - répressive : sur ce point on notera que le principe de droit pénal selon lequel un même fait ne peut donner lieu à deux poursuites, est écartée. Selon l'article 34 de la loi de 29 juillet 1991, le conseil de la concurrence peut, indépendamment des peines prononcées par les tribunaux répressifs, infliger une amende pécuniaire contre les prévenus. - et civile par la déclaration de la nullité de tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées. Cet aspect civil du contentieux de la concurrence reste cependant du ressort du juge de droit commun et ne sera pas examiner dans le cadre de ce cours. Section première. Le contrôle des concentrations2[2] 1[1] La loi n'exige pas une autorisation préalable de l'opération. Les parties peuvent donc conclure l'acte de concentration à condition de ne prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché. Certaines opérations de concentrations économiques revêtant une certaine importance sont soumises à l'autorisation du ministre chargé du commerce. Le contrôle des concentrations économiques a été introduit par la loi n°95-42 du 24 avril 1995 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1991. Le siège de la matière est dans les articles 7, 7 bis et 8 de ladite loi. On exposera les formes de concentration (§1), le seuil à partir une concentration est soumise au contrôle (§2), le contenu de ce dernier (§3), la procédure à suivre (§4) et les sanctions exposées en cas de défaut d’autorisation ou éventuellement l’échec du contrôle qui n’arrive pas à empêcher un abus de position dominante (§5). § 1 Les formes de la concentration "La concentration résulte de tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emporte un transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d’une entreprise ayant pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer directement ou indirectement sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante". La concentration résulte donc d'un acte juridique entre deux entreprises indépendantes. Cet acte devant : - transférer la propriété ou la jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d’une entreprise. Le transfert de la propriété peut résulter par exemple d'une opération de fusion, un apport partiel d'actif, création d'une filiales commune, une OPA/OPE, cession d’une filiale par sa société mère ou l’acquisition d’une participation ou de contrôle. Parmi les actes emportant transfert de jouissance, on peut citer les contrats de location-gérance et les licences de droits de propriété industrielle. - et, le critère étant cumulatif et non alternatif3[3], permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer directement ou indirectement sur une ou 2[2] Riadh Jaidane, L’influence du droit français sur le droit tunisien des concentrations économiques, Revue internationale de droit économique, 2002/4 - t. XVI, 4 pages 655 à 678. h0p://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIDE_164_0655. 3[3] Avis n°4295 du 28 octobre 2004, Rapport 2004, p. 431. Les par>cipa>ons réciproques entre sociétés concurrente dans la limite de 35% est de nature à entrainer un échange d’informations concernant la gestion et le fonctionnement des entreprises et de nature à influencer leurs décisions. On remarquera au passage que le code des sociétés commerciales interdit les par>cipa>ons croisées qui dépasseraient 10% du capital d’une société. plusieurs autres entreprises une influence déterminante : par exemple, une prise de participation avec octroi d'un prêt important. Le caractère minoritaire d'une participation peut avoir, dans le cas d'un actionnariat dispersé, pour effet d'exercer une influence déterminante sur une entreprise. La souscription par une entreprise à des obligations convertibles lui assurant, à terme, un contrôle (majorité au capital) sur la société cible peut être utilisée comme un instrument de concentration. La prise de contrôle pourrait prendre plusieurs formes : horizontale, verticale ou même hétérogène. Dans certains cas, les concentrations sont à la fois horizontales et verticales. §2 L'importance de la concentration Tout projet ou opération de concentration de nature à créer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l’accord du ministre chargé du commerce. En réalité, la loi fixe un seuil chiffré à partir duquel le contrôle s'effectue. En effet, les entreprises concernées par l'opération de concentration, qu'elles soient parties (parties au contrat) ou objet (société cible) ainsi que les entreprises qui leur sont économiquement liées (liens de participation, liens financiers, contrat de fourniture et de sous-traitance, les accords de dépendance ou de coopération) doivent vérifier l’une des deux conditions suivantes4[4] : - Condition relative à la part de marché: La part des ces entreprises réunies dépasse durant le dernier exercice 30% des ventes, achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché5[5]. Le texte de la loi permet de tirer des certitudes : - La période de référence pour le calcul de la part de marché est celle du dernier exercice comptable. Il n'y a pas lieu d'effectuer un contrôle de l'opération si la part de marché n'est pas acquise pour l'année de référence alors même qu'il est certain qu'elle sera acquise dans un avenir proche. 4[4] L’ar>cle 7 tel que modifié par la loi n°2005-60 du 18 juillet 2005. Ini>alement, la loi de 1995 prévoyait ini>alement le cumul des deux condi>ons. Exemple où une opéra>on de concentration n’entre pas dans le champ d’application de la loi pour défaut de l’une des condi>ons cumula>ves, voir décision n°4295 du 28 octobre 2004, Rapport 2004, p. 431. 5[5] Dans l’avis n°4289 du 25 mars 2004, Rapport 2004, p. 277, le conseil de la concurrence est saisi d’un avis à propos d’une concentration par voie d’acquisition d’un bloc de contrôle d’une société de conditionnement d’huiles végétales. Ces huiles proviennent de l’office national de l’huile qui les importe et les répartit, sous forme de quotas, à certaines sociétés de conditionnement. La part de la société acquéreuse dans le marché de référence (le condi>onnement des huiles végétales) est de 40% alors que celui de la cible est de 12%. - La part de marché uploads/Finance/ aspects-du-droit-tunisien-de-la-concurrence.pdf
Documents similaires


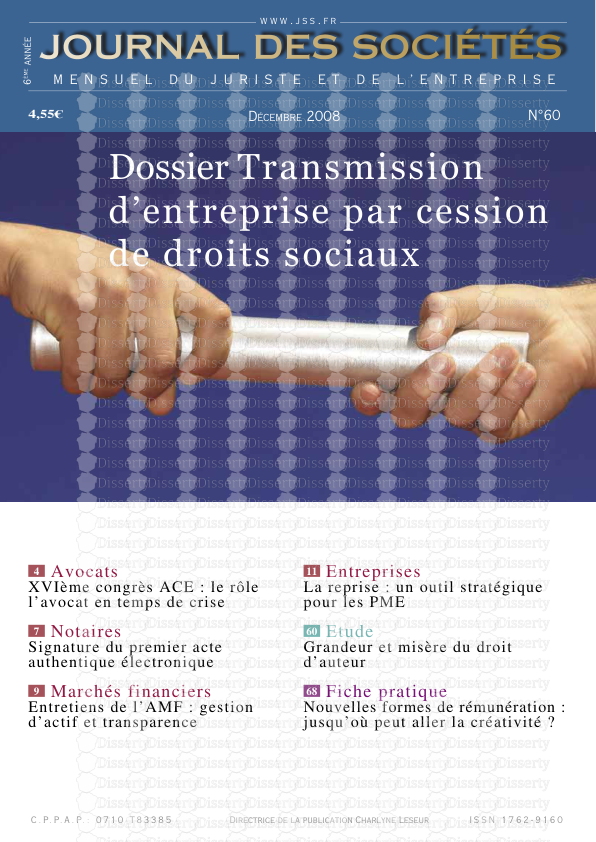





-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 03, 2023
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.4593MB


