Le temps musical comme moment d’éternité Résumé Le temps musical s’exprime en u
Le temps musical comme moment d’éternité Résumé Le temps musical s’exprime en une folie géniale de la rapidité, des répétitions, des brisures, des coïncidences entre tempo, sonorités, rythme. La musique, nouveau médium du langage, exprime quelque chose sans les mots. Elle dit sans le dire mais avec des sons et des silences, l’un inséparable de l’autre. A travers ceux-ci, la musique dévoile une temporalité fondamentalement plurielle : à la source du passé par lequel elle collecte les émotions les plus fortes telles que la peine, la joie, la mélancolie, la nostalgie, elle s’inscrit dans le présent. Les notes jouées mettent alors à jour une mélodie qui dure, faisant du temps un moment d’éternité afin que cela ne cesse jamais. Les philosophes ont pensé l’écoute en termes de parole, d’une parole à lire avant tout et à n’entendre qu’intellectuellement. En ce sens, ils ont été fascinés par ce qui se laisse voir, par la représentation par laquelle l’objet se laisse saisir (par le concept « Begriff »). Or, la musique ne donne rien à voir puisqu’elle n’offre aucune représentation. Si la musique parle, ce n’est pas pour dire quelque chose à saisir avec l’entendement, mais pour se dire. Dans son livre Philosophie et Musique, Jean-Claude Piguet montre que la philosophie prétend connaître et, pour y parvenir, elle part de l’esprit à la chose. La musique est par définition plurielle : Descartes énonce une musique en tant qu’une affaire d’acoustique, pour Leibniz, il s’agit d’une mathématique, pour Hegel c’est un moment du savoir absolu mais elle doit être dépassée par le concept, par la philosophie. Aussi Piguet écrit-il : « Ainsi les philosophies traditionnelles du XVIIème et XVIIIème siècle ont intégré la musique au sein de la vie de l’esprit-sous quelque forme que ce soit1 ». Il faut partir de la musique car c’est la musique, comme l’a bien vue Nietzsche, qui se dit elle-même. En ce sens, la musique est étrangère aux concepts parce qu’elle est au-dessus des concepts. De même, elle n’est pas de l’ordre du phénomène mais de l’événement, pas de l’ordre de la connaissance mais de la conscience d’où émane la connaissance. La musique n’est pas l’expression des sentiments à l’état brut comme peuvent l’être les pleurs ou les rires. Ces sentiments sont transmutés en musique, précisément, par le travail de la pensée. En somme, l’activité de la pensée et la passivité des sentiments sont unies dans la musique de sorte que nous pouvons approcher le rivage de ce qui ne se laisse pas connaître. Toutefois, le temps est à la fois ce que l’on subit puisque nous sommes de part en part pris dans le temps (nous n’y échappons pas) et ce que l’on élabore, ce que l’on transforme. C’est déjà en ce sens que la musique peut nous aider à comprendre la pluralité du temps. A rebours d’une théorie du temps pré-établie par laquelle nous tenterions de faire entrer de force la musique, nous essayons plutôt de partir de la musique afin de mieux comprendre ce qu’est le temps. Gisèle Brelet avait saisi la difficulté de comprendre le temps mais, pour autant, n’abandonne pas le temps musical : « le temps est inintelligible dites-vous ? C’est sans doute que vous ignorez le temps musical et ne concevez d’autre mode de connaissance que le mode conceptuel. Mais le temps, opaque aux concepts, est clair à la pensée pensante2 ». Partir de la musique, c’est non seulement essayer de comprendre la musique mais, aussi tenter de comprendre le temps. I. Tentatives définitionnelles A. Le temps scientifique 1 Jean-Claude Piguet, Philosophie et Musique, Georg, Chêne-Bourg, 1996, p. 163. 2 Gisèle Brelet, Le temps musical. Essai d’une esthétique nouvelle de la musique, PUF, Paris, 1949, p.481. 1 Le temps musical n’est pas le temps scientifique. En science, on va de l’explication à la compréhension alors que c’est l’inverse dans l’art. La science repose sur le principe de causalité qui ne permet pas de comprendre la valeur musicale, par exemple d’une fugue de Bach, même si celle-ci se développe de manière parfaitement rationnelle. De plus, la science cherche l’intelligibilité objective du monde sensible en étudiant les qualités concrètes de l’objet. En revanche, l’art cherche une intelligibilité subjective qui confirme la qualité concrète, raison sans doute pour laquelle chaque œuvre d’art est unique. Conséquemment, nous pouvons déjà saisir l’importance de cette distinction pour le temps : temps abstrait, général de la science ; temps concret, individuel de la musique. B. Temps littéraire. Le temps musical n’est pas le temps littéraire. Certes, tout comme la musique, le discours littéraire se développe dans le temps, mais dans ce dernier cas, le temps n’est qu’un instrument au service d’un sens logique qui lui est extérieur. En littérature, le temps a un extérieur, a contrario de la musique. Dans le roman proustien, A la recherche du temps perdu, le temps du récit se déroule comme un fil et est extérieur au temps des événements dont on fait le récit, tandis que la musique est le temps même. Ce qui fait dire à Bernard Sève que « le temps musical est peut-être un temps plus originaire que le temps raconté, un temps plus essentiel, plus corporel sans doute, plus archaïque, un temps peut-être dans lequel le temps narratif a dû se construire3 ». Nous avons pu penser que le temps qualitatif de Bergson qui s’oppose au temps quantitatif de la science, correspondait au temps musical : « Quand nous écoutons une mélodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous puissions avoir- une impression aussi éloignée que possible de celle de simultanéité- et pourtant c’est la continuité même de la mélodie et l’impossibilité de la décomposer qui fait sur nous cette impression. Si nous la découpons en notes distinctes, en autant « d’avant » et « d’après » qu’il nous plaît, c’est que nous y mêlons des images spatiales et que nous imprégnons la succession de simultanéité : dans l’espace et dans l’espace seulement, il y a distinction nette de parties extérieures les unes aux autres4 ». Mais, en réalité, la musique joue sur la continuité et la discontinuité. En d’autres termes, elle joue sur les altérations temporelles. Et Christian Accaoui d’énumérer : « phénomènes d’attente, de retard, d’étirement, de rappel, d’anticipation, de contraction, relation d’antériorité, de postérité, de simultanéité ; jeux de la mémoire (réminiscences et retours) ; effets de vitesse, de surprise, de tempo5 ». Il faut distinguer le temps de la vie, reconnu par Bergson, et le temps de la pensée, façonné librement. C’est dans ce temps-ci que nous introduit le temps musical, temps appréhendé dans sa pure réalité. A l’image de la conscience, la musique se déploie dans le temps. La sonorité, l’harmonie, le rythme, en tant que tels, sont étrangers aux concepts. Mais la difficulté de parler de la musique réside dans le fait qu’il ne s’agit pas là que de notions (notions d’harmonie etc). L’entreprise de parler de la musique n’a de sens que si elle part de la musique pour nous y reconduire, en nous aidant à mieux penser ce que nous entendons, à nous aider à ne pas rester des auditeurs passifs. La musique n’est donc pas de l’ordre du temps analysable comme peut l’être le temps de la montre ; elle est de l’ordre du temps qualitatif, temps gonflé de vie sensible que l’on expérimente dans son immédiateté et temps parfaitement intelligible de la conscience. Le temps musical, en définitive, réconcilie la sensibilité et la pensée. Si la musique est un art dans le temps, elle est aussi un art du temps 3 Bernard Sève, L’altération musicale, Seuil, Paris, 2002, p. 274. 4 Henri Bergson, La pensée et le mouvant, PUF, Paris, 1959, p. 166. 5 Christian Accaoui, Le temps musical, Desclée de Brouwer, Paris, 2001, p. 108. 2 comme le dit Accaoui6. Pour ce faire, tentons de préciser quelques aspects de ce temps musical. II. Les aspects du temps musical A. Le son Le son, comme la vie, naît, croît et meurt. C’est sans doute ainsi qu’il éveille en un raccourci saisissant les émotions profondes d’une vie suspendue entre l’être et le non-être, d’une existence dans l’entre-deux. Les sons diffèrent d’un instrument à l’autre et produisent des expériences temporelles variées. Le son du piano a quelque chose d’inachevé, demandant comme un travail de la conscience pour s’accomplir alors que l’orgue occupe tout le présent. Ecoutez le Clavier bien tempéré joué à l’orgue, au clavecin ou au piano en n’étant qu’à la sonorité. Que signifient ces différences sur le plan de l’expérience du temps ? Si le son naît et meurt, c’est bien qu’il est entouré de silence et que, sans ce dernier, il perd tout sens. Lorsque l’on écoute la musique, on le fait dans le silence comme pour pouvoir la recréer intérieurement. Le silence permet à la sonorité d’exister. A l’image du clair-obscur, le silence est l’envers de la sonorité mais, sans lui, la sonorité ne se ferait pas entendre. Dès lors, le silence est aussi la limite du temps qui fait surgir la uploads/s3/le-temps-musical-comme-moment-deternite.pdf
Documents similaires






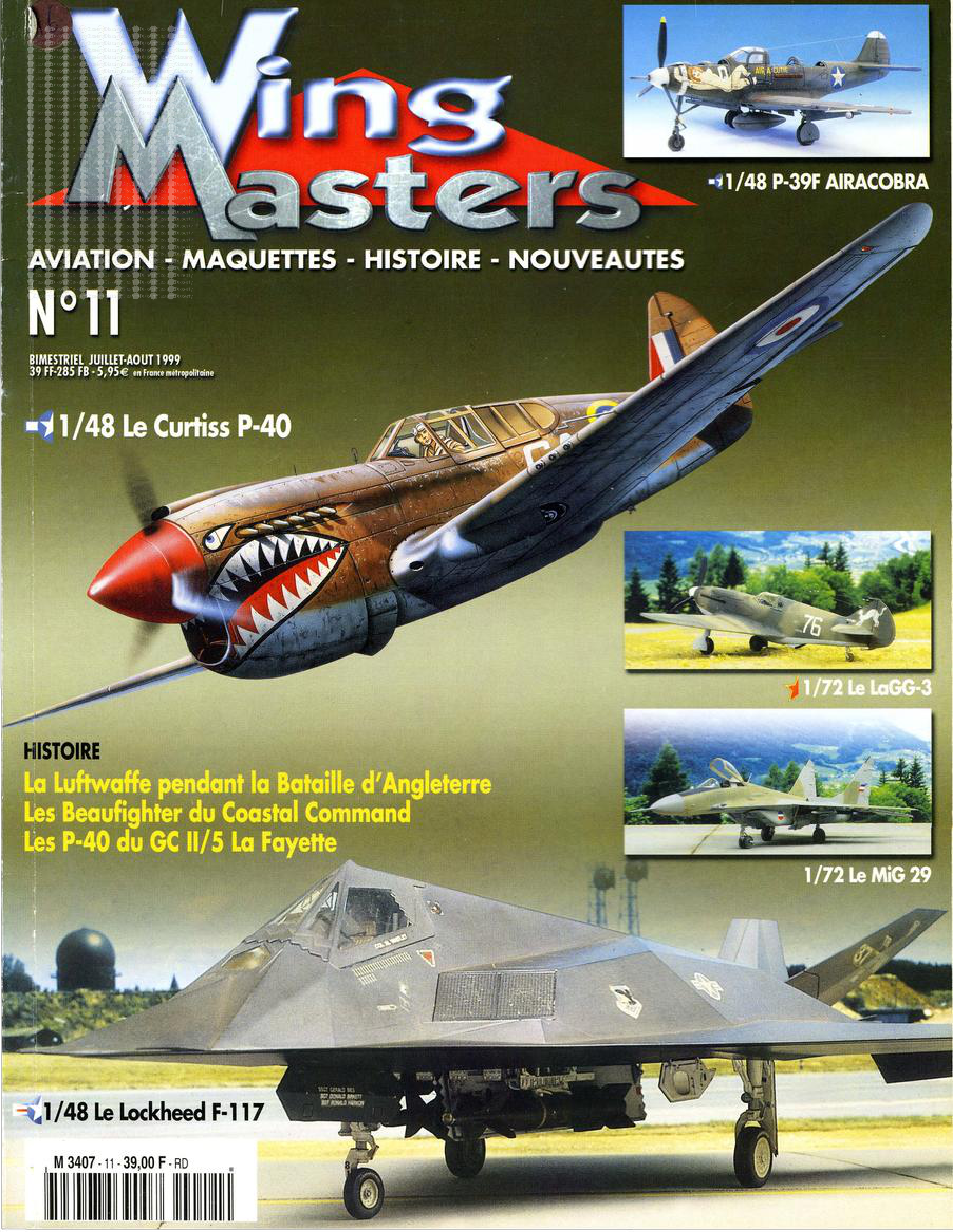



-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 03, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0969MB


