trópos • anno X • numero 2 • 2017 – ISBN 978-88-255-1253-3 DOI 10.4399/97888255
trópos • anno X • numero 2 • 2017 – ISBN 978-88-255-1253-3 DOI 10.4399/97888255125336 – pag. 79-95 (dicembre 2017) Formativité et auto–transcendance dans l’Esthétique de Luigi Pareyson Emanuele Antonelli* Abstract: In this paper we argue that Pareyson’s notion of formativity is germane to the notion of self–transcendence recently put forward in the vast domain of the sciences of the self–organization of complex systems. Fol- lowing Jean–Pierre Dupuy’s approach, we will not apply this notion to the analysis of Pareyson’s theory; we will, instead, show — by referring to the numerous topoi where often surprisingly precise parallelisms, convergences and semantic identities are to be found — that, though being largely inde- pendent in their genesis, the logics of the two notions are already consistent with each–other. As a result, we will claim that Pareyson’s theory of the work of art is best understood as a study on the integration of diVerent layers of organizational closures. Keywords: imitation, autonomy, integration, riuscita, attractor. En 2014, la traduction espagnole de l’Esthétique1de Luigi Pareyson est parue chez les éditions Xorki de Madrid. Tout en étant marginal, cet évènement éditorial témoigne d’un intérêt continu envers les œuvres d’un maître de la philosophie italienne dont le mérite principal est encore pour beaucoup, surtout à l’étranger, celui d’avoir entrainé Gianni Vattimo e Umberto Eco. Le temps nous dira si cette ouverture au débat hispanophone produira des eVets majeurs dans la Wirkungsgeschichte d’une œuvre qui, disponible en France depuis une dizaine d’année, pourrait trouver déjà aujourd’hui dans le paradigme des théories de l’auto–organisation et de l’auto–transcendance des nouvelles énergies. Le but de cette contribution est justement d’évaluer les niveaux de correspondance, souvent surprenants, entre la théorie de la formativité et cette oVre théorétique novatrice qui nous vient du parcours ⇤e.r.antonelli@gmail.com. 1. Toute référence à Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della formatività, Milan, Bompiani [19882]; trad. fr. de G.A. Tiberghien, Esthétique. Théorie de la formativité, Paris, Rue d’Ulm, 2007, en note et dans le texte, sera ainsi formulée (E: p, Ef: p). 79 80 Emanuele Antonelli éclectique du Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée2 de l’Ecole Polytechnique de Paris. L’ambition de cet eVort est d’en tirer une inter- prétation originale de l’œuvre de Luigi Pareyson qui puisse en témoigner l’actualité et, au même temps, la versatilité euristique. L’Esthétique de Luigi Pareyson n’est ni une théorie de la perception, ou de la connaissance sensible, ni encore une théorie de la sensibilité comme porte principale ou condition de possibilité de la connaissance en générale; dans ce qui suit nous montrerons les raisons textuelles et logiques qui nous amènent à croire que la meilleure description de son esthétique est celle d’une étude de l’intégration de niveaux de bouclages auto–transcendants. L’objectif de ce texte n’est donc pas de forcer l’esthétique de Pareyson dans les formes logiques de la théorie de l’auto–transcendance mais de montrer, en restant adhérents à ses mots, qu’elle y rentre a priori et donc d’en révéler les consonances implicites. On pourrait d’abord rappeler la définition d’esthétique offerte par Pareyson; elle nous fournit la clé pour comprendre le texte spécifique et en générale le parcours de l’auteur. À partir de ce texte, il nous sera possible de retrouver les outils qui nous permettront de mettre en évidence les cohérences et con- vergences profondes avec les théories de l’auto–organisation et, encore, avec les principes fondamentaux qui guident la tentative d’addendum offerte par la théorie de l’auto–transcendance auquel Jean–Pierre Dupuy travaille depuis les années quatre–vingt. Selon Pareyson, l’esthétique ne doit pas être interprétée comme une section spécifique de la philosophie, ni comme une discipline séparée; au contraire, elle est « la philosophie tout entière concentrée sur les problèmes de la beauté et de l’art » (E: 15, Ef: 29)3. Le volume de 1954 propose une analyse de l’expérience esthétique et de l’œuvre d’art dont le but principale est de fuir toute cristallisation analytique: l’expérience esthétique ne peut être étudiée que conjointement à l’objet d’art, l’œuvre d’art à son tour ne peut pas être comprise si on la réduit à objet déterminé et abstrait de son contexte; pour Pareyson l’esthétique est donc « une étude de l’homme qui fait art et dans l’acte de faire art » (E: 9, Ef: 23). 2. Le CREA fut un laboratoire du Département d’Enseignement et Recherche en Humanités et Sciences Sociales de l’École polytechnique. Dès l’origine sa tradition a été double et a concerné aussi bien la modélisation en sciences humaines (modèles d’auto–organisation de systèmes complexes tant cognitifs, qu’économiques et sociaux) que la philosophie des sciences et, en particulier, l’épistémologie des sciences cognitives. 3. Le trait caractéristique de la perspective esthétique est le fait d’être aussi une heureuse rencontre, induite par son objet d’élection, entre d’un côté la « voie vers le haut », inductive, e celle « vers le bas », déductive: un mélange d’expérience et abstraction, au–delà des perversions d’une critique d’art réduite à philologie, et des tendances spéculatives d’une philosophie théorétique métaphysique. Formativité et auto–transcendance dans l’Esthétique de Luigi Pareyson 81 La réflexion esthétique de Pareyson émerge sur l’arrière–plan de l’idéalisme dominant l’académie italienne, en dialogue avec le crocian- isme4. Si pour Hegel l’art est manifestation de l’Esprit, pour Benedetto Croce l’art se saisit comme expression de l’intuition individuelle de l’Idée. En étant aussi l’épitomé de l’esthétique crocéenne, la notion d’expression nous offre l’occasion d’éclaircir les principales raisons de la divergence pareysonienne5. A cet égard, il peut être suffisant de commenter une brève citation à propos du peintre qui peint sur toile ou sur bois, mais qui n’aurait pas pu peindre du tout, si l’image pressentie, la ligne et la couleur comme elles ont pris forme dans l’imagination, n’avaient pas précédées, à chaque étape du travail, du premier coup de pinceau ou de l’ébauche du croquis aux touches finales, les actions manuelles. Et quand il arrive que certains coups de pinceau soient en avance de l’image, l’artiste, dans sa révision finale, eVace et corrige. (Croce 1966: 227–228) On peut reconduire aisément cette attitude à la métaphore du programme, que les théories de l’auto–organisation ont dû abandonner pour surmonter le « théorème d’impossibilité » de Ross Ashby (1962; Dupuy 1982: 226) selon lequel l’auto–organisation était en fait logiquement impossible, tout comme il est impossible pour un programme de s’auto–programmer (Dupuy 2009: 20). Pour Croce, la peinture de tableaux, l’exécution musicale, le chant ou l’inscription d’un poème ne sont éventuellement liées à l’œuvre d’art, c’est à dire à l’intuition exprimée, que de façon contingente, ou instrumen- tale: en fait Croce reconnaît que la mémoire nécessite souvent le travail physique pour maintenir ou développer l’intuition, mais à son avis sa contri- bution est toujours seulement contingente. Le même pour ce qui concerne l’externalisation (l’estrinsecazione), ce qui n’est nécessaire que pour la ques- tion toute pratique de la communication de l’intuition: La frontière entre l’expression et la communication est, dans les faits, sans aucun doute très diYcile à percevoir [...] mais la distinction est idéalement claire et doit 4. Benedetto Croce meurt en 1952; les essais qui composent les sept chapitres de l’Esthétique de Luigi Pareyson étaient parus sur des revues italiennes déjà à partir de 1950. Le dialogue est en fait une confrontation imposée par l’importance incontournable de l’œuvre de Croce, envers laquelle Pareyson adopte une approche très critique. 5. La contribution plus excentrique de Croce à l’esthétique est la thèse sur l’équivalence entre intuition et expression, selon laquelle « chaque vraie intuition ou représentation est, au même temps (insieme), expression. [...] L’esprit n’a d’intuitions qu’en faisant, en formant, en exprimant » (Croce 1909: 47 nous traduisons). On peut donner une interprétation mécanique de cette thèse, en y voyant l’évidence du fait que Croce n’aurait pas eu conscience de la différence entre penser et faire (Ducasse: 1929); ou une interprétation charitable, selon laquelle Croce aurait compris que l’œuvre d’art n’existe que dans ses interprétations, ce qui sera en fait la thèse de Pareyson, qui soutient que l’œuvre d’art est l’exécution (interprétation) qu’on en donne (E: 221; Ef: 231). 82 Emanuele Antonelli être fermement soutenue [...] La technique ne pénètre pas dans l’art, elle ne se rapporte qu’à la notion de communication.6 (Ibidem) Pareyson, en anticipant d’une certaine façon le tournant de la cyberné- tique qui ouvrira la voie aux sciences de la complexité, démarre d’une hypothèse complétement diVérente, en partie inspirée, parmi d’autres, par la Vie de formes et surtout par l’Éloge de la main d’Henri Focillon7, où l’on peut lire: Je ne sépare la main ni du corps ni de l’esprit. Mais entre esprit et main les relations ne sont pas aussi simples que celles d’un chef obéi et d’un docile serviteur. L’esprit fait la main, la main fait l’esprit. Le geste qui ne crée pas, le geste sans lendemain provoque et définit l’état de conscience. Le geste qui crée exerce une action con- tinue sur la vie intérieure. La main arrache le toucher à sa passivité réceptive, elle l’organise pour l’expérience et pour l’action. Elle apprend à l’homme à posséder l’étendue, le poids, la densité, le nombre. Créant un univers inédit, elle y laisse partout son empreinte. Elle uploads/s3/ formativite-et-auto-transcendance-dans-l.pdf
Documents similaires

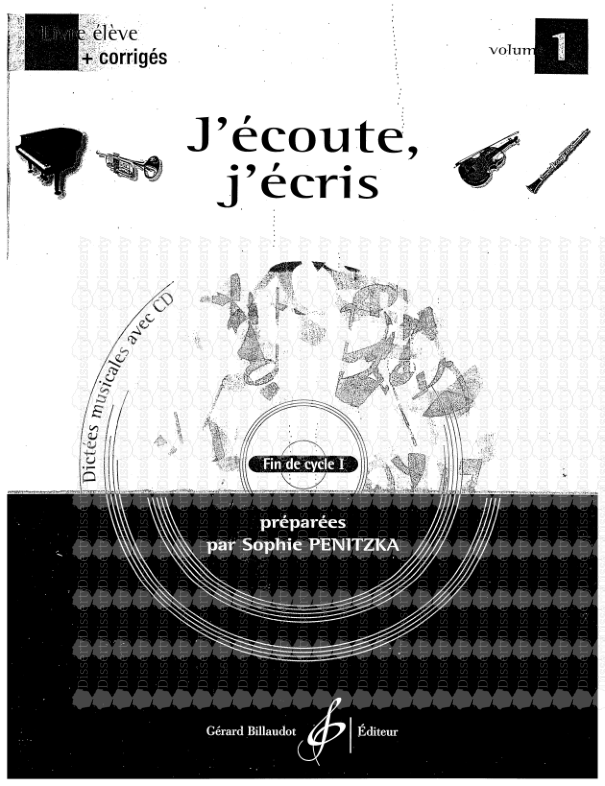








-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 04, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2872MB


