PENSER LA MUSIQUE APRES DEBUSSY Un hommage à Georges Migot pour le trentième an
PENSER LA MUSIQUE APRES DEBUSSY Un hommage à Georges Migot pour le trentième anniversaire de sa mort (1976-2006) par Bruno Pinchard professeur à l’Université Jean Moulin-Lyon3 « Il faut chercher la discipline dans la liberté et non dans les formules d’une philosophie devenue caduque et bonne pour les faibles.» Claude Debussy 1. Georges Migot et la réception française de Debussy : un moment oublié Pierre Boulez s’est beaucoup plaint de la faiblesse esthétique et musicale des successeurs de Claude Debussy et il n’a pas eu de mot assez durs pour fustiger le néant de leurs œuvres et de leurs conceptions. A ses yeux, personne n’a compris avant la révolution sérielle les innovations harmoniques et formelles de Debussy, et toute l’école qui a prétendu porter le flambeau de la musique française entre les deux guerres n’a fait que réduire à un académisme dérisoire sa véritable force d’innovation. Le procès est entièrement à charge : « Négativement, Debussy ? Ce ‘musicien français’ auquel on songe à le rapetisser, dimension qu’il s’était choisie dans la mi-extase d’un patriotisme guerrier. Il n’en reste qu’une légion d’ambitions à goût de cendre nationaliste, d’où la mi-extase s’est elle-même évaporée : après Couperin et Rameau, les épigones ont découvert, à leurs justes mesure et convenance, Charpentier et Lalande. Recours misérables ! […] Les mânes de Debussy ont dû boire une amère ciguë en assistant à la féroce débauche de ‘classicisme’ qui sévit après sa mort. […] Faut-il que ce fait Debussy, incommensurable avec tout académisme, incompatible à tout ordre non vécu, à toute ordonnance non instantanément créée, faut-il que ce fait soit resté un tel corps étranger à la musique d’Occident pour qu’elle y soit restée si imperméable dans ses développements ultérieurs : un véritable bain de mercure ! 1 ». Je voudrais ouvrir une brèche dans ces jugements flamboyants en présentant une autre évaluation de ces événements, qui ne saurait être négligée tant elle est élaborée et cohérente, tant elle est soutenue aussi par une authentique force de création. Je veux parler de l’œuvre du musicien Georges Migot (1891-1976), auteur des Agrestides, du Zodiaque, de la Passion et de 1 Pierre Boulez, « La corruption dans les encensoirs », in Relevés d’apprenti, Paris, Seuil, 1966, p. 34-36. Ce texte date de 1956. Boulez connaît les grands partisans de la musique modale, Vincent d’Indy et Maurice Emmanuel, qu’il appelle « les puristes du modal », p. 21. Ils furent les maîtres de Georges Migot. Et voici comment Boulez considère tout retour à la polyphonie de la Renaissance après Debussy : « Les affolants soubressauts – affolants autant qu’affolés – de Bach à Tchaïkovslky, de Pergolèse à Mendelssohn, de Beethoven aux Polyphonistes de la Renaissance, marquent les étapes d’une faillite éclectique et misérable, sans, pour cela, que le moindre embryon de langage fût arrivé à se faire jour. Paresse intellectuelle, délectation prise commme fin en soi, – ou, si l’on veut, hédonisme morose –, ce n’étaient pas là des atouts bien sérieux pour une telle recherche, il faut en convenir ; ils ont donné le résultat qu’on pouvait en escompter. », « Moment de Jean-Sébastien Bach », p. 19. Ce texte date de 1951. Sur Rameau et Debussy, même jugement, op. cit., p. 36. 2 partitions innombrables2, dont la carrière brillamment commencée après la Première guerre s’est continuée, sans rupture véritable, jusqu’aux années 70 du siècle précédent. Même si cette défense et illustration de Migot peut apparaître comme la continuation d’une tâche familiale, puisque mon père est l’auteur d’une monographie parue sur le maître de Parthenay3, il n’en reste pas moins que la connaissance de Georges Migot rend possible la perception d’une autre histoire de la musique pendant l’entre-deux-guerre que celle qu’ont répandu les travaux de Pierre Boulez. Elle permet surtout de concevoir avec une autre finesse et une autre ampleur la vérité de l’héritage debussyste, et pas seulement dans l’ordre de la composition musicale. Le debussysme pensant, celui dont je voudrais me réclamer dans ces pages, passe par la relecture par Georges Migot de l’histoire de la musique française. Il pourrait en résulter une meilleure évaluation des rapports entre philosophie et musique, du moins tels qu’ils découlent d’une méditation renouvelée de l’événement Debussy dans l’histoire de l’esprit. J’ai annoncé ces thèmes à plusieurs reprises déjà, dans Le Bûcher de Béatrice4, dans La Légéreté de l’être5, au centre des Méditations mythologiques surtout, proposant alors l’idée d’une « debussysme philosophique »6. Mais sans Migot, ces propositions n’ont un sens que trop profondément allusif. Il est donc temps que je m’explique davantage et l’anniversaire que je célèbre m’en donne l’occasion. Il ne m’appartient pas pour autant de raconter toutes les phases d’une œuvre que d’autres plus compétents que moi sauront mieux évoquer7. Il suffit de rappeler ici que dès la trentaine, Migot est en possession d’une esthétique très élaborée qui tire les conséquences de l’œuvre du dernier Debussy. A côté d’une création musicale abondante et reconnue, plusieurs livres et publications viennent développer ces thèmes d’une extrême originalité. Les Essais 2 Cf. Catalogue des œuvres musicales de Georges Migot, édité par Marc Honegger, Les Amis de l’Oeuvre et de la Pensée de Georges Migot, Institut de Musicologie, Strasbourg, 1977. Je ne peux à ce propos qu’exprimer ma profonde gratitude pour l’œuvre d’exposition et de diffusion de la pensée de Georges Migot par Marc Honegger, dont la compétence et la ferveur n’ont eu d’égal que la fidélité actuelle des Amis de de l’Oeuvre et de la Pensée de Georges Migot à la continuation de cette tâche. 3 Cf. Max Pinchard, Connaissance de Georges Migot, musicien français, Paris, Les Editions ouvrières, 1959 : « La vie de Georges Migot, simple dans ses événements extérieurs, est une aventure au sens où Christophe Colomb l’entendait lorsqu’il déployait toute son énergie à la découverte d’une terre nouvelle. » Je ne fais que poursuivre les chemins de cette découverte. 4 Bruno Pinchard, Le bûcher de Béatrice, Paris, Aubier, 1996, p. 240. 5 Bruno Pinchard (dir.), La légèreté de l’être, études sur Malebranche, Paris, Vrin, 1998, p. 33. 6 « Ces Méditations mythologiques ne sont peut-être qu’un essai de debussysme philosophique, qui tire d’une certaine divisibilité de l’espace de nouvelles règles de composition de la pensée », Bruno Pinchard, Méditations mythologiques, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 2002, p. 23. Et plus récemment : « Polyphonie du désordre », à consulter sur le site de la Faculté de Philosophie de l’Université de Lyon3. Pour être complet, il faut ajouter que j’ai publié en 1970 un premier témoignage sur ma fréquentation de Georges Migot dans la revue Musica. 7 Cf. Dictionnaire de la Musique, éd. Bordas, art. Georges Migot, signé par Marc Honegger et La musique religieuse de Georges Migot, Revue Zodiaque, n° 167, janvier 1991. 3 d’esthétique générale datent de 19158, les trois cahiers d’Appogiatures résolues et non résolues, de 1922 et 239, et le tout sera repris dans les publications plus synthétiques et plus mûries que sont le Lexique10, Matériaux et Mentions11, et, plus tardivement, Kaléidoscopes et miroirs et Matériaux et inscriptions12, ainsi que dans de nombreux articles13. Mais plutôt que de passer en revue ces travaux variés comme s’ils ne provenaient que de leur propre élan, il convient de montrer ici que penser avec Migot, c’est penser avec le temps qui fut le sien, et d’abord avec la culture traumatisée du lendemain de Verdun. Penser avec les compositeurs, c’est aussi parler leur langue, accepter les termes du débat qu’ils imposent, suivre la ligne particulière de leur cheminement dans le son et la culture. La Grande Guerre, Migot savait de quoi il retournait, ayant été gravement blessé en 1916. Cette blessure n’a jamais été un argument dans le savoir de Migot, mais elle suffit à vérifier son inscription dans une réalité historique et culturelle qu’il faut toujours garder à l’esprit si l’on veut mesurer exactement l’élan imprimé par La Mer ou Pelléas. Le témoignage de Georges Migot nous permet de retracer l’effet réel des innovations de Debussy et leur portée effective sur la culture la plus intérieure. Migot nous met en présence du travail effectif de l’esprit de la musique. Nul prétexte formaliste ne nous en dispense. Nous touchons la sphère des transmissions et des interactions. Des idées nous sommes passés aux hommes qui les portent. Ecoutons Migot lui-même : « Des premiers accords de Pelléas au final des chœurs du Martyre de saint Sébastien, Debussy a tenté de retourner à la Terre Promise. […] Nous ne voulons pas imposer ici ses formes […] Mais, quelles que soient les voies nouvelles, une admiration sans bornes doit aller 8 Mais ne sont publiés qu’après la guerre : cf. Georges Migot, Essais pour une esthétique générale (désormais EE), Paris, A l’enseigne du Figuier, 1920, deuxième édition 1937 sous le titre : Essais commentés et complétés en vue d’une Esthétique générale. Je ne cite que la première édition, sauf quand je l’indique (EE2). 9 Georges Migot, Appogiatures résolues et non résolues, Paris, Editions de la Douce France, Premier cahier 1922, Deuxième cahier 1922, Troisième cahier non daté <1923> uploads/s3/ penser-la-musique-apres-debussy.pdf
Documents similaires



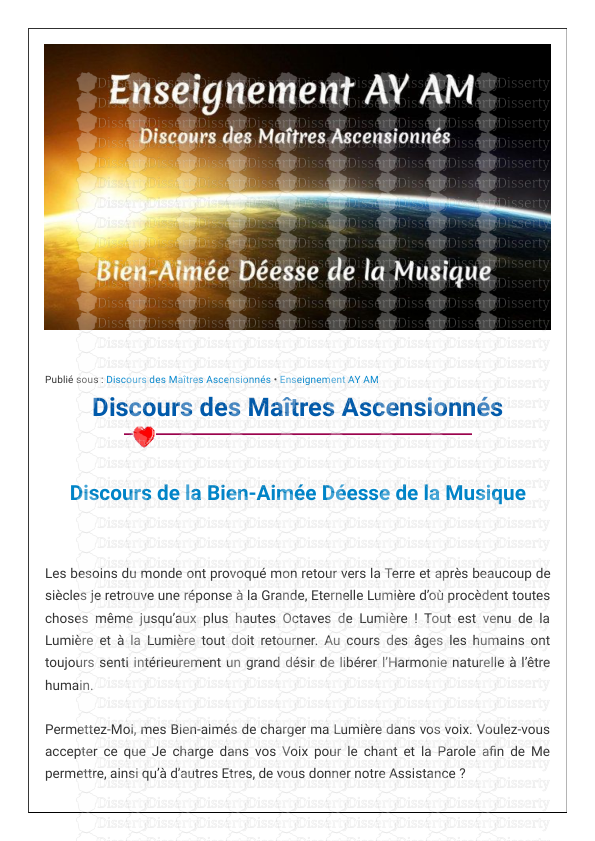






-
122
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 28, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1759MB


