Fondation Marthe Donas Stichting Newsletter Nr 2 April/Avril 2008 (supplément/b
Fondation Marthe Donas Stichting Newsletter Nr 2 April/Avril 2008 (supplément/bijlage) __________________________________________ Marthe Donas (1885-1967) La période irlandaise Jean-Marie Aendekerk dessin et eau-forte (Irlande 1915) (1) Dans les archives de Marthe Donas (2), conservées par sa fille Francine Franke Van Meir et dont la Fondation Marthe Donas possède une copie, figurent quelques textes biographiques manuscrits, rédigés par l’artiste elle-même. Le plus important de ces récits est écrit à la troisième personne ; il comporte une douzaine de pages de carnet et environ 330 lignes (3). Les autres textes sont plus courts (environ 50 lignes) et ont été écrits pour satisfaire deux demandes précises : celle de la Yale University Gallery (4) 2 qui ne possédait que quelques bribes d’information sur Donas, issues des notes de Katherine Dreier, et celle de Jan Van Lerberghe (5), alors Conseiller à la Direction Générale des Arts et des Lettres du Ministère de l’Instruction Publique (6). Van Lerberghe avait l’intention de réaliser une importante exposition dédiée à l’art belge de 1915 à 1930 ; il précisait « expressionnisme exclu » ! Ce projet n’a malheureusement pas pu se réaliser. Pour la période qui nous occupe, il n’y a pas de correspondance dans les archives Franke Van Meir. Contrairement à certaines suppositions ou espérances (7), elles ne recèlent d’ailleurs aucune lettre antérieure aux années 1950 (8). Ceci rend d’autant plus précieuse la remarquable étude (9) que Marguerite Tuijn, spécialiste de Theo Van Doesburg, a consacrée à une lettre de Donas à celui-ci, retrouvée dans les archives van Doesburg (RKD, Schenking Van Moorsel, lettre du 16 septembre 1920). L’absence totale de correspondance passive (10) dans les archives contraint donc à se rabattre sur l’autobiographie, probablement rédigée au début de 1959, et sur des recoupements de sources secondaires. Quant aux lettres écrites et signées par Marthe Donas à l’époque, à part celle adressée à van Doesburg et analysée par Tuijn, il n’existe quasiment pas de pièces accessibles ou localisables. Le récit biographique lui-même est daté avec une certaine approximation, comme de coutume pour une relation écrite longtemps après les faits, sans disposer d’écrits datés de référence. On y lit :«…en 1917, vers 1917, à partir de 1917, début 1917, fin 1918, 1917-18, etc… ». Ce qui oblige à formuler des hypothèses quant à la chronologie précise. Pour ce séjour irlandais, Donas indique ce qui suit : « de 1915 à mai 1916 . Laure (11) et Marthe acceptent une invitation de Mme Dallas Pratt à Dublin (Irlande). Marthe y suit une école d’Art de Vitraux de Miss Pursel où elle exécute 3 grands vitraux pour des églises d’Irlande (12). Tout y est fait par l’artiste : composition, découpage du verre, mise en plomb et peinture. Entretemps, pour remercier de son séjour elle fait le portrait des personnes chez qui elle loge. (12) Le travail des vitraux la passionnait mais la révolution à Dublin les oblige à quitter l’Irlande. » (13) Anvers, Goes , Dublin… Le 27 septembre 1914, l’armée allemande, profitant de sa supériorité en termes d’artillerie mobile de longue portée, bombarde violemment la ville d’Anvers assiégée. L’Etat-Major allemand, après une défaite sur la Marne et la prise de Malines, voulait, en effet, régler rapidement le sort d’Anvers, sa forteresse et son port, pour écarter cette menace potentielle sur le flanc de ses armées. Les dégâts à Anvers sont importants : le Schoenenmarkt est presque entièrement détruit. « Une bombe tombe sur la maison de ses parents (14) et toute la famille émigre en Hollande à Goes »(15). 3 Marthe se désole de cette rupture due à la guerre. Elle avait résolument, fin 1912 et à 28 ans, repris sa formation artistique à l’Académie d’Anvers et rompu ses fiançailles. Marquant ainsi son indépendance, notamment vis-à-vis de son père, farouchement opposé à sa vocation artistique. On ne connait pas la durée de ce séjour à Goes en Zélande, ni aucun événement y relatif, sauf le contact avec ces amis de la famille, en l’occurrence Mme Dallas- Pratt qui invite Laure et Marthe à Dublin. Elles s’installeront donc à Beauparc (un faubourg) dans la maison de leur hôte. De cette période irlandaise, on conserve des gravures, des dessins et des projets de vitraux. C’est la révolution irlandaise qui contraindra Laure et Marthe à quitter Dublin. Le soulèvement nationaliste de 1916 (Easter Revolution) éclate le lundi de Pâques 24 avril. Un bon millier d’hommes de l’« Irish Volunteer Force » et de l’ « Irish Citizen Army » prennent le contrôle de batiments stratégiques dans Dublin et font hisser le drapeau tricolore sur l’hôtel des postes. Après quelques jours de combats acharnés ( 400 morts et 2600 blessés), les insurgés capitulent le 29 avril. Les destructions sont importantes et la loi martiale est proclamée sur tout le territoire irlandais. La répression sera féroce au point qu’en fin de compte elle jouera en faveur de la cause irlandaise. Tous les meneurs du soulèvement seront exécutés. Ainsi tragiquement écourté, le séjour de Marthe Donas s’étendra néanmoins sur une période d’environ un an (mi- 1915 à mai 1916, selon l’autobiographie). Dublin – Easter Revolution 4 Des personnalités irlandaises… Romain Donas, le père de Marthe, était un négociant aisé de la bourgeoisie francophone d’Anvers. Ses amis irlandais (les Dallas-Pratt) paraissent bien issus également d’un mileu où il n’était pas inconcevable de voyager et d’inviter des amis pour des séjours plus ou moins prolongés (16). Mais qu’en est-il de « Miss Pursel » ? Des recherches (et une petite dose d’obstination et de curiosité) m’ont permis d’éclaircir ce « mystère » : il s’agit en réalité de Sarah Henrietta PURSER (1848-1943) (17), qui est, pour l’époque et pour l’Irlande, une personnalité extraordinairement attachante et intéressante. Avec Edward Martyn, elle crée en 1903 son atelier de vitrail « The Tower of Glass » (la Tour de Verre ou An Tùr Gloine en gaélique), dont la National Gallery of Ireland abrite un ensemble d’esquisses et de modèles de vitraux. Son autoportrait est conservé à la National Self Portrait Collection de Limerick. Fille d’un meunier-brasseur de Dungarvan, elle est envoyée, dès ses treize ans, dans une école en Suisse. Après avoir suivi à Dublin (1879-1880) les cours de la Metropolitan School of Arts, elle se rend à Paris et s’inscrit à l’Académie Julian (18) où elle rencontre notamment l’américaine Mary Cassatt(1844-1926) (19). Elle a aussi des contacts avec Degas et certains de ses portraits ou scènes d’intérieur (20) évoquent tout-à-fait l’art de Degas ou de Manet. Dès 1911, elle organise dans sa maison de Mespil House, des réunions de personnalités intellectuelles ou artistiques. Elle aura une activité générale de mécène pour l’art irlandais et sera, dès la fin du XIXe siècle, considérée comme « a leading society painter » dans le Royaume-Uni. 5 An Tùr Gloine, son atelier coopératif de vitrail, sera actif jusqu’en 1943 et elle ne cessera de s’en occuper jusqu’ à sa mort. La Tour de Verre est une initiative remarquable, axée sur le potentiel « Arts and Crafts » de la région et même du Royaume-Uni, puisqu’après 1920, de nombreux verriers britanniques y seront associés. Avant Purser, les vitraux des innombrables églises et chapelles d’Irlande provenaient généralement d’Allemagne ou de France. Elle a donc créé une école locale qui répondait à un besoin et relançait le potentiel créatif d’une Irlande pauvre et qui cherchait à s’émanciper. Des panneaux de vitraux d’artistes d’An Tùr Gloine, formés par Sarah Purser et Eward Martyn, ont été présentés et apparemment appréciés lors de l’exposition « Arts Décoratifs de Grande-Bretagne et d’Irlande » au Louvre en mai 1914, tout juste avant le début de la guerre. On retrouve actuellement encore des vitraux de cette école jusqu’en Arizona et en Nouvelle-Zélande. Sarah Purser disposait d’un réseau de relations à Paris et, bien entendu, connaissait Montparnasse. Sarah Purser par John Butler Yeats (21) 6 Noms, orthographe et plumes inconnues… Dans les notes manuscrites de Donas, les noms propres sont quelquefois mal orthographiés. On y retrouve des « Lhôt »(22) pour Lothe ou des « Bracke » pour Braque… et donc aussi « Pursel » pour Purser (23). On a l’impression que ce petit « désordre » est un trait commun à beaucoup d’artistes, comme s’ils compensaient la rigueur et le caractère élaboré de leurs conceptions graphiques par une certaine fantaisie en ce qui concerne l’orthographe des noms. Il existe des lettres d’Ensor où il massacre tous les noms de ses confrères (mais peut-être est-ce du sarcasme ?), au point que les « sic » parsèment les transcriptions. Et quant aux lettres de Delaunay, Pierre Francastel observe que « les textes qu’il nous laisse sont des témoins de son parfait mépris pour les règles les plus élémentaires de l’orthographe, de la ponctuation et de la syntaxe ». (24) Certes, bon nombre de ces orthographes dégradées ou fantaisistes proviennent de la reprise, plus ou moins consciente, d’erreurs de frappe ou de composition. (25) Dans le Courrier de la Semaine du 28 juillet 1918, Vauxcelles écrit ainsi « Kissling » pour Kisling et « Bracke » pour Braque. Et puis à nouveau « Bracke » pour uploads/s3/ newsletter-donas-no-2-suppl-bijlage.pdf
Documents similaires


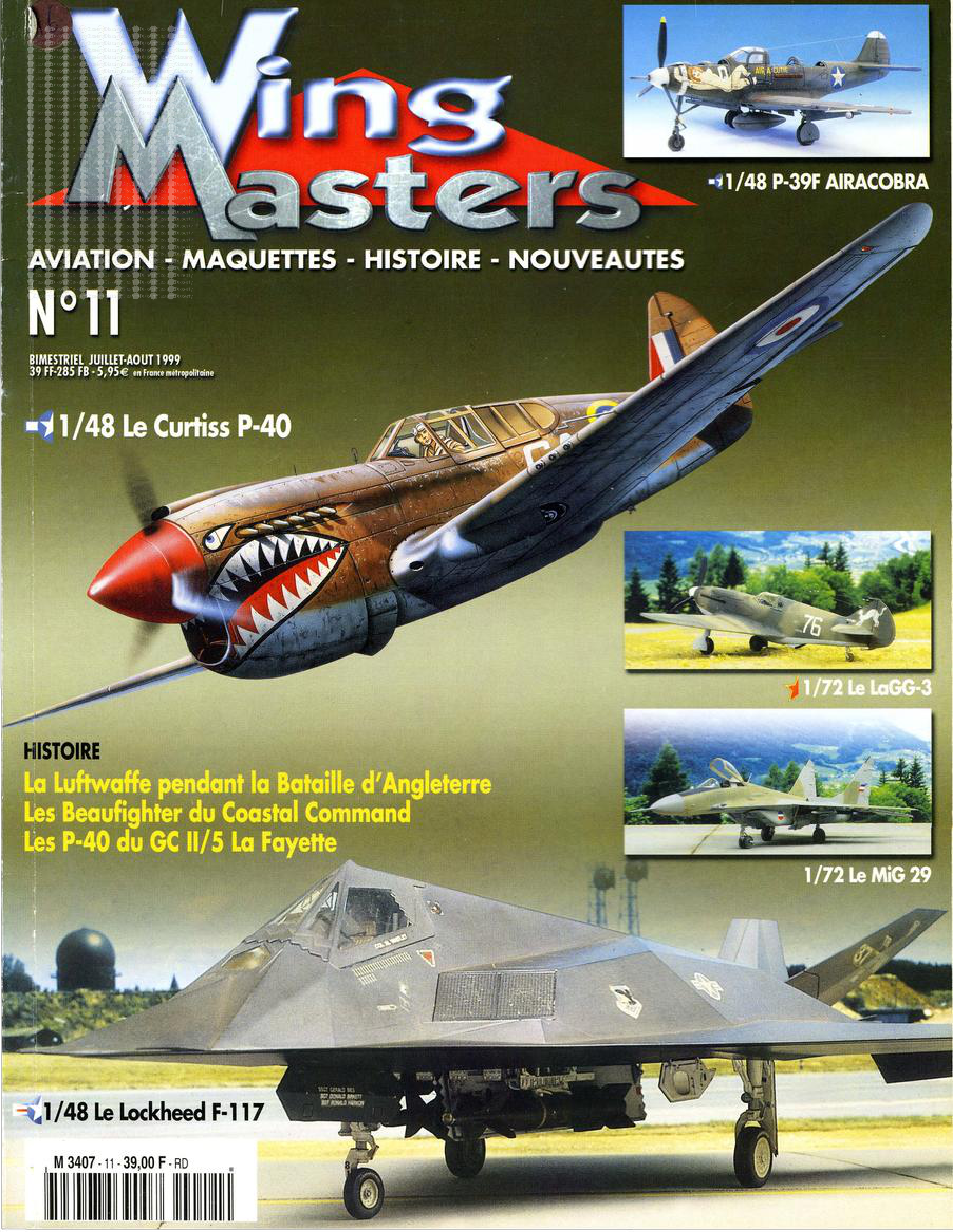







-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 14, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4636MB


