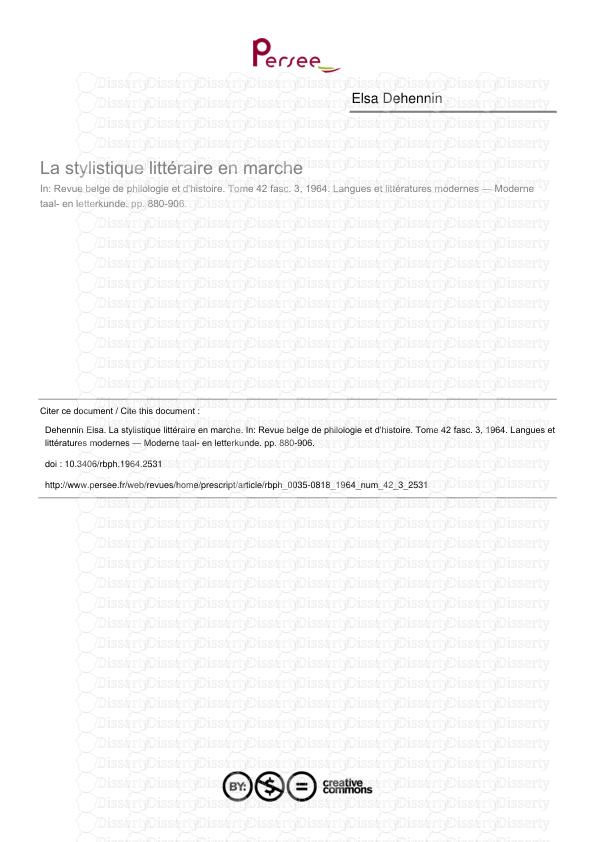Elsa Dehennin La stylistique littéraire en marche In: Revue belge de philologie
Elsa Dehennin La stylistique littéraire en marche In: Revue belge de philologie et d'histoire. Tome 42 fasc. 3, 1964. Langues et littératures modernes — Moderne taal- en letterkunde. pp. 880-906. Citer ce document / Cite this document : Dehennin Elsa. La stylistique littéraire en marche. In: Revue belge de philologie et d'histoire. Tome 42 fasc. 3, 1964. Langues et littératures modernes — Moderne taal- en letterkunde. pp. 880-906. doi : 10.3406/rbph.1964.2531 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_1964_num_42_3_2531 MÉLANGES — MENGELINGEN LA STYLISTIQUE LITTÉRAIRE EN MARCHE On a beaucoup répété, au cours des dernières années, que « nous en sommes à la Tour de Babel» (x) et qu'il y a dans nos disciplines une crise de prin cipe. Cela ne saurait faire de doute, mais l'on aurait tort de se désespérer pour autant. Il existe dans tous les domaines de la philologie des résultats remarquables et il y a moyen de se mettre d'accord pour peu que l'on veuille donner aux conventions du langage critique la précision et la rigueur dont il a besoin. Les grandes difficultés de la critique littéraire proviennent év idemment de son ambiguïté interne : elle doit caractériser une œuvre qui par nature est unique, voire incommensurable, pour l'apprécier, en dernière instance, d'après des critères communs et objectifs et selon une méthode universelle et raisonnable. Sans doute est-il illusoire de concevoir une « sience » (exacte) de la cri tique. Cela n'est, d'ailleurs, pas indispensable ; la controverse qui a surgi à ce propos nous paraît secondaire, voire stérile. Il va de soi que la parole, les chiffres ou le cœur humain ne peuvent pas faire l'objet d'un même type d'investigation. La science se doit avant tout d'adapter ses méthodes au genre de réalités étudiées. La critique sera scientifique dans la mesure où elle sera adaptée à la nature de l'œuvre, où elle restera fidèle à son essence et à son mode d'existence et non dans la mesure où elle s'appuyera sur un type d'analyse mathématique. On observe, dans tous les domaines de l'ac tivité humaine, que la science part de l'hypothèse et aboutit par des expé riences de vérification a un consensus omnium, qui, dans l'immense majorité des cas, est relatif et provisoire (2). Pourquoi n'en serait-il pas de même dans le domaine de la critique ? Elle réussira, tout comme la linguistique ou comme la physique, par ce que G. Guillaume appelle « cette alliance en toute proportion utile de la réflexion abstraite profonde et de Y observation fine du concret» (3). Dans toutes les recherches, même si elles sont conduites par la raison la plus rigoureuse, le hasard, le flair et la chance ont leur part. (1) Cf. Ch. Bruneau, La science de la stylistique : problèmes de vocabulaire, in Cultura Neo- latina, XVI (1956), p. 68. (2) Cf. Id., La stylistique, in Romanic Review, V (1951), p. 1. (3) G. Guillaume, Particularisation et généralisation dans le système des articles français, in Le Français Moderne, avril-juillet, 1944, p. 91. LA STYLISTIQUE LITTÉRAIRE EN MARCHE 881 L'objet propre de la critique ne saurait être que l'œuvre littéraire. Celle- ci peut, bien sûr, faire l'objet de la seule jouissance artistique ou servir de document à toutes sortes d'investigations particulières — psychologiques, psychanalytiques, historiques, sociales, philosophiques ou linguistiques. Mais dans ce cas l'essentiel de l'œuvre d'art est laissé pour compte. Et l'essentiel, il ne faut heureusement plus insister là-dessus, ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas le lecteur, ce n'est pas l'histoire du texte, c'est le texte lui-même, tel que l'auteur l'a achevé, ou, si l'on veut, tel que l'auteur l'a abandonné, car d'a près P. Valéry, l'esprit n'achève rien par lui-même (x). Interrogeons-nous, d'ailleurs, un instant sur l'œuvre littéraire, et plus particulièrement sur l'œuvre poétique (2), qui a fait l'objet d'innombrables études — magistrales et médiocres. Les définitions ne manquent pas : les unes sont tout idéales, les autres plutôt réalistes ; elles changent, en général, avec la poétique des écoles ou des générations qui se succèdent. Par prin cipe, nous nous méfions d'un absolutisme trop platonique et nous essayerons prudemment de nous en tenir à un relativisme modéré. Aussi à la défini tion de S. Dresden, p. ex., — l'œuvre est une sorte d'absolu à la fois indé pendant et incomparable (3) — nous préférons celle de R. L. Wagner : « l'œuvre est ... la solution d'un problème de technique ... la rencontre d'une certaine idée sensible avec une matière aussi peu faite que possible pour l'exprimer et l'harmonisation de leurs exigences» (4) ; ou même celle, moins explicite, de R. Wellek et A. Warren : « the work of art is ... a whole system of signs, or structure of signs serving a specific aesthetic purpose» (5), bien que nous eussions préféré artistique, ou mieux encore, créateur à esthétique, qui concerne, d'après la Vocabulaire technique et critique de la philosophie (6), le Beau. Actuellement les poètes ne cherchent plus à produire la plus ex quise et la plus parfaite beauté, à l'instar de Mallarmé. En Espagne, par exemple, elle a conditionné la poésie de Rubén Dario et de toute son école moderniste ; elle était encore le souci majeur de la jeune génération qui faisait triompher Gongora en 1927, mais elle s'est effacée progressivement à partir de 1928 et, en 1936,1a guerre s'était substituée à elle. Depuis lors, elle ne s'est pas encore remise de ses blessures. Pour C. Bousono, qui est, à la fois, un poète et un critique représentatifs delà dernière génération es - (1) Études sur Mallarmé, in Variétés, II, Paris, 1930, p. 190. (2) II convient de ne pas oublier ce que dit J. Marouzeau, in Précis de stylistique franç aise, Paris, 1941, p. 154 : «A mesure que le souci littéraire intervient, les procédés se multiplient, et la densité du style ... s'accroît pour atteindre son maximum dans la forme poétique, dont le principe est d'enfermer le plus possible d'expressivité dans le minimum d'expression ». (3) Stylistique et science de la littérature, in Neophilologus, 1952, p. 200. (4) Linguistique, in Mercure de France, 1952, p. 737. (5) Theory of Literature, Londres, 1961, p. 141, (6) de A. Lalande, Paris, 1947, p. 290, 882 E. DEHENNIN pagnole, l'acte lyrique est devenu « la trasmisión puramente verbal de una compleja realidad animica ... previamente conocida por el espiritu como formando un todo, una sintesis a la que se anade, secundariamente, una cierta dosis de placer» (1). Désormais, l'œuvre d'art est beaucoup plus qu'un objet de beauté, une structure (2) créatrice verbale. La critique n'a plus à apprécier la beauté qui ne se laisse jamais prouver et qui est sujette aux variations de la mode et du goût. D'après Th. Spoerri, elle doit étudier l'œuvre « en tant que structure structurante, qui décrystallise les structures figées et construit ... des structures nouvelles dans ceux qui participent à son mouvement constructeur» (3). Bien que nous ne partagions pas toutes les vues idéalistes de Spoerri, qui concordent, pour une grande part, avec les principes de P. Valéry, il nous faut reconnaître que le maître suisse a dégagé des éléments d'une critique positive valable et très précise. Il n'empêche que nous doutons fort qu'une critique objective puisse ar river à la connaissance de l'œuvre par une sorte de co-naissance, pour em ployer ce terme claudélien, par une participation active à l'acte créateur, par une véritable re-création (4). Cela n'équivaudrait-il pas à reconstituer par un effort d'imagination « le drame intérieur sublime » que cherche Val éry et qui, d'après lui, est essentiel (5) ? Certes, Valéry y est parvenu en étudiant l'œuvre de Mallarmé. Mais un critique de moindre envergure, qui ne serait pas auteur aurait-il su éviter de se substituer à l'écrivain et de se perdre dans la mythification ? Il y a là en tout cas un écueil que le cri tique modeste devrait éviter. Même s'il doit participer à l'œuvre d'art, comme le préconise Spoerri, il ne peut oublier que l'œuvre, qui est toujours « en voie de création », pour l'auteur, constitue pour lui ce que Valéry lui- même appelle « un système clos de toutes parts, auquel rien ne peut être modifié» (6). Il importe que le critique soit plus qu'un participant, un ob servateur perspicace de cet ensemble (7) et qu'il soit en mesure de mettre en évidence sa structure essentielle. (1) Teorla de la expresión poëtica, Madrid, 1952, p. 22. (2) Structure est pris ici « en un sens spécial et nouveau », attesté par A. Lalande, op. cit., sous Structure, Β : « pour désigner, par opposition à une simple combinaison d'élé ments, un tout formé de phénomènes solidaires, tels que chacun dépend des autres et ne peut être ce qu'il est que dans et par sa relation avec eux». (3) Th. Spoerri, Éléments d'une critique constructive, in Trivium, 1950, p. 165. (4) Ce point de vue est partagé par de nombreux critiques, e.a. par G. Michaud, L'oeuvre et ses techniques, Paris, 1957, qui parle même de «participation existentielle» (p. 15). (5) M. Bémol, La méthode critique de Paul Valéry, Paris, uploads/s3/ la-stylistique-litteraire-en-marche-pdf.pdf
Documents similaires










-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 21, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.0204MB