PIERRE KLOSSOWSKI PIERRE KLOSSOWSKI CATHERlNE GRENIER BERNARD BUSTÈNE CLAUDE RI
PIERRE KLOSSOWSKI PIERRE KLOSSOWSKI CATHERlNE GRENIER BERNARD BUSTÈNE CLAUDE RITSCHARD PASCAL BONITZER MARIE-DOMINIQUE WICKER ANTHOLOGIE DES ÉCRITS DE PIERRE KLOSSOWSKI SUR L'ART FRANCO CAGNETr A ANDRE MASSON PIERRE ZUCCA L'ÉTAT DES LIEUX LA DIFFERENCE/CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES Anthologie des écrits de Pierre Klossowski sur l'art La Judith de Frédéric Tonnerre * Maintes fois traité par leŏ anciens maitres. plus rarement par les modernes jusqu'à dispa raitre tout à fait. le s'Ujet de Judith et Holo pheme a été repris par 'fonnerre de façon répréhensible. mais avec l'aplomb qui caracté rise les travaux de sa meilleure quoique brève période (1865-73). - si toutefois l'on consent à admettre sa manière d'imagier subcil sous son apparente vulgarité, au lieu de condamner en bloc ses travaux comme autant d'appendices inévolués de la grande peinture, et particulière ment sa Judith. et cela au nom d'une tradition i<:onographiq ue dont ce tableau semble se réclamer frauduleusement. Le réalisme. tempéré de rêverie et de reflets néoclassicistes, qu'il tient d'une triple. succes sive influence (Courbet dont il fut l'élève, après Chassériau et Ingres) n'en est pas moins fortement équilibré par un métier accompli et sans tricherie. et une franchise pleinement éduquée. qui le préserve de tomber dans les déliquescences poétiques où un Gustave Mo reau a fini par se complaire. Aussi bien pour juger sa Judith et la décrire. faudrait-il retrouver la sobriété sinon la naïveté convenue d'un amateur des Salons de Diderot, - d'autant que pareille entreprise ne disposait encore d'aucune théorie ni d'aucune subversion systématique pour se défendre. et ne prétendait non plus à aucune démonstration académique. si ce n'est d'affirmer avec de solides moyens le plaisir de représenter ses émotions. Et puisque nous avons affaire ici à l'un des Nus de Tonnerre, - mais quel ! - voyons ce qui empêcherait de ranger cet élève oublié de Courbet parmi les maitres du Nu traditionnel, du Nu en tant que sujet, dès lors que sa Judith, ' ln figv.rtཱྀ. septembre 1961. Paris. 162 quant à la facture et la mise en page. témoigne de l'identité entre la nature et Je style que tous les maîtres du genre ont observée.·-- dégageant le style dans la nature en effet. élaborant leur vision de la nudité féminine d'après un en semble de points de repères émotifs, les accentuant tantôt ici. tantôt là selon li! tempéra ment et l'humeur. les agençant à la faveur de tel ou tel aperçu du corps dans l'espace. Et il n'y aurait point de style :;i les structures naturelles ne coïncidaient. de façon contrariante, éprou vante pour le savoir-faire de l'artiste, avec les points de repères émotifs que sont toujours tant pour le contemplateur que pour l'artiste. les différentes zones du corps féminin : col. épaules, seins, ventre. flancs. chute des reins. cuisses, genoux et mollets, que les attitudes, soit de tnise en mouvement. soit de repos. soit de la position à la renverse ou de la station debout. doivent mettre en valeur. Or. dans le Nu-sujet. les attitudes quelles qu'elles soient. restent, quant à l'effet totalement subordon nées à l'ex.pression de la physionomie même en laquelle se reflètent encore une fois toutes les nuances d'un état actif ou passif, et qui permet à pareilles œuvres d'enfermer le contemplateur dans leur nécessité. Sur un fond vaporeux de tentures bleu sombre se détache, de face. dans toute sa nudité, la grande jeune femme accroupie. le front incliné, ceint d'un diadème, couvant du regard l'énorme tête de I' Assyrien décapité qu'elle tient entre ses cuisses - visage de madone aux paupières baissées. les ailes du nez fortement accusées. humant presque le pos thume assouvissement de l'homme puni, mais respirant le sien propre. Les fossettes aux joues. la moue de ses lèvres satisfaites plutôt que priantes, l'immodestie de ses triomphants appas, l'indécence de la pos ture donnée à cette figure monumentale - si Holopherne sans tête se fût avisé lui-même de la peindre, l'effet n·en eût pas été plus maléfi que! Observons l'élan du buste et du torse de ce corps féminin. haut et immobile. suivons. dans ses angles et ses courbes. le mouvement des bras. qui va s'articulant depuiDZ les doigts de la main écartant le voile jusqu'à l'extrémité de l'autre main. qui repose sur la face d' Holo pherne dans la partie inférieure du tahieau. Et d'abord. la force pleine. comme soupesée. des épaules et des seins à l'épiderme poli. aux teintes ivoirines. la le gère torsion du cou transparent. commandée par l'inclinaison i1 peine indiquée du front el du visage aux .ioues veloutées. A hauteur desquelles. perpendicu laire. 1 ·avant-hras dres.Dze. retournant. vers l" oreille. la main vue de dos, d'un geste désinvolte de ses doigts effilés re_jetant le voile qui. attaché au diadème. flotte dessus l'épaule. geste valant un soupçon de coquetterie. dans le rapport de la main au contour du visage. rehaussant le plein des joues. les arcades des sourcib. les paupières baissées ; l'intense recti tude du neL. les lèvres bien fendues.. les fosse.ttes du sourire et la presque vorace fermeté du menton. A quoi s'ajoute la ligne ondoyante du cou. la rondeur des epaules. l'onctueuse sphericité des seins. qui sollicitent a l'excès la tactilité même du contemplateur. Le geste de la main écartant le voile hausdze légèrement le contour de l'épaule. ménage.ant un vide où se découpe la longue encolure. l'autre épaule sïnf!échissant d'un degré dans l'allongement du bras gauche, lequeL pressé contre le sein. en r.elève un peu le mamelon. mettant une asymétrie dans la disposition de la gorge. bien soutenue. en des teint es de jaune moyen et de Sienne' naturelle. et donnant de l'animation dans la région dessus le dôme du ventre, d'un ocre scintillant. que. contourne ravant-bras dessus le pubis sans pour autant le dissimuier. mais avanç<mt la main. appuyée de ses longs doigts sur les paupières entrouvertes d · H'o loph erne . Mais à quelques pas de recul. la configuration de cette Judith ne laisse pas d'évoquer celle d'une immense locuste. S'appuyant de la main sur la tête tranchée d 'Holopherne. elle est campée, le mollet au puissant galbe ramené contre la cuisse. le pied posé sur le linge du lit, un peu en deçà du niveau où gît ia tète de l'homme - ce qui, en contraste avec le rayonnant visage qui domine. a pour effet d'accentuer le caractère animal de la posture. réservant à la vue en cett:Ǵ partie inférieure l'en-dessous de la cuisse écartée dont on remonte le muscle en saillie et dont on retrouve. sous le mollet. au niveau de la cheville. le pli sïncurvant à la naissance de la fesse lëgèrement rebondie - là où se renouvel lent des nuances de jaune moyen et de vermillon. tandis que l'autre jambe offre, ù gauche du tableau. le. volume en fuseau de la cuis.ǵe étalée que frôle la chevelure de l'homme. jusqu·au genou au bord de la couche dont le linge forme. la hase du tableau. Quant à Holopherne. quant à ce qui reste de lui - plus qu'ailleurs ici la partie vaut le tout ! Ouelle lubricité s'en alla avec le tronc. la tête. par sa seule dimension. en serait le gage. qui. retranchée dans l'ivresse. en concentre pour lors la sinistre amertume -- sa barbe nous cache sa plaie : mais, tel quel. réduit ù la seule expression d'un regard éteint. à rout jamais fixe sur la cause même de son extinction. gisant là. ü défaut du corps - quel cri véhément frustre sa bouche. horriblement béante entre les cuisses de sa meurtrière. prompte à noyer dans le sang l'infamie assumee. tant que docile i1 l'odieuse étreinte ·1 Or. pareille té.te ne différerait en rien de celle plus d'une fois entrevue. livide. dans 1 'iconogra phie biblique. de Goliath, pendue aux frêles phalanges des doigts du pâtre, ni celle du Baptiste sur le plat de la danseuse - n'était ici le lieu où Tonnerre a choisi de la disposer et la faire figurer sur son tableau. placée sur le linge du lit, contre le pubis de son exécutrice. mélant sa chevelure crêpelée et sanglante ft la fauvi: toison. naguère. visitée, de l'héroïne, que Ton nerre osa peindre-·- n'était la main de Judith. n'etaient ses doigts. lesquels. après un jeu de feinte docilité, viennent, de leur pulpe. effleu rer leǶ paupières du décapité. 163 Quelle est ici l'idée de Tonnerre ? Quelle est cette pudeur inversée de Judith '? Craint-elle encore d"étre vue par lui davantage qu'elle ne se montre au contemplateur. ou Holopherne voit-il dës ce moment Iཿ ciel ? L'artiste a-t-il cedé à la tentation de montrer deux choses dans un seul geste. quïl appartient pour lors au contemplateur de démëler ? N'a-t-il pas voulu trop insister sur un mouvement dans l'âme de la justiciëre qui exclurait chez elle la simplicité de l'héroïne, la candeur de la sainte ? Ses doigts allongés. et peints avec tant de délicatesse. et qui font de cette main féminine et hardie une tache chaude sur le fond cireux de la tëte exsangue. traduiraient un ultime ressentiment. l 'omhre d'une émotion que !'Esprit uploads/s3/ anthologie-des-ecrits-de-pierre-klossowski-sur-lart-1990.pdf
Documents similaires

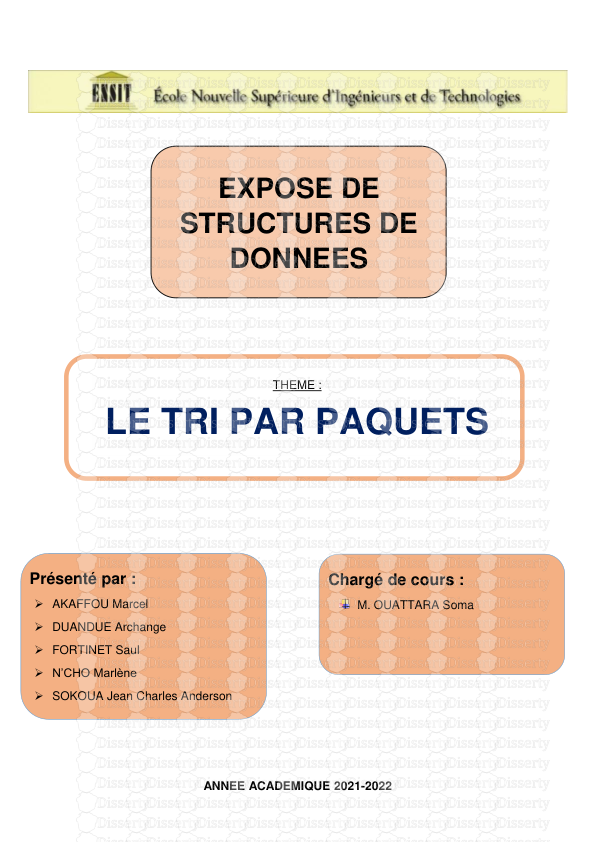
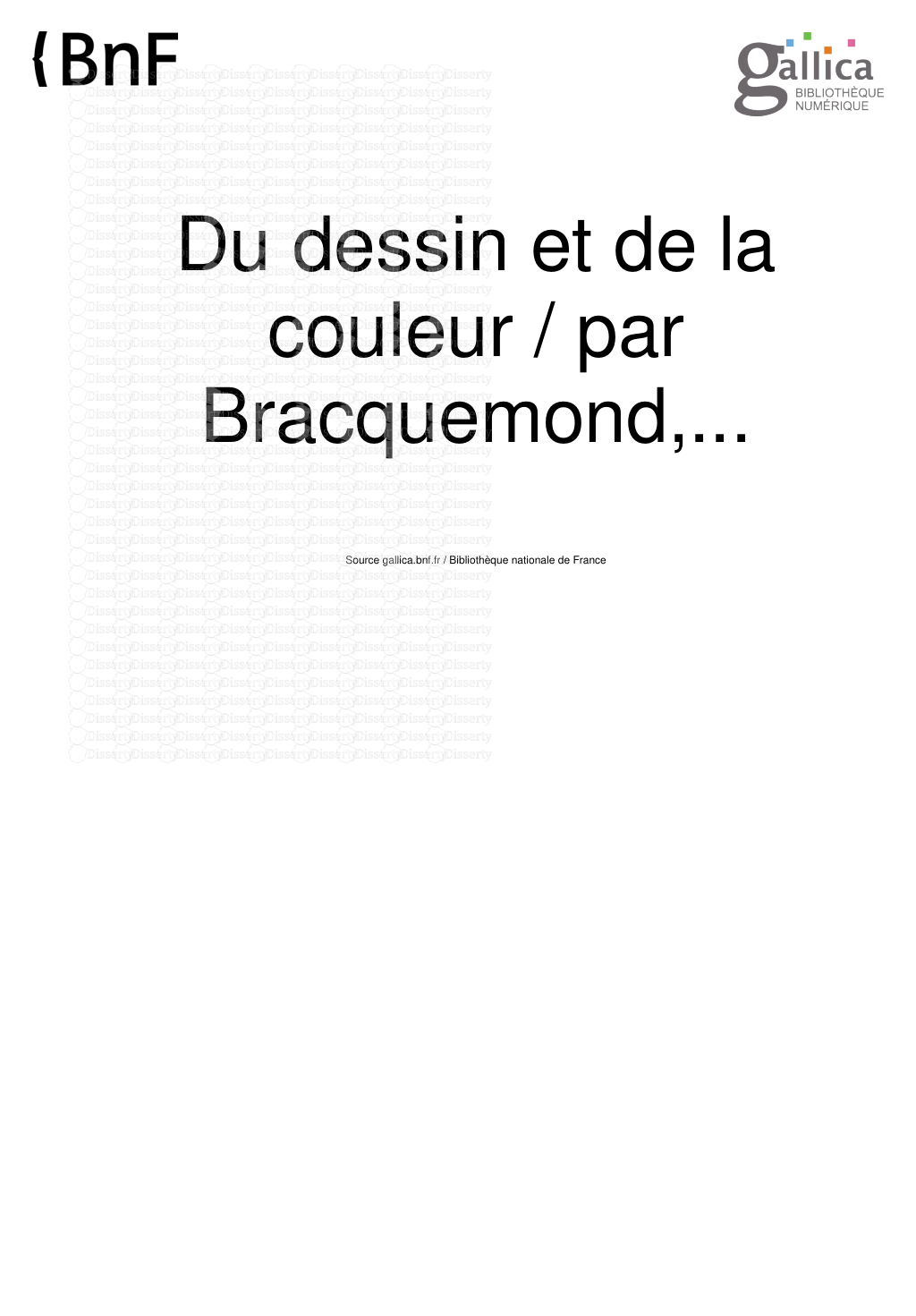







-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 30, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 5.2170MB


