LLE TEXTE ÉTRANGER L#8 QQQL’INTIME ET LE POLITIQUE DANS LA LITTÉRATURE QQQ Q QQ
LLE TEXTE ÉTRANGER L#8 QQQL’INTIME ET LE POLITIQUE DANS LA LITTÉRATURE QQQ Q QQQET LES ARTS CONTEMPORAINS QQQ QQQNuméro coordonné par QQQ QQQFlorence Baillet et Arnaud Regnauld QQQ QQQUniversité Paris 8 QQQ POUR CITER CET ARTICLE Alain Alberganti, « De l’espace du dedans à l’espace du dehors dans l’art de l’installation immersive », Le Texte étranger [en ligne], n° 8, mise en ligne janvier 2010. URL : http://www.univ-paris8.fr/dela/etranger/pages/8/alberganti.html ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL « L’INTIME ET LE POLITIQUE » 2 DE L’ESPACE DU DEDANS À L’ESPACE DU DEHORS DANS L’ART DE L’INSTALLATION IMMERSIVE Alain Alberganti UNIVERSITÉ PARIS 8 PRÉAMBULE: L’ESPACE ABSTRAIT DU LIEU DE RÉUNION L’endroit où nous sommes ici réunis est un lieu qui délimite un espace. Le lieu est visible mais l’espace, à proprement parler, ne l’est pas. Les Anciens l’appelaient le génie du lieu et ils personnifiaient une localité par un dieu, ou une déesse, spécifique symbolisant ses qualités et ses potentialités. En bons rationalistes, nous avons cessé de croire aux dryades, aux nymphes et aux génies, mais nous ne pouvons nier que tout lieu se caractérise par un ensemble d'attributs qui le rendent unique. En général, nous percevons l’espace à travers les vides du lieu. Ainsi, ce lieu où nous sommes, pour que puisse avoir lieu cette réunion, est occupé par des tables, des chaises, des objets divers, ainsi que par des vides entre tous ces objets. Ce lieu nous apparaît comme un lieu de réunion du fait d’une certaine distribution des pleins et des vides : disposition des chaises et des tables qui impose une certaine frontalité aux usagers. Ce dispositif spatial est celui d’une salle de réunion pour parler et écouter. Le lieu a été choisi, une salle de la ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL « L’INTIME ET LE POLITIQUE » 3 Maison Heinrich Heine à la Cité Universitaire de Paris, mais qu’en est-il de l’espace ? A-t-il été choisi ? Il semble qu’il était donné d’avance et que l’espace ne posait pas de question. Il se devait d’être, comme toute salle de réunion, un espace purement et absolument fonctionnel, autrement dit, un espace abstrait. Pourquoi portons-nous si peu d’attention et de soin à l’espace ? Et pourtant, combien l’acte même de penser s’appuie à tout instant sur notre conception de l’espace pour donner forme à nos idées. Comme le notait Gaston Bachelard, la métaphysique la plus profonde est enracinée dans une géométrie implicite qui spatialise la pensée1. 2. TYPOLOGIE ET RAPPEL HISTORIQUE D’un point de vue spatial, nous pouvons diviser l'art de l'installation en deux grandes catégories. Les installations non immersives, qui s’apparentent à une organisation frontale d’objets dans l’espace que le spectateur contemple à distance. Dans ce cas, le lieu et le mode d’exposition sont identiques à ceux d’une sculpture ou d’un tableau. Dans une seconde catégorie, nous regroupons les installations immersives. Elles inventent une relation esthétique tout à fait inédite puisque le spectateur peut pénétrer et marcher dans l'œuvre d’art. Cette relation instaure un lien intime avec l’espace plastique par le simple fait d’« être-dans », et non plus seulement devant. L’art de l’installation, apparu dans les années 1960, est l’aboutisse- ment d’une saillie de l’espace pictural en direction du lieu d’exposition à partir de la « dissolution » du cadre du tableau. D’objet contenu et contemplé dans un espace neutre, l’œuvre d’art, avec l’installation immersive, devient un espace généré par des objets qui l’habitent et par des visiteurs qui la parcourent. Il est, d’une part, l’héritier de l’art minimaliste, pour ce qui est de l’attention portée au contexte et au 1 Gaston BACHELARD, Poétique de l’espace, PUF, 1974, p. 191. ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL « L’INTIME ET LE POLITIQUE » 4 corps du spectateur, et, d’autre part, de l’art conceptuel, en ce qui concerne la mise en question de la définition même de la notion d’art. 3. « LE MONDE EST ILLISIBLE, MON CŒUR SI » L’installation immersive, intitulée « Le monde est illisible, mon cœur si », a été créée en 2002, par le plasticien Sarkis, au Musée d’Art Contemporain de Lyon2. Elle a été exposée en trois temps, sous trois formes successives que Sarkis appelle des « scènes », en référence au théâtre. La première de celles-ci, intitulée « La brûlure », est un espace où sont assemblés des objets de mémoire. Ils représentent pour l’artiste des « trésors de guerre » qui possèdent un coefficient d’intimité très élevé. Ils se répartissent en trois groupes. En premier lieu, des objets liés à sa vie personnelle : la maquette d’une chambre dans laquelle il a vécu et travaillé de longues années, ou bien, les modèles réduits et carbonisés d’un atelier. Par ailleurs, nous trouvons des objets liés à des évènements du monde, tels qu'une image de la bibliothèque de Sarajevo détruite en 1992 ou des mannequins recouverts de tissus sous lesquels ont été placées des bandes magnétiques avec l’enregis- trement d’une journée de travail à l’usine Renault de Sandouville. Enfin, des objets-événements purement plastiques, tels que la vidéo d’une flamme peinte à l’aquarelle ou celle de têtes en cire qui brûlent. Tous ces objets sont sous le signe de la brûlure comme contact intime avec le monde. Ils baignent dans une lumière rouge et dans la musique religieuse d’une cantate de Bach. 2 Cf. catalogue de l’exposition « Le monde est illisible, mon cœur si », 02 février-18 mai 2002, MAC de Lyon, 5 Continents, 2003. ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL « L’INTIME ET LE POLITIQUE » 5 Dans la seconde scène, tous les objets sont recouverts de tapis turques (kilims). La lumière rouge reste la même, mais la musique est celle de Morton Feldman qui donne à entendre des motifs sonores répétitifs à l’image de ceux imprimés sur les tapis. L'espace narratif de la première scène s'est métamorphosé en un espace décoratif qui valorise la surface et la forme des objets. Nous sommes dans « L’espace de musique » où l’incandescence s’apaise avec l’œil qui écoute. D’un espace d’intimité avec soi, et avec le monde, nous sommes passés à un espace plus impersonnel, abstrait du précédent par recouvrement. Dans la dernière métamorphose de l’installation, la forme même des objets de mémoire disparaît pour laisser place à des objets actuels. Cette scène s’intitule « L’ouverture ». Des journaux du jour, éparpillés au sol, sont agités par de l’air qu’une tuyauterie pompe à l’extérieur du musée. Dans cet espace plastique silencieux uniquement fait d'air, de journaux et de lumière rouge, le public est convié à se rencontrer et à rencontrer l’artiste, pour parler de l’état du monde et de ce qu’il pourrait être. Ainsi, un espace commun d’échanges est proposé à l’intérieur même de l'espace plastique de l'œuvre. L’espace de temps entre les scènes de ce triptyque temporel ne doit pas être considéré comme un espace et un temps morts. D’un point de vue esthétique, il appartient pleinement à l’œuvre. Il vise à laisser se déposer une présence intériorisée de celle-ci. Il se crée alors une paroi discrète entre le réel et l’art. L’existence quotidienne du visiteur qui s’écoule entre les strates de l’œuvre est ce qui permet de mêler l’art et la vie de façon à créer un lien intime avec l’œuvre par une mémoire de celle-ci. ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL « L’INTIME ET LE POLITIQUE » 6 4. UN LIEN INTIME AVEC L’ESPACE PLASTIQUE Un des enjeux majeurs de l'installation immersive de Sarkis est la création d’un espace plastique collectif basé sur une expérience spatiale individuelle. Marcher dans une œuvre d’art, se déplacer dans un espace plastique, constitue une révolution copernicienne dans la relation esthétique du spectateur à l’œuvre. Le visiteur de l’installation expérimente un double lien d’intimité avec l’œuvre et avec soi. Il est à l’intérieur de l’œuvre et il intériorise l’espace de celle- ci en se l’appropriant. Être à l’intérieur, pouvoir toucher, pouvoir marcher, pouvoir faire son chemin à travers l’œuvre, pouvoir choisir ses propres points de vue, ses propres rythmes, noue un lien intime avec celle-ci. Les objets ne sont pas exposés dans un espace neutre et abstrait, comme celui d’un musée ou d’une galerie. Ils communiquent entre eux, et la résonance de leurs échanges constitue le principal point de repère pour la déambulation du visiteur, qui se fait plus hésitante et plus hasardeuse qu’à son habitude. Des immobilités s’opèrent et des accélérations affleurent. De nouvelles questions surgissent : où aller ? que regarder ? que penser de cela ? et les autres, que font-ils ? Ces questions résultent d’un processus de subjectivation qui mène le visiteur à une appropriation de soi par soi. Cette production de subjectivité ne doit pas s’entendre comme celle d’un moi personnel ou psychologique. Il s’agit d’une production inventive de soi en tant qu’autre3 à travers l’invention d’une pratique d’espace. En ce sens, produire de la subjectivité, c’est être au contact avec ce que nous sommes en train de devenir. Et, bien que le visiteur réagisse encore souvent en assimilant l’installation immersive à un micro-musée d’objets à contempler, il sent confusément combien il entre ainsi en résistance avec l’espace 3 Expression inspirée par uploads/s3/ alberganti.pdf
Documents similaires


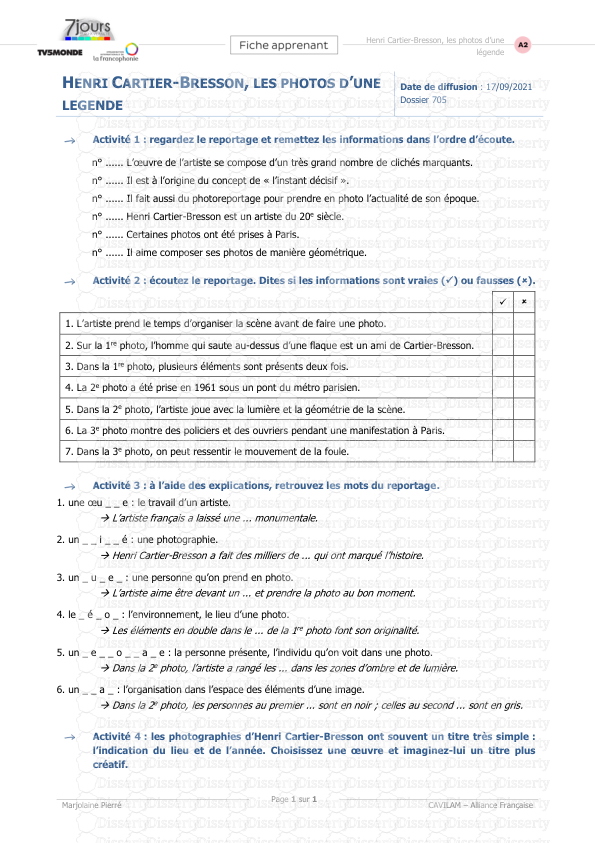







-
115
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 08, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3522MB


