DROIT ADMINISTRATIF 11.09.2020 PLAN : Introduction – (séance 1) Chapitre 1 : L’
DROIT ADMINISTRATIF 11.09.2020 PLAN : Introduction – (séance 1) Chapitre 1 : L’acte administratif 1 – La notion d’acte administratif – (séance 2) 2 – Le régime de l’acte administratif – (séance 3) Chapitre 2 : Le contrat administratif 1 – La notion de contrat administratif – (séance 4) 2 – Le régime du contrat administratif – (séance 5) Chapitre 3 : La légalité 1 – Le contrôle de légalité – (séance 6) 2 – La norme constitutionnelle – (séance 7) 3 – La norme internationale et de l’UE – (séance 8) 4 – Les circonstances exceptionnelle – (séance 9) 5 – Le droit souple – (séance 10) 6 – Les mesures d’ordre intérieur – (séance 11) BIBLIOGRAPHIE : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), Grands arrêts, Dalloz Les grandes décisions de la jurisprudence, Thémis, Puf Les revues de droit administratif (AJDA, Droit Administratif, JCP A, RFDA…) Les conclusions des rapporteurs publics Manuels : P.-L. FRIER, J. PETIT, Domat, Montchrestien Y. GAUDEMET, Manuel, LGDJ M. LOMBARD, G. DUMONT, J. SINIRELLI, Hypercours, Dalloz J. MORAND-DEVILLIER, P. BOURDON, E. POULET, Cours, LGDJ B. PLESSIX, Manuel, Lexis Nexis D. TRUCHET, Thémis, Puf P. SERRAND, Droit Fondamental, Puf J. WALINE, Précis, Dalloz B. SEILLER, Droit administratif, Flammarion => revue générale du droit : site en ligne, manuel gratuit de droit administratif MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES : Écrit de trois heures (cas pratique, commentaire, dissertation ou questions de cours) Pourquoi le droit administratif ? • Régit le fonctionnement des services publics (Etat, collectivités territoriales, établissements publics…) • Régit les relations entre les citoyens et l’Administration (utilisation domaine public, urbanisme, expropriation/préemption…) • Connaissances nécessaires pour le droit privé (concurrence, expropriation phase judiciaire, droit pénal de l’urbanisme et des marchés publics…) • Matière incontournable des concours d’accès aux fonctions publiques • Débouchées dans l’administration mais aussi dans les entreprises (marchés publics, construction…) • Modèle du raisonnement juridique • Intérêt pour tout citoyen afin de se défendre contre l’administration (absence de ministère d’avocat pour le REP) INTRODUCTION HISTOIRE Le droit administratif est une matière très ancrée dans la société française. La culture française est une culture qui est fondée sur la centralisation et sur un certain autoritarisme. Cette centralisation vient du lendemain du MA avec le Royalisme qui s’est renforcé jusqu’à devenir une monarchie absolue. Dès la mise en place du royalisme (13ème siècle), il s’est accompagné de la mise en place d’un droit administratif car un pouvoir centralisé a besoin d’un droit administratif. Très tôt il a été mis en place l’existence d’un droit, d’un conseil spécifique auprès du royaume. L’existence à la fois d’une juridiction spéciale (Conseil du Roi) et d’un droit spécifique (droit administratif) est culturellement assez ancien et plutôt intégré en France. Au 18ème siècle Portalis disait que les litiges du droit administratif devaient être réglés par l’administration elle-même. Le fait que la France soit un Etat centralisé depuis longtemps n’est pas sans lien avec l’existence d’un droit spécifique, le droit administratif. Sous l’Ancien régime il y a eu une « fraude des Parlement » certains Parlement ont refusé d’appliquer des Édits royaux et prenaient parti pour le peuple. Dans cette période très tendue survient la révolution. La première chose que font les révolutionnaires est d’écarter le juge judiciaire et vont donc finalement dans le même sens que le pouvoir royal antérieur. Aujourd’hui les hommes politiques en France n’aiment pas les juges, c’est une culture, la justice en France est le dernier budget de l’Etat. La séparation des pouvoir crée alors la séparation des autorité administrative et judiciaire alors que ce n’était pas une évidence, c’est une option politique voulue lié à la culture française. Au cours de la période révolutionnaire de nombreuses réclamations des administrés arrivent, tellement que le pouvoir administratif central se retrouve submergé. Les litiges augmentent et il devient de plus en plus difficile de cumuler la fonction d’administrateur et de juge. Au moment où Napoléon arrive au pouvoir en 1799, il va instaurer un organe spécifique : le Conseil d’Etat qui est chargé à la fois de conseiller le Consul et de rédiger des projets de décisions qu’il va valider. La naissance du Conseil d’Etat est un évènement historique mais il a fallu du chemin pour arriver à la juridiction qu’elle est aujourd’hui. Le Conseil d’Etat est à l’époque doté d’une fonction consultative et de contentieux. Le Conseil d’Etat va progressivement gagner en autorité et en autonomie jusqu’à devenir complètement autonome en 1872, on passe d’une justice retenue (par le pouvoir central, l’administration) à une justice déléguée. [Tribunal des conflits, 8 fév. 1873, Blanco : la responsabilité de l’administration : « ne peut être réglée par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier », « elle a ses règles spéciales, qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés »]. La création d’un tribunal administratif permet en premier lieu de mettre en place des règles spéciales, plus favorables pour l’administration (pour l’Etat). L’administration se crée sur un droit inégalitaire. Les libéraux royalistes ont d’abord critiqué le Conseil d’Etat mais ils ne l’ont jamais supprimé lorsqu’ils se sont retrouvés au pouvoir. Les choses vont ensuite progressivement se normaliser. Le Conseil d’Etat est d’abord une juridiction placée auprès du souverain. Il faut attendre 1953 pour que les conseils de préfectures soient séparés de l’organe (de la préfecture elle-même). En 1990, on décide de confier au vice-président du Conseil d’Etat une réforme des juridictions administratives, la Cour administrative d’appel va être créé en 1997. La structure de la juridiction administrative se rapproche alors de la structure judiciaire. La juridiction administrative n’est reconnue au niveau constitutionnel qu’en 1987 [Décision du conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 : « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif » (PFRLR)]. La France n’a ratifié, accepté la juridiction la juridiction de la Cour EDH qu’au dernier moment à la fin des années 70. Et ce n’est donc qu’à partir des années 90 que la France va être pointée du doigt sur un certain nombre de problématique par la Cour EDH. La Cour EDH va s’intéresser de plus en plus à la question du procès équitable et que l’organisation des juridictions devait être équitable. En 1995 le Luxembourg [CEDH, 28 sept. 1995, Procola c/ Luxembourg] est condamné par la CEDH car ce sont les mêmes juges qui conseillent et qui juge (pas de procès équitable), en France c’était la même chose. En 2001 la CEDH condamne la France pour la même raison, elle ne condamne pas tout car il y a négociation, la CEDH va valider l’existence d’une juridiction administrative indépendante mais va pointer du doigt le fait qu’il existe un Commissaire du gouvernement qui a la fois est membre de la juridiction, fait la décision, s’exprime comme s’il été indépendant à l’audience puis ensuite assiste au délibéré et il n’y avait pas de possibilité de répondre aux conclusions du délibéré (pas de contradiction), la France a donc été condamné pour cela (à plusieurs reprise). [CEDH, 7 juin, Kress c/ France] Le Conseil d’Etat a donc été réformé avec des changements de noms : le commissaire du gouvernement devient rapporteur public en 2009 et on a changé l’ordre des paroles dans l’audience, le rapporteur public n’était plus le dernier à parler (possibilité de réponse/contradiction). Aujourd’hui toute l’audience repose sur la réponse au rapporteur public [Decr. N° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions] LA DÉFINITION DU DROIT ADMINISTRATIF Pourquoi le définit-on ? Car on passe d’une société assez simple au niveau de l’organisation. Le droit administratif était un droit principalement jurisprudentiel. Le débat Hauriou / Dugit HAURIOU exprime des idées conservatrices sur l’Etat et ce que doit être le droit administratif c’est-à-dire relever d’une juridiction spécialisée. Il doit y avoir un droit spécifique là ou l’Etat a des prérogatives DUGUIT est un progressiste très ouvert sur les idées communistes et socialiste. Il va écrire un dogme : tout doit se rapporter au service public, c’est le service public qui fait la spécificité. Sa thèse ne fonctionnera pas dans l’administration. Dans les grands auteurs on cite aussi VEDEL, c’est l’époque ou le Conseil Constitutionnel va émerger, selon lui tout s’explique par la constitution (théorie organique). WALINE va beaucoup parler de l’intérêt général. CHAPUS a aidé à concilier le service public et la puissance publique. 18.09.2020 Chapitre 1 : L’acte administratif J. WALINE, Précis, Dalloz (consultable en ligne) -> p 452 et 462,463 B. SEILLER, Droit administratif, Flammarion -> Tome 2, p 121 et s. L’acte administratif (unilatéral) est le mode d’action le plus classique et le mode de référence de l’intervention administrative. Il s’oppose au contrat, il y a deux outils juridiques, 2 modes d’actions administratif. La notion est une analyse en quelque sorte de l’objet d’étude (ici l’acte uploads/s1/ cour-droit-admin-2020 1 .pdf
Documents similaires




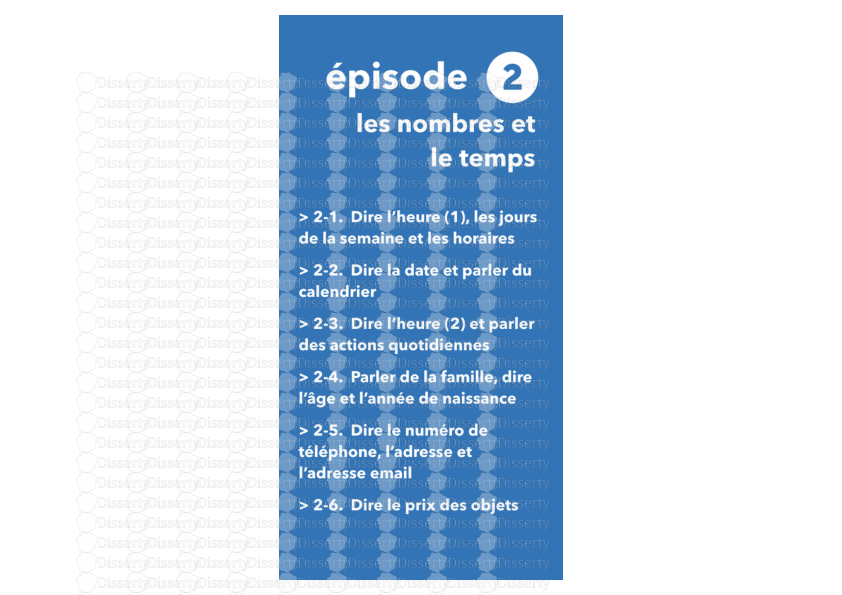





-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 22, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.5166MB


