L'Anthropologie de la maladie Marc Augé Citer ce document / Cite this document
L'Anthropologie de la maladie Marc Augé Citer ce document / Cite this document : Augé Marc. L'Anthropologie de la maladie. In: L'Homme, 1986, tome 26 n°97-98. L'anthropologie : état des lieux. pp. 81-90; doi : https://doi.org/10.3406/hom.1986.368675 https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1986_num_26_97_368675 Fichier pdf généré le 10/05/2018 Creative commons L'Homme 6 MARC AUGE L’Anthropologie de la maladie Marc AUGE, L’Anthropologie de la maladie. — L’étude des systèmes d'inter- prétation de la maladie devrait éclairer le débat toujours réouvert depuis Lévy- Bruhl sur la rationalité des croyances « primitives ». Si l’anthropologie dite médicale ne remplit pas ce rôle, la faute en est à son penchant pour les schémas diffusionnistes et le recours aux typologies. Or les représentations de la maladie, parce qu’elles procèdent toutes d’un certain sens de l’observation et de l’expérience du corps, devraient aider à comprendre comment les systèmes nosologiques les plus divers peuvent s’appréhender comme des combinaisons singulières d’éléments universels. Si je préfère parler d' « anthropologie de la maladie » plutôt que d’« anthropologie médicale » (expression américaine la plus usuelle) c'est pour deux ordres de raisons. En premier lieu je pense qu'il n’y a qu'une anthropologie qui se donne des objets empiriques distincts (la maladie, la religion, la parenté, etc.) sans se diviser pour autant en sous-disciplines. Il n'est pas sûr que l’ensemble de ces « objets empiriques distincts », de ces objets d'observation, ne constituent pas dans le regard de l'anthropologue, au terme de son effort de construction, un objet unique d'analyse. Quelle est alors la nature de cette unicité ? C'est toute la question, et l'anthropologie de la maladie peut nous aider à y répondre. En second lieu le terme « medical anthropoiogy », dans l’usage qu'en font les chercheurs américains, a surtout un intérêt en quelque sorte administratif et stratégique : il s'agit de rassembler sous une même éti- quette (pour faire masse, ce qui peut avoir de l’intérêt quand on veut obtenir des crédits) des recherches aux finalités intellectuelles différentes qui n'ont en commun que leur objet empirique d’occasion, à condition de définir celui-ci de façon assez lâche : l’épidémiologie, l'étude des soins délivrés en institution (« health care delivery Systems »), les recherches sur les L’Homme 97-98, janvrjuin 1986, X X V I (1-2), pp. 81-90. 82 MARC AUGÉ problèmes de santé et T ethnomédecine sont ainsi présentées comme les quatre grandes parties de l'anthropologie médicale elle-même conçue comme une subdivision spécifique de l'anthropologie en général (Genest 1978 ; Colson & Salby 1974 ; Fabrega 1971). Au lieu de penser à bâtir une discipline ou une sous-discipline nouvelle il me paraît important de voir sur quels points l'étude anthropologique de la maladie peut affiner ou renouveler la problématique anthropologique. Elle le peut, à mon sens, pour deux raisons essentielles : il 11'y a pas de société où la maladie n’ait une dimension sociale et, de ce point de vue, la maladie, qui est aussi la plus intime et la plus individuelle des réalités, nous fournit un exemple concret de liaison intellectuelle entre perception individuelle et symbolique sociale ; quant à la perception de la maladie et de sa guérison elle ne peut se satisfaire ni d'un recours arbitraire à l’imagination ni d'une simple cohérence intellectuelle ou d’un effet de représentation : elle est ancrée dans la réalité du corps souffrant. Il y a donc lieu d’espérer que l’étude des systèmes d’interprétation de la maladie puisse éclairer le débat toujours réouvert depuis Lévy-Brulil sur la rationalité des croyances dites primitives et sur l’interprétation qui peut être donnée de celle-ci : « intellectualiste » et « littérale » ou « symboliste », ou encore radicalement « relativiste » (Skorupski 1976). Si l’anthropologie dite médicale n’a pas jusqu’à présent, à mon sens, aidé à la réalisation de ce programme c’est vraisemblablement à cause de sa relative faiblesse théorique, imputable à ce que j’appellerais volontiers l’illusion disciplinaire : si nouvelle discipline il y a (en l’occurrence « anthropologie médicale ») les vieux débats peuvent repartir à zéro et Lévy- Bruhl retrouver une nouvelle jeunesse. Grossièrement résumée, la situation est à peu près la suivante : d’un côté (et plus précisément en Angleterre) les théoriciens en philosophie des sciences sociales s’interrogent par exemple sur la manière de comprendre les « religious world-views » d’une culture donnée, ceux qui s’inspirent de Wittgenstein allant jusqu’à douter de la possibilité de toute traduction d’un « language game » ou d’une « form of life » dans l’autre. De l’autre côté (majoritairement aux États-Unis) les spécialistes de l’anthropologie médicale, plus ou moins inspirés par l’idéo- logie du « grand partage », la « we/they division » dont Jack Goody constatait encore en 1977 la prégnance, privilégient les schémas diffusion- nistes et les typologies tranchées. Ils évacuent du même coup tout problème proprement théorique. George M. Foster (1976) me paraît un exemple particulièrement net à cet égard. On peut dire que pour lui toute dimension sociale est étiologique et toute étiologie sociale magique ; c’est le sens de la distinction qu’il établit entre « personalistic medical Systems » (i.e. ceux où la maladie est attribuée à l’intervention délibérée d’un agent humain ou non humain) et les « naturalisée medical Systems » (ceux où la maladie serait attribuée à l’action de forces ou d’éléments naturels). Alors que les systèmes du second type caractériseraient la tradition nosologique de la Chine, de l’Inde, de la Anthropologie de la maladie 83 Grèce et de Rome, ceux du premier type seraient particulièrement attestés en Afrique. Murdock (1980) organisera pour sa part de façon plus minutieuse et documentée mais selon les mêmes principes sa présentation des théories de la maladie en distinguant cinq types de causalité « naturelle » et treize types de causalité « surnaturelle ». Aucun d’eux ne prête attention au fait que dans les systèmes africains, où la cause du mal est souvent en effet identifiée à l’action d’un agent extérieur, la maladie elle- même est présentée comme une rupture d’équilibre (entre instances psychiques, entre humeurs du corps ou qualités comme le chaud et le froid) exactement comme dans les systèmes jugés par eux « naturalisée ». Meilleur connaisseur des faits amérindiens, Foster (1953) ne s'était déjà pourtant intéressé, il est vrai, qu’à l’influence qu’aurait exercée sur eux la diffusion par l’Espagne du modèle indo-européen relayé par les Arabes. Michael H. Logan (1977) s’empresse de la même façon de recourir au schéma difïusionniste pour refuser aux civilisations indiennes l’originalité et la propriété de leur recours à la médecine des humeurs et à la théorie du chaud et du froid, malgré la démonstration faite par Redfield dès 1941 de l’antériorité du système d’opposition chaud/froid à la venue des conquérants espagnols. Toutes ces approximations ou simplifications me paraissent relever d’une conception dualiste ethnocentrée selon laquelle il y aurait dans les systèmes indigènes étudiés par l’ethnologie un secteur virtuellement empirico-rationnel et un secteur irréductiblement magique. Turner (1968) lui-même suggérait que les Ndembu utilisaient certains médicaments parce qu’ils étaient « objectivement efficaces » (ne pensaient-ils pas guérir lorsqu’ils utilisaient les autres ?) et tout un débat portant sur les propor- tions respectives du rationnel et de l'irrationnel dans les médecines primitives n’a cessé de renaître en anthropologie depuis l’article consacré à ce sujet par Ackerknecht en 1946. Ce débat introduit en fait (de façon parfois voilée) une discussion à plusieurs volets. On peut privilégier le point de vue de la vérité et considérer que certains systèmes sont inférieurs à d’autres en ce qu’ils ne maîtrisent traditionnellement qu’une part infime du savoir thérapeutique. On peut encore, dans une perspective combinant l’intellectualisme et un certain relativisme, estimer que le passage à la magie ou à la religion correspond à un élargissement du contexte causal, comme dans la science moderne la théorie fournit un contexte causal plus large que celui du sens commun (Horton 1967). On peut enfin douter que la coupure nature/surnature soit une donnée explicite des systèmes nosologiques étudiés par l’anthropologue et estimer que celui-ci la projette sur une réalité qu'il traduit mal et dont il ignore le caractère unitaire. La question se pose donc de savoir si l'on privilégie du même coup une conception résolument relativiste du sens. J’essaierai d’entrer dans cette discussion en évoquant complémentairement la question de l’homogénéité des systèmes de sens et de savoir, la question de la rationalité et celle de l’efficacité. 84 MARC AUGÉ Commençons par les rapports entre sens et savoir. Toutes les sociétés ont eu besoin de sens, et Claude Lévi-Strauss (1950) a rappelé justement dans son « Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss » que, dès que sont apparus conscience et langage, il a fallu que l’univers signifiât. Cette nécessité immédiate du sens est évidemment incompatible avec la consti- tution lente et progressive du savoir ; mais c’est la même raison humaine qui est à l’œuvre dans l’observation de la nature, l’élaboration des tech- niques, l’interprétation des aléas du corps individuel ou l’organisation des rapports sociaux. Il n’est donc pas contradictoire que des acquisitions « primitives » dont la rationalité et l’efficacité sont reconnues par les spécialistes de la culture scientifique occidentale (notamment dans uploads/Sante/ antropologia-da-doenca-em-frances-ocr.pdf
Documents similaires
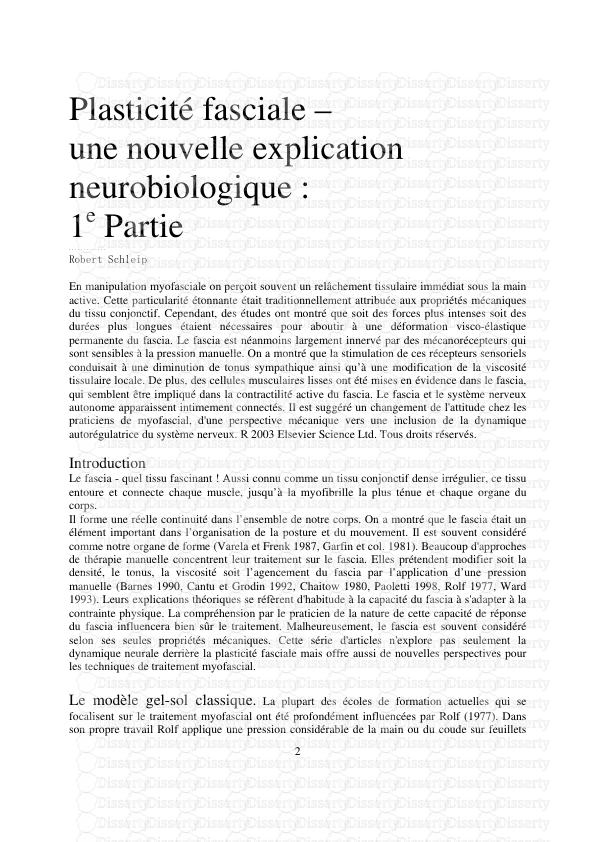









-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 31, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.2536MB


