METHODOLOGIE DE COLLECTES DES DONNEES Parcours Certificat d’Etudes Supérieures
METHODOLOGIE DE COLLECTES DES DONNEES Parcours Certificat d’Etudes Supérieures en Administration des Entreprises ( CESAE) Enseignant Equipe pédagogique Formation continue ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES Agrément définitif par Arrêté n°4677/MES/CAB du 05 Juillet 2017 Accréditée par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) BP : 2339 – Brazzaville – CONGO E-mail : esgae@esgae.org Site web : www.esgae.org 1 CESAE METHODES DE COLLECTE DES DONNEES Enseignant : Marcel MBALOULA 2 TITRE DE L’UE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE UE: UE 5 Elément constitutif (EC) : Méthodes de collecte des données CESAE Semestre : S1 CESAE Volume horaire présentiel : 15 H TPE estimé : Crédits : Coefficient : 1 Cours : 10 TD : 5 TP : Objectif général : Cet enseignement vise à faire acquérir à l’étudiant des méthodes de collecte des données Objectifs spécifiques : Au terme de cet enseignement, les étudiants seront en mesure : - de définir les sources des données ; - d’appréhender les méthodes de collecte des données. Pré Requis : Notions préliminaires sur les statistiques Methodes pédagogiques : Cours magistral, petite révision en classe, exercices à faire à domicile. Evaluation : Sommative : (Devoir de recherche et Examens) Formative en TD et du TPE (travail personnel de l’étudiant) Contenu pédagogique : Chapitre 1 Recueil des données Section 1 Sources des données Section 2 Sources des données de la note de recherche Chapitre 2 Entretiens 3 Section 1 Définitions et types d’entretiens Section 2 Guide d’entretien Chapitre 3 Enquêtes par sondage Section 1 Définitions de l’enquête par sondage Section 2 Echantillonnage Section 3 Questionnaire Chapitre 4 Recherche documentaire Section 1 Préparation d’une recherche documentaire Section 2 Sélection des sources d’informations Section 3 Exploitation des ouvrages et des revues scientifiques Section 4 Recherches à l’internet Bibliographie : Aktouf, O., (1990). Méthodologie des sciences sociales et approche qualitatives des organisations. Presses de l’Université du Québec, Québec. Evrard, Y., et al. (1976). Information et décision en marketing. Paris : Dalloz Evrard, Y., et al. (2003). MARKET. Etudes et Recherches en marketing. Paris : Dunod, 3e édition Thietard, R.-A. et coll., (1999). Méthodes de recherches en management. Dunod, Paris. Wachaux, Fr., (1990). Méthodes Qualitatives et Recherche en Gestion. Economica, Paris. 4 CHAPITRE 1 : RECUEIL DES DONNEES Section 1 : Sources des données ou d’informations 1. Types de données et types de sources de données Il existe deux types de données : les données primaires et les données secondaires. Les données secondaires sont des données qui ont été collectées préalablement à l’étude à réaliser. On distingue les données secondaires internes, issues de l’entreprise et les données secondaires externes, issues de l’environnement de l’entreprise. Les données primaires sont des données brutes qui sont collectées dans le cadre de l’étude. Les données secondaires sont issues des sources secondaires et les sources primaires sont issues des sources primaires. Tableau 1 : Types de sources d’informations A. Sources primaires B. Sources secondaires Enquêtes par sondage Entretiens (Interviews) Observation participante Panels Ouvrages Thèses de doctorat Mémoires et notes de recherche Revues scientifiques Articles scientifiques (dans les revues scientifiques) Rapport d’études (Banque mondiale, FMI, BAD, Commission Européenne, etc.) Rapports d’activités (au niveau des entreprises) Documents officiels (Lois, décrets, arrêtés, journal officiel) 5 2. Validité et fiabilité des sources des données La qualité de l’information dépend de celle de la source d’information dont elle est issue. La qualité de la source d’information correspond à deux critères la validité et la fiabilité. La validité et la fiabilité des sources primaires et des sources secondaires sont évaluées à partir des critères présentés dans le tableau ci-dessus : Tableau 2 : Les critères d’évaluation des sources des données A. Sources primaires B. Sources secondaires Adéquation entre la source utilisée et le thème et les objectifs de l’étude ; Adéquation entre la source et la nature de l’étude ; Choix entre données exhaustives et données partielles Evaluation de la pertinence de la date de publication du document ; Qualité des auteurs ayant produit le document : Nature du document (vulgarisation ou scientifique, etc.) Section 2 : Les sources d’information de la note de recherche 1. Structure de la note de recherche En général, la note de recherche est le résultat d’une activité de recherche portant sur un thème pratique lié au fonctionnement et/ou à l’organisation d’une administration ou d’une entreprise. Elle comprend essentiellement les parties suivantes : introduction, chapitre 1 (partie théorique : cadre conceptuel et cadre institutionnel), chapitre 2 (partie empirique : analyse et interprétation des données collectées), conclusion, bibliographie, 6 2. Les sources d’informations les plus exploitées Les sources de données généralement exploités dans le cadre de la production d’une note de recherche sont Les sources primaires : Les enquêtes par sondage réalisées auprès d’un échantillon représentatif ; Les entretiens (les interviews) auprès de certains individus ; L’observation participante. Les sources secondaires : Les ouvrages, Les articles, Les mémoires et les notes de recherche, Les rapports d’activités, Annuaires statistiques de l’Institut National de la Statistique (INS), Les rapports d’étude (rapports de la Banque mondiale, de la Banque Africaine de Développement, etc ;), Les documents officiels : les décrets, les arrêtés, les plans de développement du Congo (PND 1 et 2), le journal officiel 7 CHAPITRE 2. ENTRETIENS Section 1 Définition et types d’entretiens 1. Définition L’entretien est une technique destinée à collecter des données discursives reflétant notamment l’univers mental conscient et inconscient des individus. Il constitue une source des données primaires pour des études qualitatives. Il est souvent utilisé dans le cadre de la recherche qualitative dont l’objectif est de comprendre les logiques mentales, les comportements ou les attitudes des individus par rapport à un thème faisant l’objet d’étude. 2. Types d’entretiens On distingue deux types d’entretiens : l’entretien individuel et l’entretien de groupe. 2.1. L’entretien individuel On distingue traditionnellement deux types d’entretien individuel : l’entretien non directif et l’entretien semi-directif. L’entretien non directif consiste à laisser s’exprimer librement la personne interrogée. Au cours de l’entretien, l’investigateur ou le chercheur, après avoir énoncé le thème, il écoute et enregistre les notes sans intervenir sur l’orientation du propos du sujet. Ses interventions se limitent à une facilitation du discours de l’autre, à la manifestation d’une attitude de compréhension, à une relance fondée sur des éléments déjà exprimés ou à un approfondissement des éléments discussifs déjà énoncés. L’entretien non directif est intéressant pour une étude exploratoire, une étude dont le thème n’a jamais fait l’objet d’un examen quelconque. L’entretien semi-directif, encore appelé « entretien centré », le chercheur applique les mêmes principes que pour l’entretien non directif. Cependant l’entretien semi-directif repose sur un guide d’entretien, document structuré contenant des sous-thèmes préalablement définis. 8 L’interrogé aura à répondre le plus directement possible à des questions précises contenues dans le guide. Il ne doit pas dévier du cadre de chaque question, ni associer librement d’autres éléments selon son inspiration. Toutefois, le guide peut être complété par le chercheur en cours d’entretien à l’aide d’autres questions. La réussite d’un entretien dépend de la conduite de l’interview dont la qualité dépend fondamentalement des éléments suivants : La préparation de l’entretien : Le chercheur doit avoir au préalable soigneusement délimité le thème de l’entrevue avec les principales questions déjà formulées et rédigées. Le lieu, la durée et les conditions de déroulement doivent aussi faire l’objet de préparation. L’introduction de l’entretien : Il est important d’expliquer à l’interviewer l’objet de l’entretien, les objectifs du chercheur, l’usage que sera fait des informations collectées. Cette introduction est importante pour lever les angoisses et la méfiance de celui qui qui va subir un interrogatoire. L’écoute active et la reformulation : Il faut montrer à l’interviewé qu’on le suit et qu’on le comprend. Ainsi, de temps à autre, pour s’assurer (et assurer l’autre) qu’on a bien compris, on reformulera de façon synthétique ce qui vient d’être dit. L’évitement de formuler à la place de l’interviewé : D’abord, il faut éviter d’interrompre le répondant ou de lui faire sentir que ce qu’il dit est sans intérêt. Ensuite, il faut éviter de créer des silences trop longs ou des coupures à cause de la prise des notes (voilà pourquoi il est recommandé d’écrire très vite et en abrégé). 2.2. L’entretien de groupe Définition L’entretien de groupe ou focus-group consiste à réunir des personnes, ne se connaissant pas, ayant des centres d’intérêt communs afin qu’elles puissent s’exprimer sur un sujet donné. Sa particularité est de placer les interviewés en situation d’interaction. 9 Organisation de l’entretien L’efficacité de l’entretien de groupe exige que le chercheur gère des éléments de la dynamique du groupe développée par Kurt LEWIN : Veiller à ce que tous les participants ne s’éloignent pas du thème abordé ; Empêcher un individu ou une petite coalition de dominer le groupe ; Veiller à ce que les participants interviennent uploads/Science et Technologie/ methodologie-de-collectes-de-donnee.pdf
Documents similaires


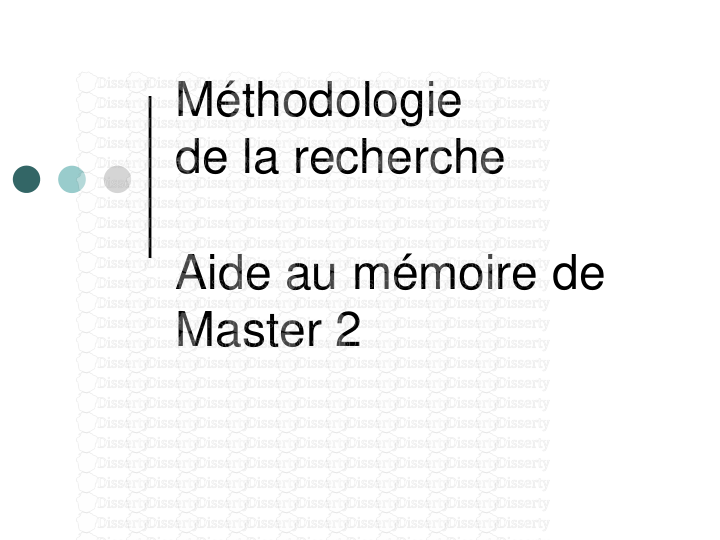







-
69
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 23, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8850MB


