La place de la logique et ses subdivisions dans l’Énumération des sciences d’al
La place de la logique et ses subdivisions dans l’Énumération des sciences d’al-Fârâbî et chez Dominicus Gundissalinus Jean-Marc Mandosio 1. Les textes L’Énumération des sciences — Kitâb ih . s .â’ al-‘ulûm — de Muh . ammad abu-Nas .r al-Fârâbî (né vers 873, mort en 950) est un ouvrage consacré à ce qu’on appelait au Moyen Âge les divisions de la philosophie. C’est l’un des écrits les plus célèbres de cet auteur, considéré dans le monde musulman comme « le second maître » en philosophie après Aristote1. Le but de l’opuscule, comme l’indique al-Fârâbî lui-même dans le prologue, est « d’énumérer les sciences connues, une à une, et de faire connaître l’ensemble du contenu de chacune d’elles, les différentes parties de toute science qui possède des parties et l’ensemble du contenu de chacune de ces parties » ; ce catalogue s’adresse tout d’abord à l’étudiant « qui voudrait apprendre une de ces sciences », pour qu’il puisse se déterminer « en connaissance de cause et non pas à l’aveuglette et au hasard », mais il se veut aussi utile à quiconque « cherche à se cultiver », en le rendant capable de « comparer les sciences entre elles », de « démasquer celui qui prétendrait bien connaître l’une de ces sciences sans qu’il en soit ainsi », de tester « la compétence de quelqu’un qui possède une science », voire d’« imiter les savants pour faire croire qu’il est l’un des leurs »2. Il s’agit donc à la fois d’un 1. Voir R. W alzer, « Fârâbî », dans Encyclopédie de l’Islam, t. 2, Leyde/Paris, 1965, p. 797-800 ; M. E. Marmura, « Fârâbî », dans Dictionary of the Middle Ages, t. 5, New York, 1985, p. 9-11 ; D. L. Black, « Alfarabi », dans A Companion to Philosophy in the Middle Ages, Oxford, 2003, p. 109-117. 2. Al-Fârâbî, ‘Ih . s .â’ el ‘ulûm / Énumération des sciences ou Classifications des sciences, éd. U. Amîn [Le Caire, 1968], trad. I. Mansour, Beyrouth, 1991, p. 43-45. La traduction française est assez fidèle, mais le commentaire qui l’accompagne est indigent. 286 JEAN-MARC MANDOSIO manuel d’initiation à l’étude des sciences et d’un aide-mémoire susceptible de servir en toutes circonstances. Il n’est pas étonnant que ce panorama du savoir, présenté sous une forme aisément accessible, ait suscité l’intérêt des traducteurs latins, soucieux de fournir à leurs lecteurs des instruments permettant de se repérer dans le vaste domaine des sciences gréco-arabes et d’établir un lien entre les connaissances nouvelles et les disciplines préexistantes dans la culture latine de l’Europe médiévale. De fait, l’Énumération des sciences a été traduite deux fois au xiie siècle : intégralement par Gérard de Crémone3, et de façon abrégée par Dominicus Gundissalinus4. Les deux versions sont couramment désignées sous le même titre, De scientiis, ce qui ne facilite pas les choses ; en toute rigueur, ce titre devrait être réservé à la traduction de Gérard de Crémone (Liber Alfarabii de scientiis), tandis que le titre indiqué dans l’explicit de la version de Gundissalinus est différent : Liber Alpharabii de divisione omnium scientiarum5. Les nombreuses ressemblances entre les deux versions ont conduit les spécialistes à penser qu’elles ne sont pas indépendantes l’une de l’autre. Les deux traducteurs étaient exactement contemporains : Gundissalinus est né vers 1110 et mort en 1190 ; Gérard de Crémone est né vers 1114 et mort en 1187. Certains estiment que la traduction de Gérard de Crémone, plus complète et plus fidèle au texte arabe, a précédé celle de Gundissalinus6 ; d’autres conjecturent que Gundissalinus a d’abord réalisé une version abrégée, qui fut ensuite corrigée et complétée par Gérard7. Mais cela n’a guère d’importance pour la question qui nous occupe ici. La version de Gundissalinus a exercé une plus grande influence à long terme que celle de Gérard de Crémone, notamment grâce à Vincent de Beauvais. Ce dernier, en effet, l’a presque intégralement citée au milieu du xiiie siècle 3. Al-Fârâbî, Über die Wissenschaften / De scientiis : nach der lateinischen Übersetzung Gerhards von Cremona, éd. et trad. F. Schupp, Hambourg, 2005. À signaler également : Al-Fârâbî, Catálogo de las ciencias, éd. et trad. A. González Palencia, Madrid, 1932 (contient, outre le texte arabe et sa traduction espagnole, deux versions latines, par Gérard de Crémone et par W. Chalmers [G. Camerarius], tirée de son édition des Alpharabii... opera omnia, Paris, 1638). 4. Al-Fârâbî, De scientiis, secundum versionem Dominici Gundisalvi / Über die Wissenschaften : die Version des Dominicus Gundissalinus, éd. et trad. J. H. J. Schneider [sur la base de : Domingo Gundisalvo, De scientiis, éd. M. Alonso Alonso, Madrid, 1954], Fribourg-en-Brisgau, 2006. 5. J’appliquerai cette distinction dans la suite du présent article : De scientiis = trad. Gérard de Crémone, éd. F. Schupp ; De divisione omnium scientiarum = trad. Dominicus Gundissalinus, éd. J. H. J. Schneider. Pour renvoyer aux propos des éditeurs eux-mêmes, j’indiquerai leur nom suivi de la mention op. cit. 6. F. Schupp, op. cit., p. lxiii-lxv. 7. J. H. J. Schneider, op. cit., p. 40, 116-117. AL-FÂRÂBÎ ET DOMINICUS GUNDISSALINUS 287 dans sa grande encyclopédie, le Speculum majus8, qui sera lue et imprimée jusqu’au xviie siècle. Pour ce qui est de la transmission directe, la version de Gérard ne nous est parvenue que dans trois manuscrits, tandis que celle de Gundissalinus est conservée dans huit manuscrits9. Il ne faut pas en conclure que la traduction de Gérard n’a eu aucun impact, puisqu’elle a été utilisée par Albert le Grand10 et par Roger Bacon11. Il n’est pas indifférent de savoir laquelle des deux versions a été utilisée par tel ou tel auteur latin car, si la traduction de Gérard de Crémone se veut fidèle au texte original, celle de Gundissalinus donne de la classification des sciences d’al-Fârâbî une vision déformée. Gundissalinus ne s’est pas contenté de condenser l’Énumération des sciences : il l’a adaptée, à tel point qu’on a pu se demander si son travail peut encore être considéré comme une traduction12 ; certains préfèrent le traiter comme un ouvrage autonome de Gundissalinus13. Cette distinction entre la pensée authentique d’al-Fârâbî et l’image qu’en donne Gundissalinus est importante pour un lecteur moderne, même si les lecteurs médiévaux pensaient avoir affaire dans tous les cas à un vrai texte d’al-Fârâbî. Un autre facteur est venu compliquer la transmission de la classification des sciences du philosophe arabe : après sa traduction-adaptation de l’Énumération des sciences intitulée, comme on l’a vu plus haut, De divisione omnium scientiarum, Gundissalinus a composé, cette fois sous son nom, un ouvrage sur le même sujet, portant le titre De divisione philosophiæ14. Il ne s’agit pas d’une simple paraphrase de l’opuscule d’al-Fârâbî, même si Gundissalinus s’en est ouvertement inspiré et en a recopié des sections entières, mais d’une synthèse éclectique, comme l’indique le titre complet : Liber de divisione philosophiæ in partes suas et partium in partes suas 8. Les citations sont éparpillées tout au long du Speculum doctrinale. Elles sont réunies par M. Alonso Alonso (d’après l’éd. de Venise, 1581) en appendice à sa propre édition de la version de Gundissalinus (op. cit., p. 143-167). 9. Listes des manuscrits : F. Schupp, op. cit., p. lxxiii-lxxix ; J. H. J. Schneider, op. cit., p. 114-115 (d’après le recensement établi par M. Alonso Alonso). 10. Voir dans le présent volume J. Janssens, « L’al-Fârâbî perdu chez Albert le Grand », § 1.2 (en particulier note 25). 11. Voir I. Rosier-Catach, « Roger Bacon, al-Fârâbî et Augustin : rhétorique, logique et philosophie morale », dans La Rhétorique d’Aristote : traditions et commentaires de l’Antiquité au XVIIe siècle, Paris, 1998, p. 87-100 (en particulier p. 90). 12. Voir par exemple J. H. J. Schneider, op. cit., p. 40, 116-117. 13. Il a été publié comme tel par M. Alonso Alonso (voir ci-dessus, n. 4) sous le titre : Domingo Gundisalvo, De scientiis : compilación a base principalmente de la ‹ Maqâlat . fî ih . s .â’ al-‘ulûm › de al-Fârâbî. 14. Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiæ / Über die Einleitung der Philosophie, éd. et trad. A. Fidora et D. Werner [sur la base de : Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiæ, éd. L. Baur, Münster, 1903], Fribourg-en-Brisgau, 2007. 288 JEAN-MARC MANDOSIO secundum philosophos (« Livre de la division de la philosophie en parties et en sous-parties, selon les philosophes »). L’auteur a en effet puisé à de nombreuses sources, tant dans la tradition latine — de Boèce et Isidore de Séville à Thierry de Chartres — que dans la tradition arabe. Il a notamment inclus dans l’ouvrage tout le chapitre 8 du livre V (correspondant aux Seconds Analytiques d’Aristote) de la partie logique de l’encyclopédie philosophique d’Ibn Sînâ (Avicenne), le Kitâb al-Šifâ’. Ce chapitre, traduit par ses soins15, porte « sur l’accord et la différence entre les sujets [des sciences] » (Summa Avicennæ de convenientia et differentia subjectorum)16. Un court traité sur un thème apparenté a également circulé au Moyen Âge sous le nom d’al-Fârâbî : le De ortu scientiarum. Cet opuscule visant à expliquer « l’origine des sciences » ne nous est uploads/Science et Technologie/ jean-marc-mandosio-pdf.pdf
Documents similaires








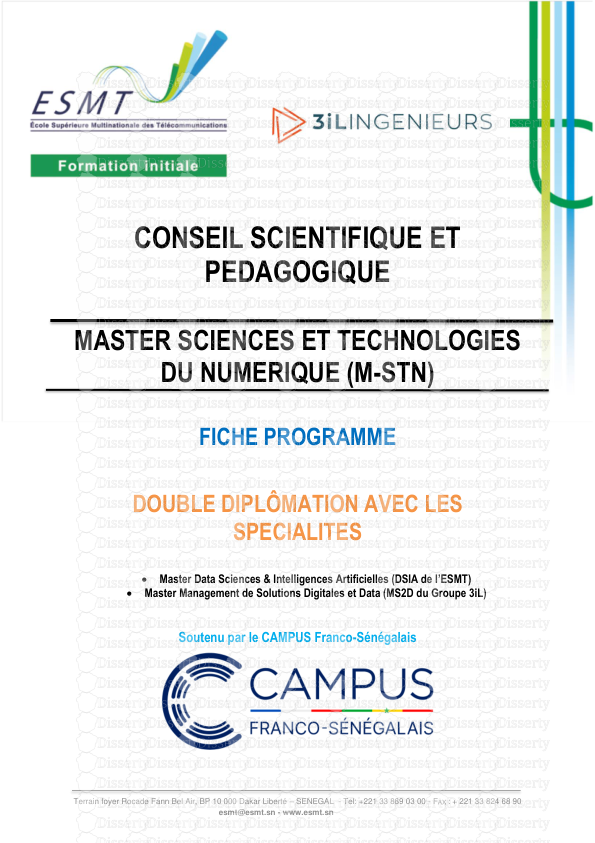

-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 10, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5680MB


