Biologie et médecine en France et en Russie / Biology and medicine in France an
Biologie et médecine en France et en Russie / Biology and medicine in France and Russia www.editions-hermann.fr Illustration de couverture : ISBN : 978 2 7056 9227 8 © 2016, Hermann Éditeurs, 6 rue Labrouste, 75015 Paris Toute reproduction ou représentation de cet ouvrage, intégrale ou partielle , serait illicite sans l’autorisation de l’éditeur et constituerait une contrefaçon. Les cas strictement limités à l’usage privé ou de citation sont régis par la loi du 11 mars 1957. Collection Histoires des sciences dirigée par Philippe Fauvernier Ouvrage publié avec le concours de l’Université de Picardie – Jules Verne / Book published with the assistance of the University of Picardie – Jules Verne Depuis 1876 Biologie et médecine en France et en Russie / Biology and medicine in France and Russia Histoires croisées (fin xviiie-xxe siècle) / Crossed histories (end of 18th-20th century) Sous la direction de / Edited by Jean-Claude Dupont, Jean-Gaël Barbara, Eduard Kolchinsky, Marina Loskutova Introduction Si la science est une aventure internationale, elle est aussi géogra phiquement située, travaillée en des lieux déterminés. Le corpus qu’elle constitue, universel par destination, s’élabore au commencement dans des contextes spécifiques. Comprendre ces paradoxes du déve lop pement des pensées et des pratiques scientifiques suppose d’entrer dans la structure fine des spécificités géographiques et d’augmenter le grain des analyses dans cette direction. Ce volume, consacré à deux pays situés aux extrémités du continent européen, la France et la Russie, se veut une contribution au « tournant géographique » (geographical turn) des études sur la science 1. Depuis le xviiie siècle, les guerres, les diplomaties, les voyages scientifiques et les voyages d’études relièrent ces deux aires éloignées. Ces relations prirent alors différentes formes. Elles résultèrent d’abord de contacts individuels, issus d’une communauté d’intérêts scientifiques. Les déplacements des individus à l’intérieur de l’espace européen, malgré les vicissitudes historiques, créèrent des réseaux scientifiques et des relations d’amitié. Dans le domaine des sciences de la vie, les rela tions franco-russes furent peu formalisées, et à quelques exceptions notables près, les initiatives personnelles furent la règle. Des deux côtés, certains acteurs de la vie intellectuelle firent montre d’un véri table engagement personnel pour favoriser ces échanges ; francophilie et russophilie n’étaient pas de vains mots. Parfois même se nouèrent des relations familiales. Certains programmes de recherche communs entre les institutions scientifiques des deux pays pouvaient résulter de ces initiatives individuelles. Enfin, certaines relations scientifiques pouvaient être consécutives à une volonté politique et diplomatique à un plus haut niveau. Sous ces formes variées, un moment ralenti par la Révolution de 1917 et surtout la période stalinienne, ces relations n’ont jamais réel lement cessé. Contrairement à une idée reçue, même pendant la Guerre 1. D. A. Finnegan, « The spatial turn : geographical approaches in the history of science », Journal of the History of Biology, 2008, p. 369-388. Ce « tournant spatial » ou « tournant géographique » est présent dans les sciences humaines françaises dès les années 1990, avec Gilles Deleuze, ou Marcel Gauchet qui utilisa le premier l’expression française de « tournant géographique ». Voir M. Gauchet, « Introduction au dossier “Nouvelles géographies” », Le Débat, 92, 1996, p. 42. 6 Biologie et médecine en France et en Russie froide, les échanges furent presque ininterrompus. En témoigne par exemple la vitalité des traductions des œuvres scientifiques en français et en russe au xixe siècle et durant l’époque soviétique. Naturellement, les sciences de la nature, comme les sciences humaines, constituent un univers mental, et les enjeux épistémologiques de la traduction coexistent avec ses enjeux idéologiques et politiques, tout comme aujourd’hui ceux de l’usage d’un anglais rudimentaire, par là univer sellement compréhensible. La mise en parallèle des cas français et russes ne doit pas conduire à isoler arbitrairement une relation binaire d’un faisceau de relations constitutives beaucoup plus complexe. Marchands, diplomates, mili taires, intellectuels de diverses nationalités européennes sont présents en Russie avant Pierre le Grand. Au xixe siècle, au moment où les échanges scientifiques s’accroissent, les étudiants et les voyageurs des deux pays devaient passer par l’Allemagne. Il est clair que la construction de la science de cette région de l’Europe résulte d’au moins trois aires cultu relles imbriquées, celles de la France, de l’Allemagne et de la Russie, sans compter les implications des autres sciences nationales. Il serait d’ailleurs faux de réduire la situation de la science russe de l’époque à un dialogue singulier avec la science allemande, sous prétexte de proximité géographique. Jouant de la rivalité franco-allemande, les Russes voient parfois dans la science française un modèle intellectuel alternatif. Cette nécessité de pousser l’analyse au-delà de relations bilatérales se justifie encore au xxe siècle : la situation de la science soviétique et celle des « pays de l’Est » ne peut se résumer à une situation de confrontation réciproque avec la science des « pays occidentaux », bloc contre bloc. Contre la mythologie des isolements nationaux et l’image forte du « rideau de fer », il est désormais nécessaire de mettre en avant des schèmes dynamiques d’hybridations, les résistances causées par les échanges, les réceptions et influences mutuelles, les phénomènes de rejets et d’appropriation et la création d’idées neuves dans un isolement relatif permettant de nouvelles hybridations ultérieures. Les relations peuvent d’ailleurs être aussi considérées dans leurs échecs à un moment donné, ce qui peut leur conférer également un sens. Chacune des contributions russes et françaises du présent ouvrage constitue une étude de cas dont l’ensemble rend compte de cette situa tion diversifiée. Il ne s’agit pas, en ce qui concerne le cas franco-russe, d’user d’une démarche comparatiste, à la recherche de similitudes et de différences qui figeraient chaque aire culturelle dans son identité, mais plutôt de rendre compte de croisements, d’imbrications constitutives Introduction 7 complexes. Les cultures scientifiques ont certes une spécificité nationale, mais les idées circulent et la notion forte de transfert culturel, spécia lement développée dans le domaine franco-germanique des sciences humaines, garde ici toute sa pertinence. Il ne s’agit pas non plus de revendiquer l’idée d’une essence européenne de la science moderne au travers de ses origines, discutable à l’époque de son intégration au niveau mondial. Il s’agit de souligner, à travers le cas franco-russe, la diversité, l’importance et les caractéristiques multilatérales d’interac tions à l’intérieur d’un espace géographique et historique commun, celui de l’Europe des sciences. Les interactions franco-russes, particulièrement importantes et polymorphes, restent peu étudiées dans le domaine des sciences du vivant. Deux sections ont été proposées, respectant leurs deux sensi bilités traditionnelles, entre histoire naturelle et médecine, et suivant pour chacune d’entre elles une progression chronologique. Beaucoup de ces histoires croisées mettent en avant les acteurs français ou russes. Ainsi la contribution de Stéphane Schmitt se concentre sur l’œuvre de Ludwig Heinrich Bojanus, et celle de Jean-Claude Dupont, sur Caspar Friedrich Wolff et Louis Tredern. Toutes deux rappellent l’importance de l’espace baltique au tournant des xviiie et xixe siècles, en tant que lieu d’échange pour l’anatomie comparée et l’embryologie. Eduard Kolchinsky traite de l’impact des idées de Georges Cuvier et de Jean-Baptiste Lamarck sur le développement de la théorie de l’évolution en Russie. Alors que les travaux de Cuvier constitueront le fondement de la paléontologie russe, ceux de Lamarck ne seront connus que tardivement en Russie, après la publication des œuvres de Darwin. Les formes particulières des théories transformistes en Russie sont analysées dans la perspective de cet héritage, jusqu’à l’époque de Lyssenko. Igor Popov, quant à lui, décrit l’élaboration de la recherche paléontologique de Vladimir Kovalevsky dans les années 1870 et le développement de ses concepts par Louis Dollo. L’affinité téléologique de cette paléontologie néodarwinienne est discutée. Dans le domaine de la botanique, de la physiologie végétale à l’écologie, Anatoli Polevoi traite de la coopération scientifique de Vladimir Lyubimenko et des chercheurs français tel Gaston Bonnier. Oleg Belozerov rappelle un fondateur oublié de la biologie du développement soviétique, Mikhail Zavadovskii, et compare la perspective de son œuvre avec certaines orientations en ce domaine issues de l’Europe occidentale. Certaines contributions traitent de certains lieux privilégiés de rencontre, telle celle de Tatyana Ulyankina, qui concerne la station zoologique 8 Biologie et médecine en France et en Russie A. Korotneff à Villefranche-sur-Mer et les curieuses vicissitudes de cette institution russe sur le sol français. Mikhael Konashev décrit les convergences et divergences sur l’évolution humaine entre Theodosius Dobzhansky et Pierre Teilhard de Chardin, suite à la publication par ce dernier du Phénomène humain. Étienne Aucouturier et Daria Popova évaluent l’origine et la portée de la pensée de Vladimir Vernadski. Ils situent sa biogéochimie dans la tradition du cosmisme russe et la discutent comme source possible d’inspiration pour l’ethnologue Jean Malaurie, fondateur de l’Académie polaire de Saint-Pétersbourg. Stéphane Tirard analyse la réception des travaux sur l’origine de la vie d’Alexandre Oparine, en suivant le cas de l’édition française de son ouvrage L’origine de la vie sur terre édité en 1964 par le biologiste français Pierre Gavaudan, et les réactions consécutives de biologistes français tels que Jacques Monod. Inaugurant la partie « Physiologie et médecine » de l’ouvrage, Vladimir Samoilov rappelle les uploads/Science et Technologie/ biologie-et-medicine-en-france-et-en-rus.pdf
Documents similaires



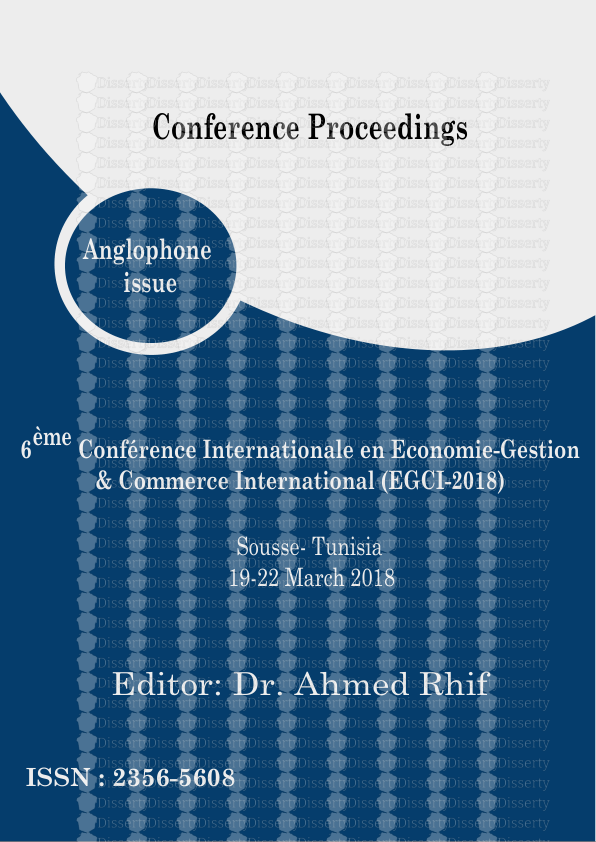
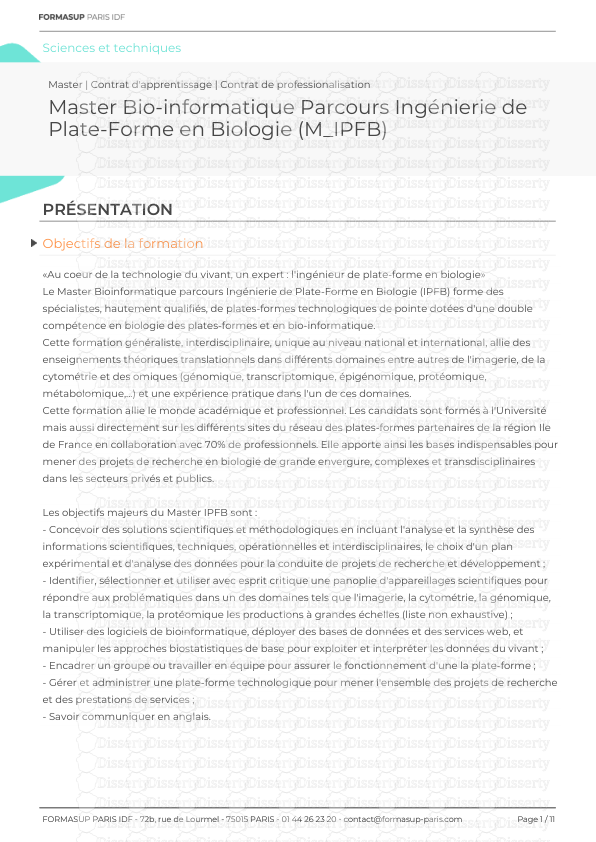
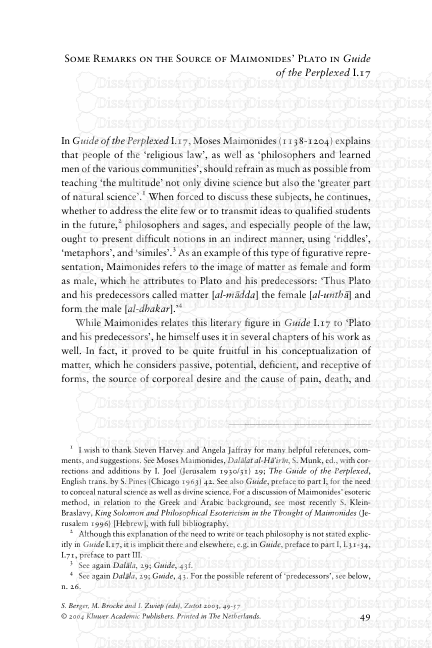




-
68
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 04, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.2418MB


