L‘ingénierie de l’unité nationale. Quelques singularités de la constitution bur
L‘ingénierie de l’unité nationale. Quelques singularités de la constitution burundaise de 1992 D EPUIS 1965, l’histoire du Burundi a été marquée par des affrontements violents entre les deux principales ethnies, les Tutsi minoritaires et les Hutu majoritai- res. Après les événements sanglants d’août 1988, le président Buyoya, comprenant que ce cycle infernal devait être brisé, a entamé une nou- velle politique visant à associer les Hutu au pouvoir, dont ils avaient été exclus jusque là. Promouvant une idéologie - on serait tenté de dire une religion - de l’unité natio- nale, diverses étapes ont abouti à l’adoption, par référendum du 9 mars 1992, de la constitution de la troisième République : formation d’un gouvernement paritaire, avec un premier ministre hutu, en octo- bre 1988 ; publication d’une Charte de l’unité nationale en avril 1990, adoptée par référendum en février 199 1 ; travaux d’une commission constitutionnelle qui a déposé son rapport en août 1991. Toute cette activité institutionnelle a été accom- pagnée par l’entrée très nette - même si elle est parfois symbolique - de Hutu dans toutes les sphères de la vie publique (1). Pour les Tutsi, cette couverture n’est pas dénuée de risques, parce qu’elle ouvre la perspective qu’une majorité démographique devienne une majorité politique. Lors des précédents retours à un ordre cons- titutionnel (en 1974 et 1981), cet épouvantail avait été évité grâce au contrôle exerce par le parti unique UPRONA, qui était en réalité, avec l’armée, l’instrument du maintien de la suprématie tutsi. Or, l’heure n’étant plus au monopartisme, la transition actuelle doit s’effectuer dans un contexte très différent. I1 a donc fallu trouver d’autres méca- nismes pour contrôler l’événement. Ce souci est très présent dans la constitution de 1992. Contrairement aux autres (( nouvelles 1 ) constitu- tions adoptées dans les pays d’Afri- que francophone depuis 1990, celle du Burundi n’est pas une copie à peine démarquée du modèle de la cinquième République française. En effet, on y trouve deux types de dis- positions : à part des dispositions (( classiques D , comparables à celles qu’on trouve ailleurs en Afrique francophone, on observe un nombre de règles novatrices, parfois même très novatrices. Chaque fois qu’il est, implicitement ou explicitement, question des relations ethniques dans leur expression politique et que le spectre de la majorité démo- graphique devenant majorité politi- que se profile, on note une remar- quable ingénierie de l’unité natio- nale. Cet article tâchera de décoder ce second type de dispositions, en proposant une lecture qui permet de comprendre les - intentions du constituant et d‘évaluer dans quelle mesure les mécanismes proposés ont une chance de fonctionner. 141 ‘BUR UNDI L’unité nationale A notre connaissance, aucune constitution au monde n’insiste tel- lement sur l’objectif de l’unité natio- nale, affirmée comme idéal primor- dial dès le préambule. Cette foi est réitérée dans pas moins de douze arti- cles de la constitution. En outre, l’adhésion à la Charte de l’unité nationale est exigée dans cinq articles (2). L’objectif, jusque-là assez théori- que, de l’unité nationale est ensuite opérationalisé par l’obligation, à maints endroits, de tenir compte des cc diverses composantes de la population burundaise D . C’est ainsi que les par- tis politiques doivent répondre, i ( dans leur organisation et dans la com- position des instances dirigeantes, aux principes démocratiques et à l’idéal de l’unité nationale, en tenant compte des diverses composantes de la population burundaise 1 ) (art. 55). N Chaque can- didature aux élections présidentielles doit être présentée par un groupe de deux cents personnes formé dans un esprit d‘unité nationale en tenant compte, etc ) ) (art. 65). Le gouverne- ment (( doit être composé dans un esprit d’unité nationale en tenant compte, etc ) ) (art. 84). Les listes de candidats a u élections législatives doivent être composées U dans un esprit d’unité nationale, en tenant compte, etc (art.101). Enfin, les membres du Conseil de l’unité nationale sont choi- sis ( ( dans les diverses composantes de la nation burundaise Q (art. 158). La phrase clé ( i les diverses composantes de la population (ou : de la nation) burun- (1) Sauf l’armée et les services de sécu- rité, où le processus se déroule péniblement. (2) On reviendra plus loin sur le statut de cette Charte. (3) République du Burundi, Commission constitutionnelle, Rapport sur Ia démocratisa- tion des institutions et de Ia vie politique au Burundi, Bujumbura, août 1991, p. 56 (ci- daise )) : cela signifie quoi ? A la lumière de l’histoire contemporaine du pays, il va de soi que le consti- tuant a songé aux ethnies, et dans une moindre mesure aux régions. Le rap- port de la commission constitution- nelle l’explicite par rapport aux par- tis politiques : (( il s’agit d’inviter les partis à regrouper des gens des dqféren- tes ethnies et de dqférentes régions ) ) (3). Cette exigence soulève deux pro- blèmes dans son application, surtout quant à son aspect ethnique. Le pre- mier a trait à l’étendue de cette règle : à partir de quel point tient-on suffi- samment compte des (( diverses com- posantes )) ? Même si la Commission constitutionnelle affirme qu’il (i ne s’agit pas d’institutionnaliser les quota ethniques, régionaux ou autres (4), la question est réelle : pour répondre à cette exigence, faut-il 10 YO ou 20 Y o de Tutsi, ou une composition pari- taire HutulTutsi (5) ? Si l’on regarde la pratique depuis l’ouverture politi- que en 1988, on constate qu’elle adhère au principe de la parité, dont on doute cependant qu’elle soit acceptable pour les Hutu au-delà de la période actuelle de transition. Quoi qu’il en soit, on voit mal comment éviter un système de quota implici- tes ou explicites ; cependant, pareil système est contraire à tous les crédo du régime. On risque donc l’impasse. Cette constatation mène au second problème. Par le_ biais de déclarations du chef de 1’Etat et du Premier ministre et des prises de position de la Commission nationale chargée d’étudier la question de après cité comme : Rapport Cotnmission constitionnelle). (4) Ibid. (5) Pour des raisons de convenance, on ( ( oublie )) généralement la troisième ethnie, le groupe pygmoïde des Twa, qui reprben- tent environ 1 % de la population. 142 l’unité nationale et de la Commission constitutionnelle, le régime a toujours rejeté l’identification ethnique. Le rapport de la Commission nationale l’exprime nettement : ( ( le Burundi avec son homogénéité multidimensiori- nelle ne constitue en fait qu’une eth- nie )> (6). C’est la ligne qu’avait déjà réaffirmée le président Buyoya lorsqu’il installait cette commission, (( par hasard )) composée paritaire- ment. Selon lui, cette composition < ( ne doit pas être comprise en terines de représentation (...) : ses membres ne représentent donc aucune ethnie (...) )) (7). Contrairement au Rwanda, où l’appartenance ethnique est offi- cialisée et mentionnée sur les cartes d’identité et dans les registres de la population, formellement l’ethnie n’est donc pas reconnue au Burundi (8). Comment dans ces con- ditions décider par exemple si, dans la composition de ses instances diri- geantes, un parti politique tient compte des (( diverses composantes de la population burundaise )) ? A la limite, un parti dirigé exclusivement par des Hutu pourrait prétendre que la moitié des membres de son comité exécutif sont des Tutsi, sans que le ministre de l’intérieur, compétent pour agréer les partis politiques, puisse se baser formellement .sur cette constatation pour refuser sa recon- naissance, puisqu’officiellement on (6) République du Burundi, Rapport de Ia Commission nationale chargée d’émdier Ia question de l’unité nationale, Bujumbura, avril 1989, p. 125. (7) République du Burundi, Parti UPRONA, Discours de lancement des travaux de la Commission nationale chargée d’étudier Ia question de l’unité nationale, Bujumbura, 6 octobre 1988, p. 12. (8) I1 faut dire que dans la pratique l’absence d‘enregistrement formel de l’ethnie ne fait aucune diErence. Au Burundi, comme au Rwanda, l’ethnie fait partie de l’identité de quelqu’un. Chaque Burundais sait à quelle ethnie il appartient, et personne ne s’engage dans des rapports plus que pas- ne (re)connaît pas les ethnies. Les ris- ques de blocage sont donc réels, d’autant plus que depuis octobre 1988 le principe de la parité HutulTutsi a été adopté pour la com- position de tous les organes à carac- tère politique. I1 va de soi que cette technique n’est pas sans poser des problèmes considérables dans un pays où le poids démographique des deux ethnies principales est fort différent. Élections législatives L’ingéniérie de l’unité est pous- sée très loin dans les dispositions concernant les élections législatives. En effet, la combinaison de deux techniques doit résulter dans un parlement à composition prévisible. On a déjà vu que l’art. 101 de la constitution. stipule que les listes de candidats proposés au scrutin doivent être composées ( ( dans U H esprit d’unité nationale en tenant compte des diverses composantes de la population burundaise B . Dans ce contexte, les (( diverses composantes ne sauraient être qu’ethniques, puisque la circonscription électorale étant la province, le problème de l’équilibre régional ne peut se poser à uploads/Politique/ burundi.pdf
Documents similaires








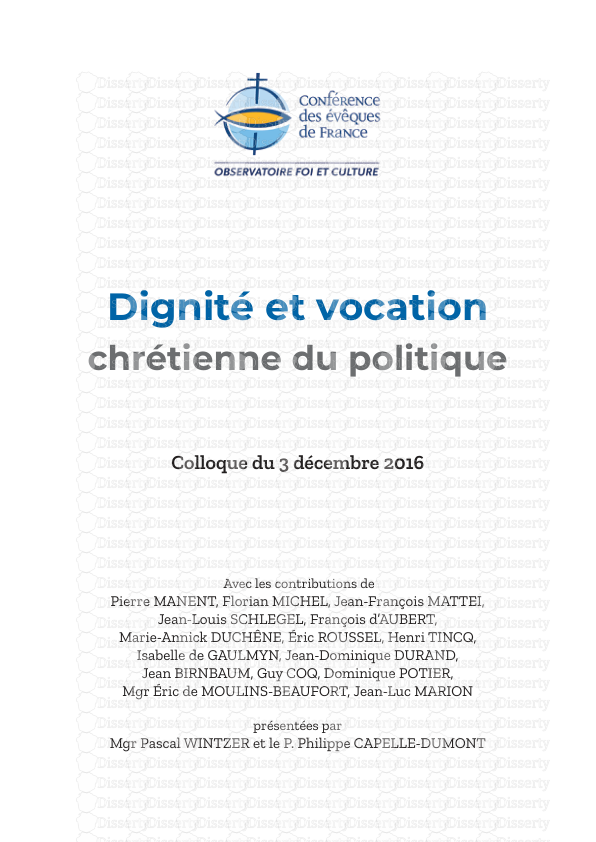

-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 10, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4233MB


