LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU DISCOURS POLITIQUE Christian Le Bart1 Les condi
LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU DISCOURS POLITIQUE Christian Le Bart1 Les conditions de production du discours politique ont changé en France comme dans toutes les démocraties occidentales. La contrainte d’exemplarité, qui obligeait les professionnels de la politique à se conformer aux logiques institutionnelles, est désormais critiquée pour sa lourdeur et sa prévisibilité. Les politiques peuvent désormais jouer la carte de la singularité, de la spontanéité, voire de l’improvisation. Plus précisément, ils doivent alterner entre ces deux registres (raideur institutionnelle et relâchement) selon qu’ils évoluent en contexte institutionnel ou bien en contexte plus médiatique. L’exemplarité linguistique a longtemps été valorisée comme forme d’excellence du discours politique. Elle mesurait l’adéquation au rôle du locuteur : il fallait bien parler et s’ajuster au rôle institutionnel endossé. La médiatisation de la vie politique conduit aujourd’hui à davantage valoriser la distance au rôle, l’improvisation, voire le relâchement. Selon les situations et les publics, les locuteurs jouent tantôt la carte de l’exemplarité, tantôt celle du relâchement. L’analyse du discours politique se déploie traditionnellement dans deux directions différentes. La première, interne, prend le discours comme objet et tente de le faire parler en donnant à voir des réalités 1 Christian Le Bart est Professeur de science politique à Sciences Po Rennes. Recherches en communication, n° 41 (2014). 36 Christian Le Bart discursives dont on peut dire qu’elles ne sont pas visibles à l’œil nu (ou audibles à l’oreille nue), c’est-à-dire dans les conditions ordinaires de la réception médiatique. L’exemple le plus convainquant pour illustrer cette démarche est l’analyse lexicométrique : le travail de quantification permet de dégager, par comparaison entre corpus, des reliefs significatifs (Mayaffre, 2004). La seconde démarche se situe du côté de la sociologie, de l’histoire et de la science politique. Elle consiste en l’analyse des conditions de production du discours politique (Le Bart, 1998). Elle est donc, à la différence de la précédente, externe. L’objectif est ici de recenser toutes les variables qui pèsent sur un locuteur et qui l’amènent à dire ce qu’il dit (et pas autre chose), et à le dire d’une façon particulière (et pas autrement). Les orientations de recherche sont multiples : on peut s’intéresser au locuteur en tant que personne (quelle est sa trajectoire sociale et politique ? Quel rôle occupe-t-il ? Quelles stratégies poursuit-il en l’instant t où il s’exprime ? Quels sont les éléments constitutifs de son identité qui sont à même de transparaître dans son propos ou dans son style ?...) ; on peut élargir la focale et s’intéresser au contexte de la situation de communication (quel ancrage institutionnel ? Quel public ? Quelle médiatisation ? Quels événements antérieurs ou à venir ? Quels enjeux ? Quel agenda politique ?...) et même plus largement encore au contexte sociopolitique au sein duquel prend place l’interaction en question (régime et situation politiques, calendrier électoral, situation nationale et internationale...). La difficulté est évidemment de parvenir à faire tenir ensemble toutes ces variables : ainsi verra-t-on dans la plus ponctuelle allocution d’un ministre à la fois le produit immédiat d’une intentionnalité tactique (exister dans le champ politique, s’imposer au sein d’un gouvernement, convaincre un public-cible, se rappeler au bon souvenir d’un électorat, s’imposer au sein d’un ministère...) et la résultante qui vient condenser une pluralité d’histoires entrelacées (histoire d’un individu, d’un ministère, histoire de la communication politique...). Ces deux approches sont pertinentes et se complètent. Idéalement, il faudrait autant que possible les croiser, pour mesurer à partir de corpus précis les effets des diverses variables possibles. La revue francophone Mots (sous-titre : Les langages du politique) s’efforce depuis plusieurs décennies de mener à bien un tel projet1. L’entreprise est difficile et se heurte à des obstacles des deux côtés : l’analyse de discours tend 1 Le projet fut lancé en 1980 en particulier à l’initiative de Maurice Tournier. Le directeur en est aujourd’hui Paul Bacot. Pour une synthèse, voir le numéro anniversaire pour les trente ans de la revue (Mots, 2010). 37 Les conditions de production du discours politique parfois à s’enfermer dans le matériau textuel et fait preuve de naïveté dans la mobilisation des variables explicatives ; symétriquement, la sociologie du discours méconnaît trop celui-ci et en reste trop souvent à la technique déproblématisée de la citation qui illustre à défaut de démontrer. On ne prétendra évidemment pas ici dépasser ces faiblesses. Nous voudrions plus simplement formuler, du point de vue de la sociologie du discours politique, une hypothèse de recherche relative à l’évolution de celui-ci. Nous esquisserons, exemple français à l’appui, une comparaison entre le discours politique classique, celui des débuts de la Cinquième République, et le discours plus contemporain. Le premier est marqué par le principe de la vigilance discursive : il faut bien parler et faire sur ce terrain comme sur les autres preuves d’exemplarité (§1). Aujourd’hui au contraire, les politiques n’hésitent plus à prendre leur distance par rapport à la norme linguistique : ils osent des écarts pour faire vrai, pour faire authentique, pour faire spontané (§2). Tout dépend évidemment des situations et des locuteurs. Il n’y a pas passage d’une façon de parler politique à une autre mais glissement progressif selon une logique qui est davantage celle de la sédimentation que celle de la rupture. En fonction des contextes, les professionnels de la politique apprennent à jouer tantôt la carte de l’exemplarité (bien parler), tantôt celle du parler relâché (§3). Notre ambition est de fournir quelques clés permettant d’expliquer ces évolutions. Elles ne se situent évidemment pas à hauteur de locuteur : ce dernier est pris dans un jeu de déterminations qui encadrent et structurent les stratégies discursives qu’il développe. Nous raisonnerons à l’échelle macrosociologique, et nous invoquerons la crise des institutions politiques comme variable centrale. C’est elle qui permet de rendre compte de la moindre pertinence des stratégies d’exemplarité institutionnelle. A l’inverse, la médiatisation (et même la peopolisation) du champ politique incite les gouvernants à jouer la carte de la distance au rôle, de la spontanéité plutôt que celle de la prévisibilité. S’écarter de la norme, qu’elle soit linguistique ou autre (vestimentaire par exemple), peut être aujourd’hui la meilleure façon de gagner en légitimité auprès d’une opinion publique moins centrée que jadis sur l’exemplarité institutionnelle. 38 Christian Le Bart 1. L’exemplarité institutionnelle du discours politique classique Les débuts de la Cinquième République sont marqués par la force des institutions sociales en général (famille, école, entreprise...) et politique en particulier (État, partis politiques). Dans ce contexte fort bien décrit par François Dubet (2002), la légitimité et la grandeur sont d’abord des ressources institutionnelles. Les individus peuvent en bénéficier à condition de s’appuyer sur elles : autorité et légitimité du professeur, du médecin, du maire ou du notable... Ceux-ci ont donc intérêt à coller au plus près des institutions, à représenter celles-ci avec docilité et déférence. Ainsi voit-on s’affirmer un intérêt à l’exemplarité : plus l’individu est à même de signifier l’institution, mieux il parvient à incarner cette dernière, plus il pourra recueillir confiance et légitimité. Ainsi de l’homme d’État ou du notable exemplaire, à qui l’on confiera d’autant plus volontiers le pouvoir de décider qu’ils semblent dignes d’incarner l’institution et le collectif. Être à la hauteur du rôle est un préalable à la légitimité. On trouve trace de ce souci d’exemplarité sur tous les terrains constitutifs de la présentation de soi des politiques : mise en scène de la vie familiale, apparence physique et vestimentaire, et bien sûr pratiques discursives. S’agissant de cette question spécifiquement, on observera le souci partagé par tous les professionnels de la politique de bien parler. La langue légitime est celle de l’école et de l’université, les écarts sont des fautes, les gouvernants appartiennent à une élite qui doit être exemplaire. La langue française est à la fois considérée comme un élément central du patrimoine immatériel national et comme un ciment permettant l’activation d’un espace public également national. On attend donc des politiques qu’ils habitent cette langue, qu’ils la célèbrent, et donc aussi qu’ils la respectent. La sociologie du recrutement politique ajuste quasi mécaniquement les élus à cette exigence. Souvent d’origine bourgeoise, plus souvent encore surdiplômés, les professionnels de la politique n’ont guère à se forcer pour bien parler. Il y a ajustement spontané, pour la plupart d’entre eux, entre les exigences du champ et l’habitus dont ils sont porteurs et qui les pousse spontanément, presque naturellement, vers la norme. Affleure parfois le souci de faire peuple (hypocorrection) mais dans des conditions peu institutionnelles (sur le terrain). La diversité des contextes et des publics oblige les professionnels de la politique à jouer d’une certaine diglossie : mais les contextes institutionnels les plus 39 Les conditions de production du discours politique exposés appellent tout naturellement le respect de la norme linguistique. On peut se laisser aller sur les marchés ou en fin de réunion, on se tient à la tribune ou à la télévision. N’est-il pas alors acquis pour tout le monde que l’art de bien parler constitue une ressource essentielle pour toute carrière politique ? L’histoire de la République a consacré le modèle du parlementaire professionnel du discours (avocat ou uploads/Politique/ article 2 .pdf
Documents similaires









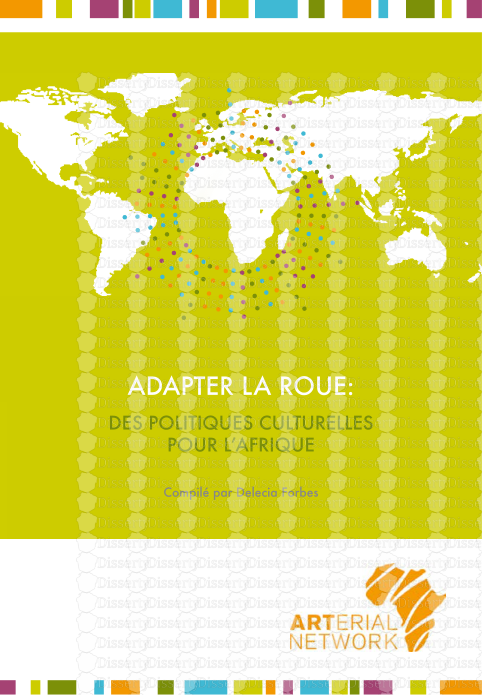
-
110
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 07, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2508MB


