Laure Guérin La démarche d’investigation à travers un Parcours d’Étude et de Re
Laure Guérin La démarche d’investigation à travers un Parcours d’Étude et de Recherche L’exemple des puissances en classe de 4 ème Désignation Rédacteur Date Démarche d'investigation Laure Guérin 01/04/12 PER Sommaire Introduction ............................................................................................................................... 4 I)La démarche d’investigation .................................................................................................. 4 1. Tentative de définition ....................................................................................................... 4 2. Les raisons qui ont poussé à parler de la démarche d’investigation ................................ 5 3. Les obstacles à la mise en place ........................................................................................ 6 4. Les apports de la TSD et de la TAD .................................................................................. 7 a)La Théorie des situations à usage mathématique ................................................................ 7 b)La Théorie anthropologique du didactique .......................................................................... 7 II)Les raisons d’être des puissances ......................................................................................... 8 1. Écologie des puissances .................................................................................................... 8 2. Les programmes ................................................................................................................ 9 3. Socle commun .................................................................................................................... 9 III)Organisation mathématique .............................................................................................. 11 1. Les différents types de tâches ........................................................................................... 11 2. Techniques et éléments technologiques associés ............................................................. 12 3. Énoncés des AER et grandes questions ............................................................................. 14 IV)Organisation didactique ..................................................................................................... 16 1.Généralités ......................................................................................................................... 16 2.Organisation chronologique de l’activité de la classe de 4ème ......................................... 16 3.Les différents moments de l'étude ....................................................................................... 18 a)Moment de la première rencontre ...................................................................................... 18 b)Moment exploratoire .......................................................................................................... 18 c)Moment de la constitution de l'environnement technico-technologique ............................ 18 d)Moment du travail de la technique .................................................................................... 19 e)Moment de l'institutionnalisation ....................................................................................... 19 f)Moment de l’évaluation ...................................................................................................... 19 PER V)Analyse des séances ............................................................................................................. 19 1. L'AER : Les bactéries et SoBig - première partie .............................................................. 19 2. L'AER : Les bactéries - deuxième partie ........................................................................... 35 3. L'AER : SoBig - deuxième partie ....................................................................................... 42 Conclusion ............................................................................................................................... 49 Annexes .................................................................................................................................... 50 PER Introduction Les puissances sont au programme de quatrième. Bien plus qu'une simple notation, les puissances font appel à une classe de problèmes où intervient un modèle multiplicatif réitéré. Comment développer au sein de la classe des activités porteuses de sens, motiver la notion de puissance en classe de quatrième ? I) La démarche d’investigation 1. Tentative de définition Dans le rapport Rocard on trouve une définition de l'investigation « Une investigation est un processus intentionnel de diagnostic des problèmes, de critiques des expériences réalisées, de distinction entre alternatives possibles, de planification. » Dans le dictionnaire on trouve qu'il s'agit de la recherche minutieuse d’enquêtes. Dans le cadre des mathématiques, la démarche d'investigation fait appel à la dimension expérimentale, sous la forme d'un problème à résoudre, d'une question. La démarche d'investigation est une démarche dans laquelle les élèves sont invités à se lancer lors de la recherche d'une question, que le professeur inviterait à se poser. La question doit être à fort pouvoir générateur. Elle doit donner du sens aux apprentissages et motiver les notions mathématiques abordées. On fera la différence entre recherche et investigation. En effet l'investigation permet d'aborder une classe de problèmes prototypiques d'une notion et non pas juste un problème en soi. Notons aussi la différence avec les enquêtes policières. Dans une démarche d'investigation, il peut y avoir pluralité des pistes et des solutions. La démarche d'investigation se distingue des démarches d'investigation des autres disciplines scientifiques par la validité des arguments. En SVT et en Sciences Physiques le monde réel permet de valider les arguments. En mathématiques, c'est la démonstration qui valide ou invalide les arguments. Toutes les activités et notamment celles des manuels sont elles pertinentes dans une démarche d’investigation? Il faut faire attention à la pertinence de l'investigation. En effet si l'on trouve directement la réponse, la question n'a pas de sens et donc il n'y a pas d'intérêt de se lancer dans une investigation. Certaines activités des manuels sont construites de telle façon que les élèves ont à remplir des trous dans un texte, trous pour lesquels avec PER l’article défini et le thème, une seule réponse est possible. L’élève peut donc répondre par déduction mais sans en comprendre le moindre sens. Il s’agit d'ostension déguisée, c'est à dire la fiction que l’élève produit le savoir par son acte. « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». La responsabilité de produire la réponse incombe au professeur. Mais où est alors passée la question dont le savoir constitue un élément de réponse ? Moins directe qu'un cours magistral (ostension directe et assumée), il n'en reste pas moins que l’élève peut sans faire des mathématiques répondre aux questions grâce au guidage. La question sous-jacente est souvent trouvée par les bons élèves qui feront tout seuls des liens mais pas pour les autres. De même si le problème est fictif, pourquoi se poser des questions. ? Il y a un degré de crédibilité de la question. Il faut pouvoir la prendre au sérieux. L’élève doit donc produire dans une démarche d'investigation, ses connaissances comme réponse personnelle à une question. S'il n’y a pas de question, il ne peut pas y ' avoir de réponses. Le professeur ne peut pas dire avant ce que l’élève doit faire. Cependant l’élève doit accepter de résoudre et de chercher des problèmes dont il ignore la réponse. La responsabilité de faire rencontrer la question par les élèves et de leur faire produire la réponse incombe au professeur. Il y a donc changement dans la nature, la conception du métier. L'unité classe disparaît pour devenir des groupes d’études. Le professeur devient alors directeur d’étude de la question. Il a la responsabilité non pas de la construction de la réponse mais de celle de l’organisation des conditions pour produire une réponse. Il n'est plus concepteur d’activités mais organisateur d’activités. 2. Les raisons qui ont poussé à parler de la démarche d’investigation Le rapport Rocard indique un déclin inquiétant de l'intérêt des jeunes pour les études scientifiques. Lors d'un questionnaire de Meirieu les mathématiques sont associées à des citations négatives contrairement au sport, aux sciences sociales... Les mathématiques servent à assurer un accès à certains diplômes, à certains débouchés. Les étudiants ne semblent pas éprouver de plaisir à faire des mathématiques. Le choix de la spécialité mathématiques est en chute. Les enquêtes PISA de 2009 semblent montrer la France en vingt-deuxième position avec une chute de 14 points depuis 2003. Les écarts s'accentuent. Les meilleurs deviennent meilleurs et les plus faibles de plus en plus faibles. Le rapport Rocard indique aussi que ce désintérêt réside dans la méthode d'enseignement. Le passage de méthodes essentiellement déductives à des méthodes PER basées sur l'investigation est le meilleur moyen d’augmenter l'intérêt des jeunes pour les mathématiques. 3. Les obstacles à la mise en place Les obstacles qui limitent l’usage de la démarche d'investigation sont culturels. Ils sont aussi professionnels. Problématiser un savoir n'est pas courant, on cherche en général plus à le décomposer en éléments simples. Dans le découpage en petits « morceaux », on perd le sens global des notions. Les obstacles sont aussi conceptuels. Le professeur doit s'engager dans des gestes inhabituels, imprévus. Il y a aussi des problèmes de légitimité. La question peut amener à s'engager dans un domaine autre que mathématique, ce qui peut déstabiliser le professeur. Le professeur peut donc fuir ou dénigrer une telle façon de faire. Certaines contraintes structurelles freinent la démarche d’investigation. ● La tyrannie de l’heure Un problème doit être résolu dans les cinquante minutes du cours. Dans cette heure, le professeur ne s’autorise pas à laisser partir les élèves sans avoir fini de résoudre le problème. Il doit en une heure amener le problème, sa solution, le cours (institutionnalisation) , les exercices d’application et d’entraînement. Les problèmes sont donc forcément clos, sans ouverture. Le travail est balisé. L'inattendu a peu de risque d’apparaître. ● Le poids d'un certain constructivisme : « les élèves aux mains nues » Un problème, leur étant posé, les élèves doivent tenter de résoudre seuls et uniquement avec leurs connaissances antérieures les problèmes proposés. Les moyens d’étude sont fortement limités. Il en résulte que l’élève attend docilement que le professeur donne la solution. Il y a peu de dynamique dans la classe. L’élève sait que tôt ou tard le professeur apportera la réponse. Il suffit d’attendre. Dans la démarche d'investigation, la question problématique est dévolue aux élèves. Les moyens d'enquêter sont ouverts. On peut noter que, seule, l’école n’autorise pas à étudier des éléments de réponses déjà existants sur une question. A l'université, le premier travail d'un chercheur sur une question consiste à s'informer des réponses déjà présentes sur le sujet. PER 4. Les apports de la TSD et de la TAD a) La Théorie des situations à usage mathématique Lorsque les élèves sortent de l’école, ils doivent être capables d’utiliser les connaissances acquises dans des situations non didactiques. Le sujet cherche à produire des actions pour agir sur un milieu. Le sujet apprend en s’adaptant au milieu. Brousseau a nommé ce processus l’apprentissage par adaptation. Le professeur devient l’organisateur des jeux de l'élève avec le milieu. Il doit choisir les situations a-didactiques les plus adaptées. Son rôle est d’encourager les élèves en fixant les règles du jeu, mais aussi d’observer le travail des élèves et d’en contrôler l’avancement. Le sujet agit et interagit avec le milieu. Le professeur lui- même est en situation et en interaction avec un milieu. L’enseignant se débrouille pour faire uploads/Philosophie/ les-puissances-laure-guerin-pdf.pdf
Documents similaires

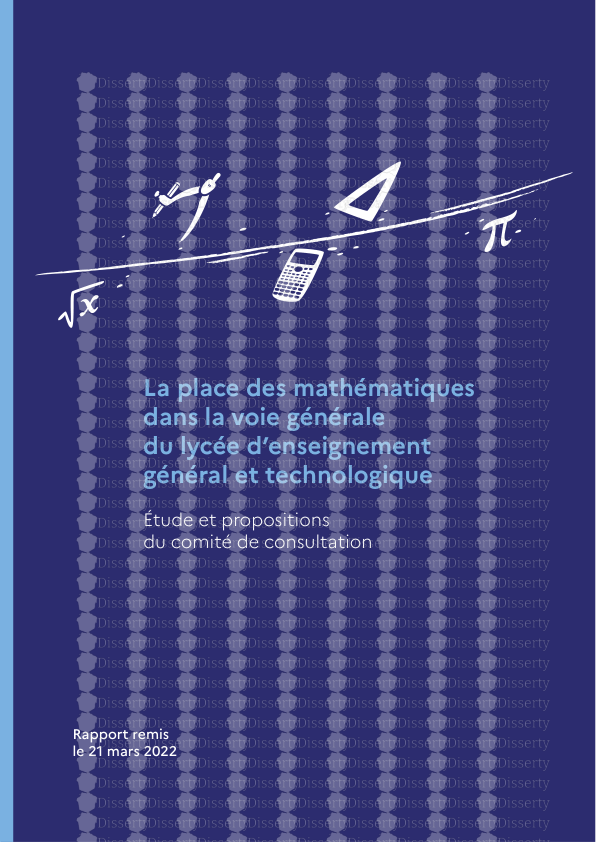








-
95
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 15, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4580MB


