06/07/2018 L’ivresse des formes et l’illumination profane https://journals.open
06/07/2018 L’ivresse des formes et l’illumination profane https://journals.openedition.org/imagesrevues/291 1/10 Images Re-vues Histoire, anthropologie et théorie de l'art Hors-série 2 | 2010 : L'histoire de l'art depuis Walter Benjamin L’ivresse des formes et l’illumination profane GEORGES DIDI-HUBERMAN Entrées d'index Mots-clés : Einfühlung, aura, Brecht (Bertold), vertige Texte intégral L’ivresse des formes Dans un bel article sur les rapports entre image épique chez Bertold Brecht et image dialectique chez Walter Benjamin, Philippe Ivernel rappelle la discussion menée par les deux hommes au sujet de la question comment habiter ce monde1? Ou, dit autrement : comment douter de la réalité ? Comment parvenir à douter utilement de ce qui nous environne et où nous habitons, aliénés par trop d’habitudes ? Brecht, on le sait, propose avec la distanciation (Verfremdung) un outil pour connaître le monde environnant sous l’angle de la singularisation, de l’étrangeté, de la désappropriation, façon d’« appréhender l’habituel en ce qu’il a d’impensé, en l’occurrence de le comprendre 1 06/07/2018 L’ivresse des formes et l’illumination profane https://journals.openedition.org/imagesrevues/291 2/10 « Rien ne distingue davantage l’homme antique de l’homme moderne que son abandon à une expérience cosmique que ce dernier connaît à peine. Le déclin de cet abandon s’annonce déjà à l’apogée de l’astronomie, au début des temps modernes. Kepler, Copernic, Tycho Brahé n’étaient certainement pas mus exclusivement par des impulsions scientifiques. Il y a cependant, dans l’importance exclusive accordée à la relation optique avec l’univers, résultat auquel l’astronomie a très tôt abouti, un signe précurseur de ce qui devait arriver. Les rapports de l’Antiquité avec le cosmos s’instauraient d’une autre façon : dans l’ivresse [im Rausche]. Or, est l’expérience par laquelle nous nous assurons seuls du plus proche et du plus lointain, et jamais l’un sans l’autre [Ist doch Rausch die Erfahrung, in welcher wir allein des Allernächsten und des Allerfernsten, und nie des einen ohne des andern, uns versichern]. Mais cela signifie que l’homme ne peut communiquer en état d’ivresse avec le cosmos qu’en communauté [in der Gemeinschaft]. […] Lors des nuits d’anéantissement de la dernière guerre les membres de l’humanité étaient ébranlés par un sentiment qui ressemblait à la béatitude des épileptiques. Et les révoltes qui suivirent cette guerre furent la première tentative pour se rendre maître de ce nouveau corps. […] L’être vivant ne surmonte le vertige de l’anéantissement [Taumel der Vernichtung] que dans l’ivresse de la procréation [Rausche der Zeugung]. »6 comme une réalité historique » toujours capable de s’altérer ou de s’améliorer, de se métamorphoser en tout cas2. Ce qui laisse au monde environnant la possibilité de se voir recadré et remonté autrement, bref, de susciter une expérience nouvelle, une connaissance autre. Walter Benjamin, de son côté, aboutit à ce même décadrage, à ce même remontage, par les voies d’une réflexion sur ce qu’il nomme l’« aura authentique » ou « aura sécularisée », fortement opposée à l’aura cultuelle des mises en scènes religieuses et des théosophies. Façon de réintroduire dialectiquement ce que la Verfremdung croit tenir à distance, à savoir l’empathie pour le monde environnant, l’Einfühlung3. Ce n’est ni le culte des mystères ni la transcendance que Benjamin veut ici réintroduire, bien sûr. Mais l’expérience, au double sens de l’Erfahrung et de l’Experiment. Et c’est là que les images et leur ivresse entrent en jeu. Qu’est-ce que le risque de se livrer à l’ivresse des images, sinon l’acte de faire l’expérience des limites où se tient notre propre raison, nos propres sensations ou nos relations à autrui ? Philippe Ivernel a donc bien raison d’en appeler à ce « chemin de contrebande » que fut, dans l’œuvre « épistémo-critique » de Benjamin, son expérience avec les drogues4. C’est que « l’image dialectique entend polariser l’opposition entre l’onirique et le scientifique afin de fonder au mieux l’exigence de la praxis »5. 2 Souvenons-nous des dernières lignes de Sens unique et de cette façon qu’aura eue Benjamin d’y dialectiser la science avec l’ivresse, puis l’ivresse avec les questions politiques fondamentales de la communauté et de la révolution : d’abord, l’astronomie scientifique est dite avoir introduit une relation au monde de pur savoir optique et instrumental qui détruit la relation d’ivresse dionysiaque que les Anciens entretenaient en communauté avec le cosmos ; ensuite, la situation politique de 1918 est décrite comme un processus d’anéantissement dont le vertige négatif ne pourra être surmonté que dans une ivresse révolutionnaire, c’est-à-dire une ivresse en communauté : 3 Voilà donc, pour Walter Benjamin, ce qu’il s’est agi d’éprouver (erfahren) dans les ivresses expérimentales (experimentelle) qu’il mit en œuvre, entre 1927 et 1934, par l’absorption de diverses drogues7. Il s’agissait alors de produire une expérience du monde qui fût vraiment au-delà de l’empathie et de la distanciation : une expérience où, comme on vient exactement de le lire dans Sens unique, « nous nous assurons seuls du plus proche et du plus lointain, et jamais l’un sans l’autre ». Il y a d’abord une étrangeté due à la « métamorphose incomplète » de toutes choses, ce qui, on peut le noter, donnait chez Brecht la caractéristique même de la distanciation : « Les gens à qui on a affaire […] ont fortement tendance à se métamorphoser un peu, je ne dirais pas à devenir étrangers, ni à cesser d’être familiers, mais à ressembler un peu à des étrangers »8. 4 Ainsi, la main qui allume une bougie peut elle-même devenir, dans l’ivresse haschichique, « cireuse » : l’identité et la fixité des choses laisse la place à une altération et une métamorphose dans lesquelles le sujet se trouve comme entraîné, noyé, empathiquement immergé9. En sorte que l’effet d’étrangeté fait revenir l’aura, paradoxalement, au premier plan, jusque dans la tonalité comique que l’expérience peut revêtir : 5 06/07/2018 L’ivresse des formes et l’illumination profane https://journals.openedition.org/imagesrevues/291 3/10 « Tous les présents s’irisent de comique. En même temps, on se pénètre de leur aura [zugleich durchdringt man sich mit ihrer Aura]. […] Premièrement l’aura authentique [die echte Aura] apparaît sur toutes les choses. Pas seulement sur certaines comme les gens se l’imaginent. Deuxièmement l’aura se modifie entièrement et de fond en comble à chaque mouvement que fait la chose dont le mouvement est l’aura. Troisièmement l’aura authentique ne peut en aucune façon être pensée comme le nimbe magique et spiritualiste impeccable que les livres mystiques vulgaires reproduisent et décrivent. »10 Remarques fondamentales : l’aura se trouve en même temps démythifiée, « sécularisée », et comme resserrée dans son Urphänomen. D’une part, elle n’est « authentique », dit Benjamin, qu’à concerner toutes choses, et non pas cet unique et grandiose écrin que désigne là-bas, au fond de l’église, la relique ou l’icône sacrées. D’autre part, elle ne va jamais sans un mouvement et une métamorphose presque cinématographiques de ses qualités, quand l’icône et la relique, pour leur part, ne tirent leur puissance auratique que de leur immobilité et de leur pérennité absolues. Enfin, Benjamin tire de son expérience d’ivresse haschichique une conclusion radicalement moderne, matérialiste et formaliste (donc radicalement antispiritualiste) : « …ce qui désigne l’aura authentique [est] l’ornement, une inclusion ornementale [das Ornament, eine ornamentale Umzirkung] dans le cercle où la chose ou l’être se trouve étroitement enserré comme dans un étui. Rien ne donne de l’aura une idée aussi juste que les toiles tardives de Van Gogh, où l’aura est peinte en même temps que l’objet… »11. 6 Ce qui est en jeu dans la notion d’aura repensée par Benjamin dans le prisme de ses expériences avec la drogue n’est rien d’autre, en tout cas, qu’une nouvelle conception de l’esthétique articulée sur le phénomène de l’ivresse des formes, ivresse elle-même expérimentée à même les choses les plus concrètes, les plus banales, de notre monde environnant. Ivresse des formes : cela signifie, d’abord, une hyperesthésie, une hyperacuité du sujet quant au monde visible et au monde sensible en général : « On devient si sensible : on craint qu’une ombre tombant sur le papier ne puisse l’endommager. »12 Cela signifie, ensuite, que les formes objectivement prolifèrent : « Il peut y avoir […] une production de véritables rafales d’images [eine geradzu stürmische Bildproduktion], indépendamment de toute autre fixation et polarisation de notre attention. […] À vrai dire la production d’images peut faire venir au jour des choses si extraordinaires et cela si fugitivement et avec une telle vitesse que nous ne parvenons plus, tout simplement en raison de la beauté et de la singularité de ces images, à nous intéresser à autre chose qu’à elles. »13 7 Or, tout, dans cette ivresse des formes, semble se passer entre des dimensions ou des mouvements associés entre eux sur un mode typiquement cinématographique : un mouvement centripète, vorace et focalisateur de la masse, du gros plan considéré comme un gouffre à regard (« Masque de son propre visage. […] La mort se trouve entre moi et mon ivresse »14) ; le mouvement tranchant de la division, du cadre, de la coupure (« La représentation se divise elle-même et donne libre accès à de nouveaux trésors d’images »15) ; et, enfin, la multiplication, la digression rapide ou le passage incessant. uploads/Philosophie/ l-x27-ivresse-des-formes-et-l-x27-illumination-profane-didi-huberman-georges-pdf.pdf
Documents similaires


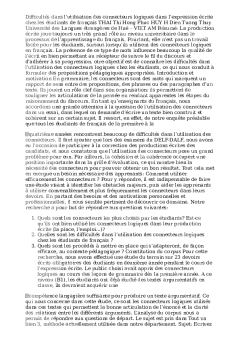







-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 08, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2578MB


