Master de recherche JURISTE D’AFFAIRES Exposé sous le thème : Encadré par: Prof
Master de recherche JURISTE D’AFFAIRES Exposé sous le thème : Encadré par: Professeur M. Alaoui Bouchta Présenté par : Anouar Zineb Boudrichi Firdaws Lahlou Ayoub Mellouki zineb Sahib Yousra ANNEE UNIVERSITAIRE: 2017/2018 La protection des marques de fabrique de commerce et de service 2 Plan Introduction Partie I : la protection nationale des marques de fabrique de commerce et de service Chapitre I : La protection juridique de la marque Section1: Le régime juridique d’acquisition du droit sur la marque Section2: La validité des marques et leur classification Chapitre II : La protection judiciaire de la marques Section 1:les faits générateurs des actions en justice Section 2:le déroulement des actions relatives à la protection des marques Partie II : la protection internationale des marques de fabrique de commerce et de service Chapitre I : le cadre réglementaire de la protection Section 1 : traités et conventions généraux Section 2 : traités et conventions spécifiques Chapitre II : le cadre institutionnel de la protection Section 1 : les organismes internationaux de la protection des marques Section 2 : les modes alternatifs du règlement des litiges internationaux Conclusion 3 Introduction : La propriété intellectuelle est un domaine du droit qui vise à protéger la connaissance générée par le travail humain pour stimuler et promouvoir le développement de la créativité. Elle est présentée comme un moteur du développement économique et de la création de richesse qui n’est pas encore utilisé partout de manière optimale, en particulier dans les pays en développement. Vers la fin du 19ème siècle, des moyens de fabrication novateurs ont provoqué une industrialisation à grande échelle, qui s’est notamment accompagné des phénomènes suivants : urbanisation rapide, investissement de capitaux et essor du commerce.1 C’est également de cette époque que date l’origine du système international de la propriété intellectuelle, avec deux traités de propriété intellectuelle fondamentaux, à savoir la convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle et la convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Le droit de la propriété intellectuelle concerne des objets assez différents, les uns sont des créations de forme (œuvre de l’esprit, dessins et modèles) ou des innovations techniques (inventions, obtentions végétales…) ; les autres couvrent le rapport d’un signe à l’activité, aux produits ou aux services d’un agent économique pour les distinguer de ceux de ses concurrents et faciliter les choix des concurrents. Il s’agit des signes distinctifs (marques, nom commerciaux, indications de provenance, appellations d’origine…) qui ne supposent aucun acte de création ou d’invention.2 On comprend donc que l’expression « propriété intellectuelle » concerne les créations de l’esprit humain, tout ce que son intelligence et son imagination lui ont permis de créer les produits que nous utilisons ou consommons. On 1 Comprendre le droit de la propriété industrielle, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, édition 2016, page : 3. 2 F, Polland-Dullan, droit de la propriété industrielle, édition Montchrestien 1999, page : 1. 4 distingue la propriété littéraire et artistique appelée aussi droit d’auteur et droits connexes et la propriété industrielle. Cette dernière constitue un facteur de développement technique et de progrès économique, dans un monde marqué par la globalisation et la mondialisation des marchés, et où la concurrence devient de plus en plus acharnée. La mise en place d’une politique rationnelle d’organisation des droits de la propriété industrielle, et plus particulièrement le droit des marques, tend à devenir une stratégie vitale pour la plupart des entreprises industrielles et commerciales.3 Il est évident que le droit des marques, joue un rôle primordial et direct dans le développement de l’économie nationale et la mise à niveau des entreprises, à tel point qu’il pourrait concurrencer d’autres facteurs tels que : les procédés de distribution et de commercialisation, les moyens publicitaires et les méthodes de gestion des ressources humaines et financières les plus développées. Cependant, la marque présente des aspects divers dont il est difficile de tenir compte dans une même définition. C’est ainsi que la marque a fait l’objet de plusieurs définitions. Selon une définition classique, « la marque est un signe qui permet à toute personne physique ou morale de distinguer les produits, les objets de son commerce ou de ses services de ceux des tiers ». On en déduit que le terme « marque » vise à la fois la marque de fabrique, de commerce et celle de service. Les législations marocaines et françaises définissent la marque comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».4 Il est évident que la diversité des définitions du terme « marque » illustre parfaitement l’évolution qu’a connue ce concept au fil des temps. Cette évolution touche également aux fonctions de la marque. Initialement, celle-ci avait exclusivement pour fonction l’identification du produit qui en est 3 Pouillet, « traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale » 6ème édition, 1912, n 4. 4L’article 133 de La loi 17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 23-13 et 31-05. 5 couvert et l’indication d’origine et ce dans l’intérêt du fabriquant ou commerçant comme dans celui du public.5 En effet, la marque est un signe distinctif qui indique que des produits ou services sont produits ou fournis par une certaine personne ou une certaine entreprise. Ce système aide les consommateurs à reconnaitre et à acheter un produit ou un service donné parce que la nature et la qualité de celui-ci, indiquée par sa marque unique, répond à leurs besoins. La marque offre une protection à son propriétaire, en lui donnant le droit exclusif de l’utiliser pour désigner des produits ou des services, ou d’autoriser un tiers à le faire en contrepartie d’une rémunération. La durée de la protection varie, mais une marque peut être renouvelée indéfiniment moyennant le paiement de taxes additionnelles. La protection des droits attachés à une marque est garantie par les tribunaux qui, dans la plupart des systèmes juridiques, ont compétence pour faire cesser les atteintes aux marques. La protection des marques empêche également les concurrents déloyaux, par exemple les contrefacteurs, d’utiliser des signes distinctifs identiques ou semblables pour commercialiser des produits ou services différents ou de qualité inférieure. Les marques peuvent se composer de mots, de lettres et de chiffres, isolément ou en combinaison. Elles peuvent consister en dessins, symboles, signes tridimensionnels tels que la forme et l’emballage des produits, signes sonores tels que sons, phrases musicales utilisées comme signes distinctifs, ou encore des marques olfactives.6 Il faut observer qu’outre ses fonctions d’identifications du produit, la marque remplit de plus en plus des fonctions purement économiques.7 Elle constitue un moyen largement utilisé pour conditionner la demande par l’intermédiaire de la publicité.8 Celle-ci est devenue le moyen le plus 5 François Curchod, « l’avenir de la marque : érosion regrettable ou adaptation souhaitable », revue office fédéral de la propriété intellectuelle, Berne, suisse, 1980, page : 37. 6 Paragraphe 2 de l’article 133 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 23-13 et 31-05. 7 P. bassard, « la marque dans l’économie », Ripia 1966, page : 85. 6 important pour augmenter la notoriété de la marque et lui attirer le plus grand nombre de clients. La marque crée un phénomène psychologique par lequel le consommateur lie par une sorte de réflexe un produit et la marque que le désigne. Elle est également l’instrument de toute une stratégie économique dans l’organisation des marchés, des circuits de la distribution. C’est une arme de choix dans la lutte qui oppose les grandes surfaces et le commerce de luxe ou le petit commerce, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. C’est pour cette raison que nous retiendrons dans une première partie la protection nationale des marques alors que la deuxième partie sa sera réserver à la protection internationale des marques. Partie I : la protection nationale des marques de fabrique de commerce et de service 8 J.C.Fourgoux, « marque, publicité et tromperie », Pibd 1970, page : 554. 7 L’objectif primordial pour le propriétaire de la marque est de protéger sa marque à l’intérieur du pays où il exerce son activité et où il a des intérêts, ce qui génère une contribution à l’activité économique. De ce fait, il est utile d’étudier au niveau de cette partie les démarches nécessaires pour une protection légale des marques (chapitre1), ainsi que la protection dite judiciaire (chapitre2) Chapitre I : La protection juridique de la marque Comme précité, la marque se présente, tant pour le consommateur que pour le producteur, comme un moyen de distinction entre les divers produits et services. Or, pour qu’un tel signe commercial distinctif puisse être protégé, encore faut-il qu’il remplisse certaines conditions et que son prétendant titulaire accomplisse un acte d’appropriation lequel diffère d’une législation à une autre. Cet acte peut être soit l’usage, soit l’enregistrement, soit les deux à la fois. Ainsi pour mieux éclaircir les problématiques soulevées, il nous pourrait nécessaire d’examiner uploads/Marketing/ la-protection-des-marques-de-fabrique-de-commerce-et-de-service.pdf
Documents similaires







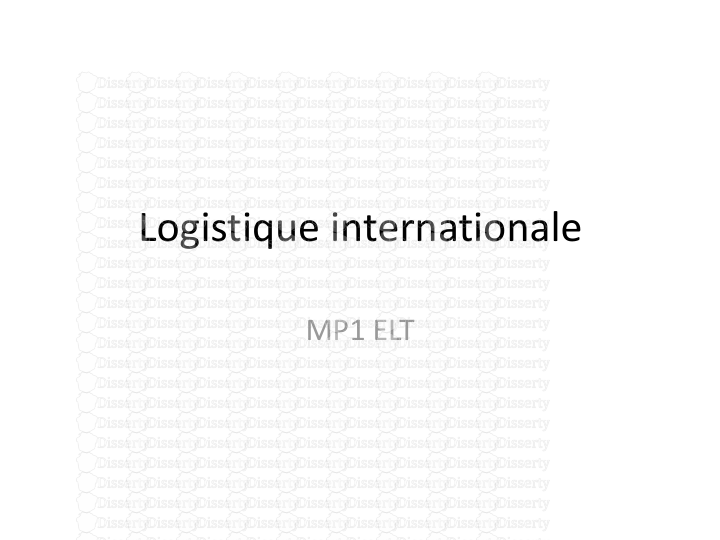


-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 06, 2022
- Catégorie Marketing
- Langue French
- Taille du fichier 1.5403MB


