Droit de la consommation thibaud.lelong@ceipi.edu/uha.fr/unistra.fr Examen : ca
Droit de la consommation thibaud.lelong@ceipi.edu/uha.fr/unistra.fr Examen : cas pratiques Qu’est-ce que le droit de la consommation ? Matière qui va protéger le consommateur. Consommateur protégé au-delà des simples faits de commerce, aussi dans la vie de tous les jours (après l’achat). Plus large que la simple protection du consommateur pendant l’achat. Quels sont les personnes impliquées par le droit de la consommation : - le consommateur - le professionnel Le droit de la consommation implique TOUJOURS une relation entre un consommateur et un professionnel (B to C). Sont exclus le B to B et le C to C. 7 jours de délai de rétractation : ne sont pas valables dans toutes les situations, seulement dans les ventes à distance et démarchage à domicile, prestation de service s’il n’a pas été consommé. On peut rendre le produit ou annuler le contrat dans les 7 jours. Vente à distance : achat par internet, par téléphone, mail, courrier (vente sur catalogue), fax, … Démarchage à domicile : vendeurs porte à porte, publicité avec une offre adressée personnellement avec invitation de se rendre au magasin, par téléphone, les foires et les salons Pourquoi délai de 7 jours seulement dans ces cas-là ? Sur internet, l’article n’est pas physique. Un salon est temporaire, el consommateur le voie comme une occasion à saisir, il est donc sous pression ce qui peut fausser son jugement. Vente à domicile : on n’a pas choisis d’y aller comme à la foire, on dit que l’offre est temporaire, mise sous pression. Plus agressif, il faut encore plus protéger le consommateur. Publicité personnelle : moyen pour nous attirer dans le magasin, fausse le jugement. Souvent, le bénéfice de l’offre est subordonné d’un cadeau, qui va nous attirer dans le magasin, ce qui fausse encore une fois le jugement. Ceci est la loi, certains magasins ont dans leur condition de vente un délai de rétractation (magasin de vêtements, fnac, …). Ce n’est pas la loi qui oblige, c’est le magasin qui le choisi. Dans certains cas, un professionnel qui va acheter une prestation de service ou un bien auprès d’un autre professionnel va tout de même pouvoir être considéré comme un consommateur. Dans une société libéralisme, tout s’achète et tout se vend : libre échange. Droit de la consommation : impose des barrières, donc pas libre échange. Pourquoi pas de B to B ? Consommateur : particulier : profane : il n’a pas la même connaissance que le professionnel dans le domaine qu’il va contracter. Déséquilibre car pro cherche à vendre à tout pris et consommateur risque de se faire influencer par le pro, a moins de connaissances, est plus vulnérable. Le droit de consommation essaie de rétablir un équilibre dans la relation conso- pro. Schéma socialiste plutôt que libéral. 1 Chapitre 1 : les éléments fondamentaux Section I : le consommateur I.1. Définition Le problème avec le consommateur est qu’il n’existe pas de définition légale du consommateur. Il existe un code (ensemble de lois) de la consommation : toutes les lois concernant la consommation réunies dans un livre, elles sont classées dans des catégories qui existent déjà dans le code. Exemple : information sur internet, dans le magasin, sur le produit lui-même, … . T out ce qui concerne l’information est regroupé dans une section. Une section va concerner le délai de rétractation, le démarchage à domicile, … . Dans une loi les articles se suivent tous mais dans le code ils sont reclassés par section. Même dans le code de la consommation, il n’y a pas de définition du consommateur. Consommateur : personne qui acquiert ou qui utilise un bien ou un service dans un but non professionnel. La consommation a changé au moment de la révolution industrielle. Avant, relations de commerce étaient personnalisées, petites et moyennes entreprises, artisans. Après les 30 glorieuses : tout s’accélère en matière de droit de la consommation. Deuxième accélération à la fin des années 80 avec la mondialisation. Il a fallu protéger de plus en plus les consommateurs car l’acte de consommation s’est fortement développé et complexifié, et fait courir un risque plus grand au consommateur. 1951 : création de l’union fédérale des consommateurs : l’UFC Que Choisir : plus grosse association de consommateurs en France, publie un magasine qui traite des problèmes de consommation. Le droit de la consommation est apparu dans les années 50, quelques règles existaient depuis longtemps mais peu. On a commencé à considérer la consommation comme une matière dans les années 70 (il y avait assez de règles). Le code de la consommation date de 1993. Les droit de la consommation est un empilement de différentes règles : droit opportuniste. Au lieu d’avoir une philosophie générale on a un empilement de loi, on se rend compte qu’il y a un problème, on prend telle loi, …, briques qui s’empilent plus ou moins bien. I.2. Le problème Le mot « consommateur » figure dans la loi française et dans des textes internationaux (traités, conventions) mais il n’est pas définit. Dans ces traités et conventions, le consommateur peut être des fois définit mais sans qu’il y ai un lien avec le droit à la consommation. Exemple : Convention de Rome : accident de voiture en Allemagne avec un Italien, la convention de Rome va définir quelle loi (française, allemande, italienne) et quelle juridiction va être appliquée. Le droit de la consommation correspond à l’ensemble des règles dont le but est de protéger le consommateur dans leurs relations avec les professionnels. Aujourd’hui, le droit de la 2 consommation va bien au-delà. Le champ d’application du droit de la consommation s’étend aujourd’hui à des situations qui exclues le consommateur. Exemple : règlement pour les étiquettes sur les produits : le consommateur va en bénéficier mais il n’est pas directement impliqué. Parfois, la loi va considérer comme consommateur un professionnel qui passe des actes dans un but non professionnel. Certains professionnels, dans certaines situations seront considérés comme des consommateurs. Généralement, ce sont des situations ou les professionnels agissent en dehors de leur domaine de compétences. Le but du droit de la consommation est de rétablir un équilibre, on verra qu’un professionnel est considéré comme consommateur quand celui-ci est profane dans un domaine au même titre qu’un consommateur (en situation d’infériorité). I.3. La jurisprudence Jurisprudence au sens large : ensemble des décisions de justice. En France, quand on commence une action en justice il y a : - la première instance, ou 1er degré : TI (tribunal d’instance) compétent jusqu’à 10 000€ sinon : TGI (tribunal de grande instance) TA (tribunal administratif) Cour d’assise - la deuxième instance, ou 2ème degré : CA (cours d’appel : chambre criminelle, sociale, …) Cour administrative d’appel - la troisième instance : Cour de cassation Conseil d’état (en matière publique) Magistrats plus jeunes se retrouvent au 1er degré. 1er degré : déterminer quelle est la vraie histoire. 2ème degré : redéfinition de l’histoire puis arrêté définitivement 3ème degré : décider si la loi a été correctement appliquée en fonction de l’histoire. Droit public : Etat vs Etat Etat vs Privé Droit pénal : (entre les deux) une partie privé (privés qui portent plainte contre le criminel ou délinquant) et l’Etat (qui va également porter plainte contre le criminel ou délinquant). Droit privé : le reste La jurisprudence est ce qu’on va utiliser pour expliquer, interpréter la loi. Un texte de loi est assez large pour concerner le plus grand nombre de situations possibles. Le problème est que la vie est faite de situations particulières. Les tribunaux et les cours sont là pour décider de quelle façon doit être appliqué la loi dans telle ou telle situation. On dit qu’une « décision va faire jurisprudence » car elle est lié à des décisions prisent auparavant. La jurisprudence à été obligé de définir le consommateur. 1. la personne du consommateur a. Le consommateur est en principe une personne physique càd un individu. Personne physique ≠ Personne morale - personne physique : un citoyen X ou Y 3 - personne morale : o publiques (doivent être appelées : personnes publiques de droit privé, sont la pour gagner de l’argent donc certaines parties du droit privé les concernent) : administrations (agences gouvernementales, universités, hôpitaux, écoles, collèges, lycées, …) entreprises publiques (SNCF, La Poste, EDF, GDF, …) o de droit privé : les entreprises privées les associations La cour de cassation dit que généralement, une personne physique, un individu est un consommateur et même, un consommateur est une personne physique. b. le consommateur peut pas exception être une personne morale La cour d’appel de Paris nous a dit en 1998 : le consommateur est la personne physique ou morale qui sans expérience particulière dans le domaine ou elle contracte agis pour la satisfaction de ses besoins personnels et utilise dans ce seul but le service ou le produit acquis. Cas ou des professionnels ont été considéré comme consommateurs : - un partit politique qui a contracté un crédit à la consommation - un syndicat de copropriétaires qui a été considéré uploads/Marketing/ droit-de-la-consommation 3 .pdf
Documents similaires




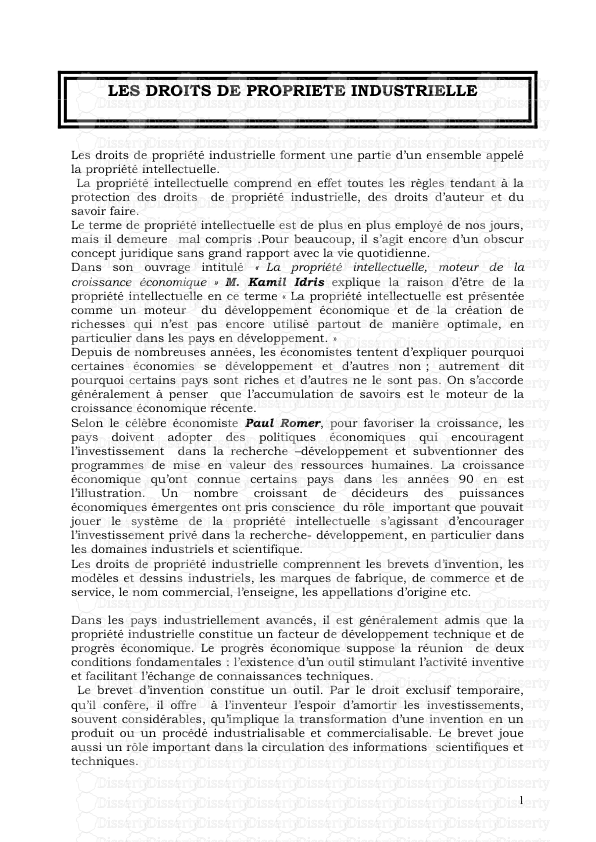





-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 23, 2022
- Catégorie Marketing
- Langue French
- Taille du fichier 0.1169MB


