« Variantes de la cure-type » par Jacques Lacan, Médecin des Hôpitaux psychiatr
« Variantes de la cure-type » par Jacques Lacan, Médecin des Hôpitaux psychiatriques, publié dans l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale – Psychiatrie – le 3 février 1955, référencé cote 37812 C10 pages 1 à 11. Ce texte fut supprimé de l’E.M.C. en 1960. Nous reproduisons les variations de taille de caractère proposés par ce texte-source. (1)UNE QUESTION chauve-souris : L’EXAMINER AU JOUR. On attendrait ici l’annonce des variantes de la cure. Le titre « Variantes de la cure- type » fait boiteux. Mais cette boiterie a sa raison. L’ambiguïté de la formule peut mener droit à la question, non sans qu’on s’interroge d’abord si elle lui est intrinsèque, ou si elle trahit un gauchissement de la question dans un contexte d’information médicale. Mais ce pas d’arrêt même est un pas en avant. Car il dégage aussitôt ce qu’on pressent dans le public : à savoir que la psychanalyse n’est pas une thérapeutique comme les autres. Ceci veut dire que, même à se présenter comme une cure, elle ne se satisfait pas de critères naïfs, disons-le même « cliniques », pour définir son opération selon la variété des cas où elle s’applique ; qu’elle ne se distingue pas même par un choix différent des variables où se repèrent son champ et son action, mais que la vigilance jalouse que traduit la notion de variantes touchant sa voie et ses moyens est fonction si interne à son exercice qu’elle ne peut être détachée de son statut. Tout analyste considère, en effet, que ces variantes sont limitées par le respect de certaines formes techniques, hors desquelles son action sur le patient, même si elle prend appui sur les connaissances psychanalytiques, n’est plus que psychothérapie. Que l’analyste s’efforce de déduire de ces formes un formalisme dont l’observance s’impose rigoureusement, encore faut-il qu’il éprouve la valeur de chacune d’elles par une critique positive des effets propres à son opération : c’est ce que la littérature psychanalytique désigne comme la théorie des critères thérapeutiques ; ce qui s’y traite est de savoir comment agit ce que l’on fait. Cette place accordée au besoin de comprendre est un signe de qualité en un domaine aussi mouvant que celui de la guérison. L’insouciance même de l’analyste, quant aux règles les plus élémentaires de la statistique, dans les enquêtes, d’ailleurs rares, où sont produits ses « résultats », si elle ne dépasse pas, en fait, ce qui est d’usage en médecine, est, chez lui, plus justifiée. S’il fait moins de cas que quiconque en effet d’appréciations aussi sommaires qu’ « amélioré », « très amélioré », voire « guéri », c’est qu’une discipline domine sa pratique, qui lui enseigne le détachement de toute urgence thérapeutique ; c’est aussi que son expérience, dans ses données les plus larges, le prévient contre les dangers de ce que le terme de furor sanandi énonce assez pour lui. Car, s’il admet la guérison comme bénéfice de surcroît de son traitement, il en sépare si radicalement de son action l’instance qu’au seul fait qu’une initiative y prenne son motif, il réagit en son for intérieur par l’inquiétude, au for du groupe par la question préalable : savoir si l’on est encore là dans la psychanalyse. À souligner ce trait, on entend qu’il puisse paraître, en la question présente, périphérique. Mais c’est précisément sa portée, qu’il la cerne d’une ligne dont le tracé à peine visible suffit à séparer l’intérieur d’un cercle de son dehors, et qu’à être éludé par une convention tacite dans ce qui de l’intérieur du cercle se présente au dehors, il donne l’exemple de la facilité avec laquelle sont omis les principes les plus décisifs, ceux qui règnent dans le silence des vérités indiscutées. C’est ainsi que la psychanalyse se réfère, en ses critères thérapeutiques, à des concepts dont l’ordonnance en plusieurs registres, dynamique, topique, économique, laisse matière à maints débats, mais dont l’extrême élaboration ne répond qu’à son expérience. Leur compréhension exige donc cette expérience, et c’est un fait que les psychanalystes en font une objection de principe à toute critique du dehors quand elle prétend aller au fond. En d’autres termes, toute reconnaissance de la psychanalyse, comme profession et comme science, se propose sur la base d’un principe d’extraterritorialité auquel il est impossible au psychanalyste de renoncer, même s’il le dénie, mettant toute validation de ses problèmes sous le signe de la double appartenance qui les rend aussi insaisissables que la chauve-souris de la fable. Toute discussion ouverte sur une question comme la présente s’engage donc sur un malentendu, mais elle ne prend son relief qu’au contre-jour dont l’éclaire le paradoxe du dedans. II suffit, pour le faire apparaître, de s’en tenir à la lettre de ce qui s’écrit d’autorité sur les critères thérapeutiques de l’analyse : si, en effet, l’on peut alors s’accommoder du fait que l’intensité des débats croisse à mesure qu’on se rapproche du cœur de sa pratique, il s’avère plus surprenant que les oppositions y deviennent plus irréductibles à mesure même de cette proximité, et que la discussion, à devenir plus aiguisée, ne s’y achève qu’en confusion. Pour prendre une idée du degré de ce paradoxe, il suffit de se référer aux communications faites au dernier Congrès mondial des psychanalystes freudiens, réunis à Londres ; elles mériteraient d’être portées au dossier dans leur totalité, et chacune intégralement (Voir International Journal of Psycho- Analysis, 1954, n° 2 : tout le numéro). On extraira de l’une d’entre elles une appréciation mesurée (la traduction est de l’auteur du présent article) : « II y a vingt ans », écrit l’un des auteurs (op. cit., p. 95), « je fis circuler un questionnaire aux fins de rendre compte de ce qu’étaient les pratiques techniques réelles et les normes de travail des psychanalystes en ce pays (la Grande-Bretagne). J’obtins des réponses complètes de 24 sur 29 de nos membres praticiens. De l’examen desquelles, il transpira (sic) qu’il n’y avait d’accord complet que sur six des soixante-trois points soulevés. Un seul de ces six points pouvait être regardé comme fondamental, à savoir : la nécessité d’analyser le transfert ; les autres se rapportaient à des matières aussi mineures que l’inopportunité d’accepter des cadeaux, le rejet de l’usage des termes techniques dans l’analyse, l’évitement des (37812 C10 p.2)contacts sociaux, l’abstention de répondre aux questions, l’objection de principe aux conditions préalables, et, de façon assez intéressante, le paiement de toutes les séances où l’on fait défaut au rendez-vous ». Cette référence à une enquête déjà ancienne prend sa valeur de la qualité des praticiens, encore réduits à une élite, auxquels elle s’adressait. Elle n’est évoquée que pour l’urgence, devenue publique, de ce qui n’était que besoin personnel, à savoir (c’est le titre de l’article) : définir les « critères thérapeutiques de l’analyse ». L’obstacle majeur y est désigné dans des divergences théoriques fondamentales : « Nous n’avons pas besoin de regarder loin », continue-t-on, « pour trouver des sociétés psychanalytiques fendues en deux (sic) par de telles différences, avec des groupes extrêmes professant des vues mutuellement incompatibles, les sections étant maintenues dans une union malaisée par des groupes moyens, dont les membres, comme c’est le fait de tous les éclectiques de par le monde, tirent parti de leur absence d’originalité en faisant vertu de leur éclectisme, et en prétendant, de façon implicite ou explicite, que, peu important les divergences de principe, la vérité scientifique ne gît que dans le compromis. En dépit de cet effort des éclectiques pour sauver l’apparence d’un front uni devant le public scientifique et psychologique, il est évident que, sous certains aspects fondamentaux, les techniques mises en pratique par les groupes opposés sont aussi différentes que la craie du fromage » (op. cit., p. 95). Aussi bien, l’auteur cité ne se fait pas d’illusion sur la chance qu’offre le Congrès plénier, auquel il s’adresse, de réduire les discordances, et ceci faute de toute critique portant sur la « supposition affectée et entretenue avec soin que ceux qui sont en fonction de participer à un tel propos partageraient, fût-ce grossièrement, les mêmes vues, parleraient le même langage technique, suivraient des systèmes identiques de diagnostic, de pronostic et de sélection des cas, pratiqueraient, fût-ce de façon approximative, les mêmes procédés techniques. Aucune de ces prétentions ne saurait supporter un contrôle un peu serré » (les italiques sont de l’auteur, op. cit., p. 96). Comme il faudrait dix pages de cette Encyclopédie pour la seule bibliographie des articles et ouvrages où les autorités les moins contestées confirment un tel aveu, tout recours à l’assentiment commun des philosophes semble exclu pour y trouver quelque mesure en la question des variantes du traitement analytique. Le maintien des normes tombe de plus en plus dans l’orbe des besoins de cohérence du groupe, comme il s’avère en un certain pays où ce groupe représente une puissance à la mesure de l’étendue de ce pays, sans plus se justifier d’autres motifs que de la préservation d’un standard : l’avènement d’un pur formalisme se préparant partout, pour reprendre les termes de l’auteur déjà cité, d’un « perfectionnisme » technique où l’analyse, uploads/Management/ variantes-de-la-cure-type-par-jacques-lacan.pdf
Documents similaires


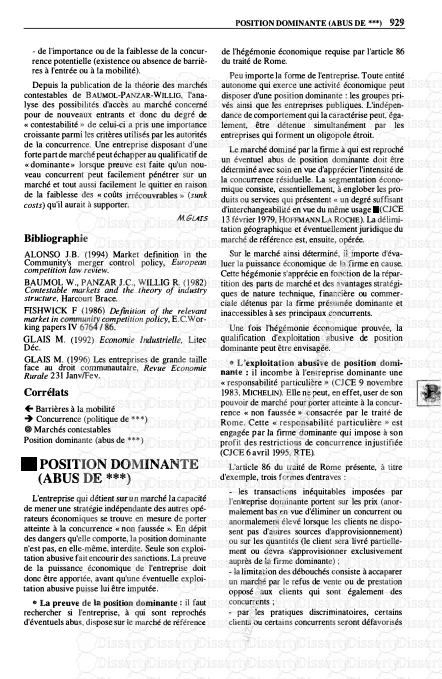







-
152
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 03, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.2615MB


