VALEUR AJOUTÉE PAR LES PARTIES PRENANTES ET CRÉATION DE VALEUR DE L'ENTREPRISE
VALEUR AJOUTÉE PAR LES PARTIES PRENANTES ET CRÉATION DE VALEUR DE L'ENTREPRISE Georges Yahchouchi Direction et Gestion | « La Revue des Sciences de Gestion » 2007/2 n°224-225 | pages 85 à 92 ISSN 1160-7742 ISBN 9782916490083 DOI 10.3917/rsg.224.0085 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2007-2-page-85.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Direction et Gestion. © Direction et Gestion. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © Direction et Gestion | Téléchargé le 21/10/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.31.190.23) © Direction et Gestion | Téléchargé le 21/10/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.31.190.23) La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 224-225 — Finance 85 Dossier Stratégie et finance mars-juin 2007 Valeur ajoutée par les parties prenantes et création de valeur de l’entreprise par Georges Yahchouchi L e modèle stakeholder de l’entreprise considère que les parties prenantes sont au centre du processus de création de valeur et que leur contribution peut servir de référence à la création de valeur pour les actionnaires (Freeman 1983; Clarkson 1995; Wheeler et Sillanpaa 1998). Nous considérerons ainsi que la valeur ajoutée par les parties prenantes (VAP), développée par Figge et Schaltegger (2000), aidera à la compré- hension des bénéfices anormaux et de la valeur boursière de l’entreprise. Cet article propose ainsi de conforter empirique- ment, à partir des modèles d’information linéaire de Feltham et Ohlson (1995), la relation entre la valeur ajoutée par les parties prenantes et la création de valeur de l’entreprise mesurée par les bénéfices anormaux et la valeur boursière. Cependant, la mesure de la valeur ajoutée par les parties prenantes suppose, dans un premier temps, la définition et le recensement des parties prenantes. Post, Preston et Sachs (2002 : 19) définissent les parties prenantes d’une entreprise comme étant les individus ou les constituantes, qui d’une façon volontaire ou involontaire, contribuent à la création de richesse de l’entreprise et à la réalisation de ses activités, et par consé- quent, sont des potentiels bénéficiaires et/ou supporteurs de risques. Cette définition est compatible avec les travaux récents de Kochan et Rubenstein (2000 : 373) qui suggèrent trois critères pour l’identification des parties prenantes: 1. elles fournissent des ressources critiques pour le succès de l’entreprise. Ces ressources peuvent inclure l’acceptation sociale de l’entreprise, the licence to operate, etc. ; 2. leur propre intérêt est directement affecté par le bien-être de l’entreprise. Autrement dit, les parties prenantes sont des preneurs de risque ; 3. elles ont un pouvoir suffisant pour influer positivement ou négativement sur la performance de l’entreprise. Georges YAHCHOUCHI Docteur ès Sciences de Gestion Université Montesquieu-Bordeaux IV (France) Professeur assistant à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban) © Direction et Gestion | Téléchargé le 21/10/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.31.190.23) © Direction et Gestion | Téléchargé le 21/10/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.31.190.23) Partant de cette définition des parties prenantes, plusieurs travaux d’ordre théorique et empirique ont tenté de démontrer la relation entre les parties prenantes et la création de valeur de l’entreprise. Certains mettent en évidence la création de valeur réciproque entre l’entreprise et ses parties prenantes. 1. Modèle de parties prenantes et création de valeur: les travaux théoriques La théorie des ressources semble être dominante quant à l’expli- cation des différences de performance entre les entreprises et du rôle primordial des parties prenantes (Itami et Roehl 1987; Grant 1991 et Mahoney et Pandian 1992). Elle part de l’hypothèse que les ressources, dont les organisations ont besoin pour se développer et initier de nouvelles stratégies, ont pour caractéris- tique d’être hétérogènes (spécifiques à chaque entreprise). Dans la mesure où les ressources octroyées par les parties prenantes procurent de l’avantage compétitif soutenable, les parties prenantes créent de la valeur. Les entreprises qui réussissent à obtenir la légitimité des parties prenantes bénéficieront de flux de ressources plus importants et seront plus aptes à créer de la valeur que celles qui maintiennent de mauvaises relations avec les parties prenantes (Jones 2001). De leur côté, Post, Preston et Sachs (2002) expliquent la relation entre les parties prenantes et la création de valeur à partir des actifs intangibles et des actifs relationnels qui représentent le goodwill de l’entreprise (savoir-faire, compétences, information, routines organisationnelles, image de marque, réputation etc.). Le tableau 1 inspiré de l’ouvrage de Jones (2001) et de Post, Preston et Sachs (2002) présente la contribution de chacune des parties prenantes dans le processus de création de valeur. Bien que la relation entre la contribution des parties prenantes et la création de valeur de l’entreprise soit évidente, les travaux empiriques recensés, ne permettent pas de la valider et ne consti- tuent pas des connaissances cumulables. La majorité de ces travaux aborde la relation indirectement à travers le concept de la responsabilité sociétale de l’entreprise. 2. Modèle de parties prenantes et création de valeur: les travaux empiriques La vérification empirique de la relation entre un management pluraliste et la création de valeur de l’entreprise a fait l’objet de plusieurs travaux dont la majorité concerne la relation entre la responsabilité sociétale de l’entreprise et la performance finan- cière. Post, Preston et Sachs (2002) concluent que 48 des 83 La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 224-225 — Finance 86 Dossier Stratégie et finance mars-juin 2007 Tableau 1. Contribution des parties prenantes dans la création de valeur de l’entreprise Parties prenantes Contribution à la création de valeur Incitation pour contribuer Investisseurs et apporteurs de fonds Capitaux; Endettement; Réduction du risque, du coût de financement ou d’emprunt Dividendes et plus values Managers Compétence pour la gestion de l’organisation Compensations monétaires: salaires, bonus, stock-options. Psychologiques: Satisfaction, pouvoir et réputation Salariés Développement d’un capital humain spéci- fique, innovation, collaboration, engagement, travail en équipe, attitudes… Salaires, bonus, emploi stable et promo- tions… Incitation, motivation et sanctions pour agir sur les performances. Syndicats Stabilité de l’emploi, résolution de conflits Stabilité de l’emploi, résolution de conflits Clients/utilisateurs Loyauté à la marque, réputation, fréquence d’achats Qualité, prix des biens et des services, estime… Fournisseurs et associés de la chaîne d’approvisionnement et de logistique Efficience, réduction des coûts, innovation technologique etc. Respect des engagements Partenaires et alliés Ressources stratégiques, conquête de marché, option de développement futur… Confiance réciproque, intérêts communs. Communauté locale, citoyens etc. Licence de travailler, légitimité etc. Prestige national, respect des institutions légales, normatives et cognitives. Gouvernement Support macroéconomique et politique Concurrence équitable et licite, règlement des impôts… Autorités réglementaires Accréditation, licence etc. Congruence ONG Légitimité et licence de travailler Respect des institutions légales, normatives et cognitives. Contribution à l’intérêt commun. © Direction et Gestion | Téléchargé le 21/10/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.31.190.23) © Direction et Gestion | Téléchargé le 21/10/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.31.190.23) études empiriques réalisées révèlent une relation positive entre les indicateurs sociaux et la performance financière. Trois études seulement montrent une relation négative; 17 autres montrent des résultats mitigés et 19 d’entre elles ne fournissent pas de résultats. Cependant, l’une des premières tentatives directes de relier la création de valeur à la valeur créée par les parties prenantes a été effectuée par Tiras, Ruf et Brown (1998). Ils étudient le lien entre la nature de la relation de l’entreprise avec ses parties prenantes (les clients, les ressources humaines, la communauté et l’environnement) et la valeur boursière de l’entreprise. Ces derniers trouvent que les entreprises qui maintiennent une bonne relation avec les parties prenantes sont plus performantes que celles ayant de mauvaises relations. L’approche de Tiras, Ruf et Brown (1998) ne s’inscrit pas dans un cadre théorique précis et manque de généralisation et d’applica- bilité dues à la définition peu opérationnelle de la valeur créée par les parties prenantes. Dans le même cadre, et en se focali- sant sur les ressources humaines, Heinfeldt et Curcio (1997) trouvent une relation entre la politique de gestion des ressources humaines et la création de valeur de l’entreprise. De leur côté, Berman, Wicks, Koha et Jones (1999) montrent qu’une attention managériale particulière, vis-à-vis des parties prenantes notamment les salariés et les clients, est associée à une performance financière plus élevée (Post, Preston et Sachs, 2002 :28). De même, Wallas (2003) tente de vérifier la présence d’une corré- lation entre un management par les parties prenantes et la création de valeur de l’entreprise pour les actionnaires. Les résul- tats montrent que la création de valeur de l’entreprise est une condition indispensable pour l’investissement de l’entreprise dans ses relations avec les parties prenantes. Les entreprises performantes sont celles qui ont une réputation solide de bonne conduite vis-à-vis des parties prenantes. A partir d’une enquête auprès des entreprises belges de produc- tion, Bughin (2004) trouve une relation uploads/Management/ valeur-ajoutee-par-les-parties-prenantes-et-creation-de-valeur-de-l-x27-entreprise-pdf.pdf
Documents similaires







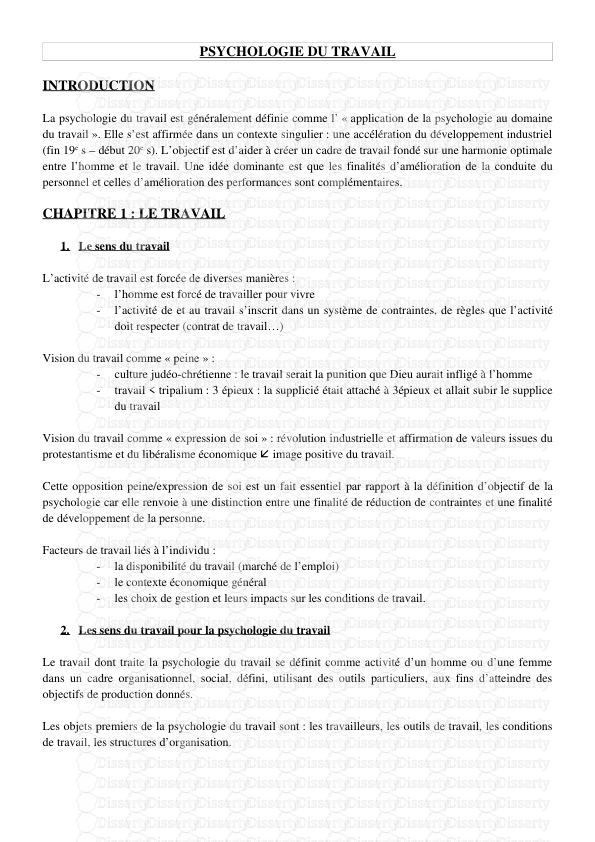


-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 28, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.6963MB


