RAPPORT D’ÉTUDE 21/11/2014 N° DRA-14-141532-06175A DRA 71 - Opération A.5 Guide
RAPPORT D’ÉTUDE 21/11/2014 N° DRA-14-141532-06175A DRA 71 - Opération A.5 Guide de mise en œuvre du principe ALARP sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Réf. : INERIS-DRA-14-141532-06175A Page 1 sur 41 DRA71 – Opération A.5 Guide de mise en œuvre du principe ALARP sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Direction des Risques Accidentels Liste des personnes ayant participé à l’étude : Yann FLAUW, Clément LENOBLE Réf. : INERIS-DRA-14-141532-06175A Page 2 sur 41 PREAMBULE Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur. La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes ou erronées. Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée. L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination de la prestation. Réf. : INERIS-DRA-14-141532-06175A Page 3 sur 41 SOMMAIRE 1. INTRODUCTION .............................................................................................. 7 1.1 Contexte ....................................................................................................... 7 1.2 Etudes préalables ......................................................................................... 9 1.3 Objectifs ....................................................................................................... 9 1.4 Organisation du guide ................................................................................ 10 2. CADRE D’UTILISATION DE LA METHODE ................................................. 11 3. PRESENTATION DE LA METHODE ............................................................. 13 3.1 Première étape ........................................................................................... 14 3.2 Deuxième étape : sélection des mesures les plus rentables ...................... 17 3.3 Troisième étape .......................................................................................... 24 3.4 Analyse des résultats ................................................................................. 26 4. CAS PRATIQUES D’UTILISATION DE LA METHODE ................................ 29 4.1 Premier cas pratique .................................................................................. 29 4.2 Second cas pratique ................................................................................... 33 5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES ........................................................... 37 6. REFERENCES ............................................................................................... 39 7. LISTE DES ANNEXES .................................................................................. 41 Réf. : INERIS-DRA-14-141532-06175A Page 5 sur 41 GLOSSAIRE ACB Analyse Coût-Bénéfice ALARP As Low As Reasonably Practicable : Aussi bas que raisonnablement praticable AM Accident Majeur DREAL Direction Régionale de l’Equipement, de l’Aménagement et du Logement. EDD Etude de Dangers G Gravité ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement IIC Inspection des Installations Classées HSL Health and Safety Laboratory (Royaume-Uni) Mi Mesure n°i MMR Mesure de Maîtrise des Risques NEN Netherlands Standardization Institute OCDE Organisation de coopération et de développement économiques P Probabilité (souvent probabilité d’occurrence annuelle) PAC Porter à Connaissance PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Organisme Néerlandais pour la Recherche Scientifique Appliquée) Réf. : INERIS-DRA-14-141532-06175A Page 7 sur 41 1. INTRODUCTION 1.1 CONTEXTE La première apparition du concept As Low As Reasonably Practicable (ALARP) dans la réglementation française moderne remonte à 1977, dans le décret d’application de la loi du 19/07/76 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ce décret, aujourd’hui abrogé, stipulait, en effet, dans son article 5 que l’étude de dangers (EDD) d’une ICPE doit « justifie[r] que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. » Le concept ALARP n’y était certes pas mentionné explicitement, mais les termes « économiquement acceptable » et « risque aussi bas que possible » le suggéraient clairement. Qu’est-ce qui est économiquement acceptable ou pas ? Comment justifier le « aussi bas que possible » ? Le décret ne le précisait pas, et la réglementation actuelle n’est pas plus explicite. Dans la réglementation française actuelle, trois principaux textes traitent de l’acceptabilité du risque pour les ICPE : l’arrêté du 10 mai 2000, la circulaire du 10 mai 2010 et l’arrêté du 29 septembre 20051. L’arrêté du 10 mai 2000 précise que « la démarche de maîtrise […] des risques accidentels […] consiste à réduire autant que possible la probabilité ou l'intensité des effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs potentiels, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation ». La circulaire du 10 mai 2010 fixe des critères permettant d’apprécier la justification par l’exploitant des installations que « le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation». Ces critères comprennent notamment « la capacité technique, organisationnelle et financière de l’exploitant à maintenir un niveau de maîtrise des risques correspondant aux éléments contenus dans l’étude de dangers ». 1Arrêté du 10/05/00 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation / Circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 / Arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. Réf. : INERIS-DRA-14-141532-06175A Page 8 sur 41 Dans ces deux textes, le concept ALARP n’est une fois encore pas explicitement mentionné, mais la problématique de réduction du risque sous contraintes techniques, organisationnelles et financières est clairement exprimée. La démarche de maîtrise des risques ne s’applique cependant pas à tous les risques d’accidents majeurs. Pour les établissements Seveso, chaque cas recensé dans l’étude de dangers doit être placé sur une grille probabilité/gravité, et se voit affecté une étiquette selon sa position dans la grille. Pour les autorisations simples, cette démarche, bien que non obligatoire, est également souvent appliquée. Les échelles de probabilité et de gravité de cette grille sont définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005, dit arrêté PCIG. Dans la grille, trois zones de risque sont distinguées : Les cases « NON », correspondant à un risque élevé, a priori inacceptable. Les cases « MMR », pour lesquelles la démarche de réduction du risque aussi bas que possible, dans des conditions économiquement acceptables, devra être effectuée. Les cases « vides », correspondant à une zone de risque faible, a priori acceptable en l’état. Les cas situés dans la première zone (« NON ») sont en principe rejetés2. L’exploitant doit réduire le risque, par la probabilité d’occurrence ou la gravité des conséquences, afin de déplacer la criticité dans une case « MMR » voire « vide ». Les accidents situés dans des cases vides sont considérés comme acceptables, tant que l’exploitant peut justifier qu’ils resteront dans ces cases. Enfin, pour les accidents majeurs situés dans des cases MMR, la circulaire exige une démarche de réduction du risque ALARP, même si le terme n’est pas utilisé. Toutefois, les conditions pratiques d’application de cette démarche restent floues, comme le montrent les extraits suivants : « Il convient de vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus. » « La " tolérabilité " du risque résulte d'une mise en balance des avantages et des inconvénients (dont les risques) liés à une situation qui sera soumise à révision régulière afin d'identifier, au fil du temps et chaque fois que cela sera possible, les moyens permettant d'aboutir à une réduction du risque. » La circulaire affiche ainsi la volonté de mettre en œuvre le principe de réduction ALARP. Elle suggère même d’employer une analyse coût bénéfice pour le faire. Par contre, il n’existe aucune méthode reconnue qui permettrait de démontrer que cette réduction a été correctement effectuée. L’INERIS a proposé en 2011 au Ministère en charge de l’écologie d’étudier le sujet, avec l’objectif de proposer un outil d’aide à la décision pertinent et adapté. Ce travail s’est appuyé essentiellement sur deux éléments : l’étude de textes et de pratiques développées dans certains pays européens ainsi que les échanges avec les parties prenantes, bureaux d’études et inspecteurs de la DREAL. 2 C’est en pratique le préfet concerné qui décide si la démarche de maîtrise des risques est acceptable. Réf. : INERIS-DRA-14-141532-06175A Page 9 sur 41 1.2 ETUDES PREALABLES En 2011, l’INERIS a réalisé une première étude intitulée « Benchmark européen relatif aux préconisations de mise en œuvre du principe ALARP » [1]. Cette étude consistait en une analyse documentaire de textes réglementaires et de guides méthodologiques dans plusieurs pays, en particulier au uploads/Management/ guide-alarp.pdf
Documents similaires





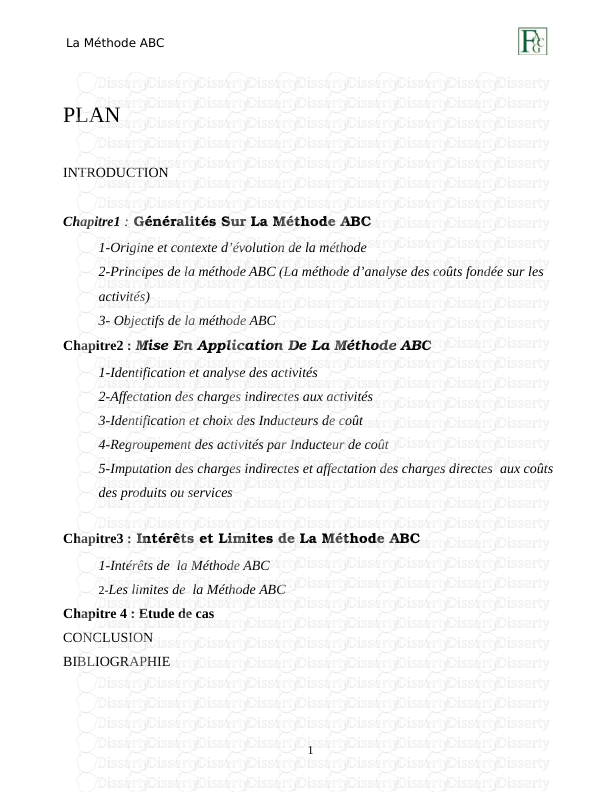




-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 21, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 5.8344MB


