DROIT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS par Yves VAN GERVEN, Anne VALLERY, David REINGEWIR
DROIT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS par Yves VAN GERVEN, Anne VALLERY, David REINGEWIRTZ Avocats, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Bruxelles et Axel DESMEDT Senior Legal Counsel Orange 1. – Introduction Le 13 juin 2005, le législateur belge a adopté la Loi relative aux communications électroniques (967). Cette Loi transpose en droit belge le nouveau cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques communautaire approuvé le 7 mars 2002 par le Conseil et le Parlement européen (968). Les Etats mem- bres avaient l’obligation de transposer ce nouveau cadre dans leur législation nationale au plus tard le 24 juillet 2003. La Belgique s’est acquittée de cette obligation avec un retard de presque un an (969). Le nouveau cadre réglementaire marque la fin de toute une évo- lution – ou peut être devrait-on dire révolution? – de la réglemen- tation du marché des télécommunications en Europe. A la fin des (967) M.B., 20 juin 2005, 28070. (968) Cf. A. De Streel et R. Queck, «Un nouveau cadre réglementaire pour les télécommu- nications électroniques en Europe», J.T. dr. Eur., 2003, 193-202. (969) Par un arrêt du 10 mars 2005 (Commission/Belgique, C-204/04), la Cour de justice des Communautés européennes («la Cour de justice») a d’ailleurs condamné la Belgique pour ne pas avoir transposé le nouveau cadre réglementaire dans le délai prescrit. 390 van gerven, vallery, desmedt et reingewirtz années 80, les marchés des télécommunications de tous les Etats membres étaient caractérisés par des monopoles détenus par des entreprises étatiques. Ces entreprises disposaient de droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture des réseaux et des services de télé- communications, ainsi que pour la commercialisation et l’entretien des terminaux de télécommunications (appareils téléphoniques, etc.). Il était interdit aux opérateurs privés de fournir ces services et de commercialiser ces équipements. La Commission européenne a réagi en adoptant au fil des années une série de directives de libé- ralisation sur la base de l’article 86(3) CE qui a progressivement supprimé les droits exclusifs ou spéciaux en matière de réseaux, de services et de terminaux de télécommunications (970). Ces démar- ches ont abouti à une libéralisation totale du marché en 1998. Le 16 septembre 2002, la Commission a remplacé cette série de direc- tives par un nouveau texte, la directive «concurrence», qui a conso- lidé le principe de la suppression de tout monopole en matière de services et de réseaux (971). Toute entreprise a par conséquent le droit de fournir des services électroniques ou de mettre en place et d’exploiter des réseaux de communications électroniques. Au cours de ce processus de libéralisation, le Parlement européen et le Conseil ont également adopté une série de directives d’harmo- nisation sur la base de l’article 95 CE qui visait à établir un marché intérieur des services de communications électroniques (972). Le nouveau cadre réglementaire communautaire a désormais remplacé ces directives, rassemblées dans un «Paquet» de quatre directives : une directive «cadre», une directive «autorisation», une directive (970) La directive 88/301/CEE de la Commission du 18 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication (J.O. du 27 mai 1988, L131, 73) et la direc- tive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (J.O. du 24 juillet 1990, L192, 10). Cette dernière a notam- ment été modifiée par la directive 94/46/CE (libéralisation des communications par satellites), la directive 96/2/CE (libéralisation des communications mobiles), directive 96/19 (libéralisation pleine des services et des réseaux de télécommunication à partir du 1 janvier 1998). (971) La directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concur- rence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, J.O. du 17 septembre 2002, L249, 21. (972) Cf. notamment la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations et les licences dans le secteur des services de télécommunications (J.O. du 7 mai 1997, L117, 15), la directive 97/33/CE du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’applica- tion des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP) (J.O. du 26 juillet 1997, L199, 32) et la directive 98/10/CE du 26 février 1998 concernant l’application d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un envi- ronnement concurrentiel (J.O. du 1er avril 1998, L101, 24). droit des télécommunications 391 «accès» et une directive «service universel» (973). En effet, la libéra- lisation du secteur et son ouverture à la concurrence ne peuvent être effectives sans mesures d’accompagnement. Il est ainsi primor- dial que l’entrée et le comportement des opérateurs sur le marché puissent être contrôlés par une autorité indépendante. La directive «cadre» contient des dispositions générales relatives aux autorités nationales réglementaires et définit leurs rôles en matière de régle- mentation. La libre entrée des opérateurs sur le marché est assurée par la directive «autorisation» qui instaure un système d’autorisa- tion générale pour tous les services et réseaux sans exiger de déci- sion expresse de l’autorité réglementaire nationale. Les droits d’uti- lisation des radiofréquences et des numéros doivent être octroyés dans le cadre de procédures objectives, transparentes, non discrimi- natoires et proportionnées. Une fois l’entrée sur le marché acquise, encore faut-il que les opérateurs puissent effectivement s’y concur- rencer. A cette fin, ils auront souvent besoin d’obtenir l’intercon- nexion aux réseaux opérés par les autres sociétés afin de pouvoir fournir leurs services au public. Or, dans ce domaine, la seule libé- ralisation des réseaux ne pouvait produire d’effets immédiats et les réseaux de communications demeuraient encore largement exploités par un petit nombre d’opérateurs en position de force. Aussi, la directive «accès» règle les rapports entre les opérateurs sur les mar- chés de gros. En 1997, le législateur avait déjà introduit dans la réglementation le concept de puissance significative sur le marché comme seuil de déclenchement pour l’imposition d’un certain nom- bre d’obligations ex ante aux entreprises détenant une puissance significative, telles que l’obligation de non-discrimination en ce qui concerne l’interconnexion offerte aux autres opérateurs et l’obliga- tion d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts (974). Le nouveau cadre réglementaire a considérablement modifié ce dispo- sitif afin de tenir compte de l’évolution des marchés devenus plus (973) Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), J.O. du 24 avril 2002, L108, 33, directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), J.O. du 24 avril 2002, L108, 21, directive 2002/19/CE du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électro- niques et aux ressources associées ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), J.O. du 24 avril 2002, L108, 7 et directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), J.O. du 24 avril 2002, L108, 51. (974) Cf. directive 97/33/CE précitée. 392 van gerven, vallery, desmedt et reingewirtz dynamiques et concurrentiels. Il vise également à réduire progressi- vement la réglementation ex ante au fur et à mesure que la concur- rence s’intensifie sur le marché. A l’avenir, les obligations réglemen- taires ex ante ne pourront être imposées que si le marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel. Les notions de «marché pertinent» et de «position dominante» connues en droit de concur- rence sont désormais employées dans l’analyse des marchés de télé- communications pour déterminer si un marché de gros (régulé par la directive «accès») ou un marché de détail (régulé par la directive «service universel») est effectivement concurrentiel. A terme, cette nouvelle approche devrait aboutir à une large déréglementation du secteur des télécommunications. Les mesures garantissant les prestations de service universel demeurent d’autant plus fondamentales dans un secteur libéralisé et dérégulé. Tous les citoyens doivent pouvoir avoir accès aux services de base de la téléphonie ainsi qu’aux autres moyens de communi- cation (975). Aussi longtemps que le marché n’était pas ouvert à la concurrence, les services de base de télécommunications étaient naturellement assurés par l’entreprise publique, opérateur histori- que (en Belgique la R.T.T., puis Belgacom S.A.). L’introduction de la concurrence en tant que mécanisme régulateur de la fourniture de services de télécommunications risquait de réduire la disponibilité et la qualité des services de base de télécommunications. Par exemple, un opérateur privé n’est pas prêt à fournir des services à des abon- nés non rentables, tels que ceux habitant dans des zones rurales. De même, les opérateurs commerciaux peuvent être amenés à appliquer des niveaux de tarifs trop élevés pour les moyens des ménages à fai- ble revenu. C’est pourquoi, le législateur européen a défini dans les années 90 et dans la directive «service universel», un ensemble mini- mal de services de télécommunications de base de qualité qui sur l’ensemble du territoire des Etats membres doit être mis à la dispo- sition des utilisateurs à un prix abordable, quelle que soit la renta- bilité de ces services uploads/Management/ droits-des-telecommunications.pdf
Documents similaires









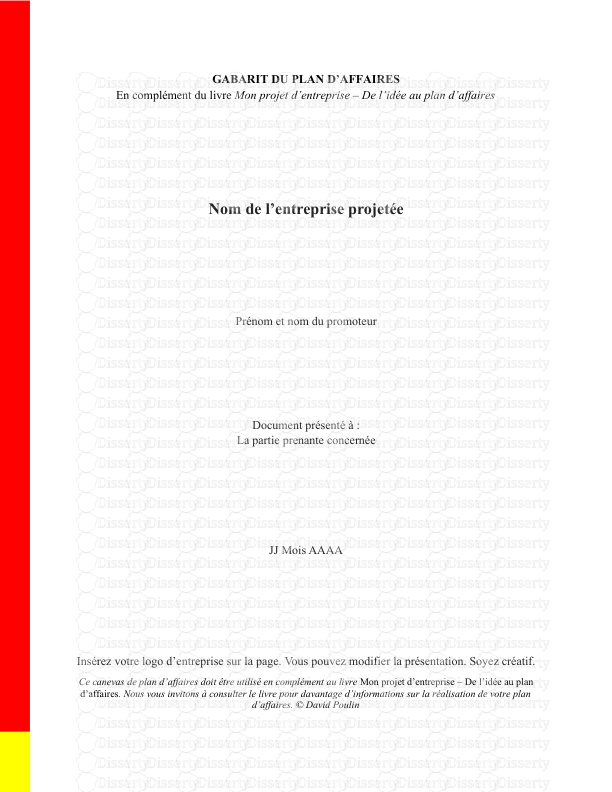
-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 26, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.2828MB


