54EEL6LM - ANCIEN FRANÇAIS – Gr. 1 (A. PAUPERT) FICHE DE VOCABULAIRE : LES DÉNO
54EEL6LM - ANCIEN FRANÇAIS – Gr. 1 (A. PAUPERT) FICHE DE VOCABULAIRE : LES DÉNOMINATIONS DE LA FEMME EN ANCIEN FRANÇAIS (exemples dans Erec et Enide, v. 1-2920) Les principales dénominations relevant de ce champ sémantique sont : femme – dame – dameisele – pucele – meschine – moillier (non représenté dans le corpus). 1. Femme / fame Il englobe tous les autres. C’est avant tout un terme générique. . Etymon : < latin femina, « la femelle » de n’importe quel animal. En latin vulgaire, femina a remplacé le mot mulier qui signifiait « la personne de sexe féminin » en général. (On peut noter que dans l’histoire de la langue, le vocabulaire appliqué à la femme prend souvent des connotations péjoratives). . Valeurs et emplois en ancien français : a) Le plus souvent, le mot a une valeur très générale : « l’individu de sexe féminin ». Il s’oppose alors à homme. On trouve de nombreux exemples où le mot ne désigne pas un individu particulier, mais les femmes en général. C’est notamment le cas dans les maximes, proverbes, affirmations présentées comme des vérités générales. Ex. v. 1018 : « Grant vilté est de ferir fame ! ». b) Il peut désigner aussi une personne déterminée. C’est un mot qui apparaît comme neutre, non marqué sur le plan social. Cependant, lorsque l’on veut spécifier qu’il s’agit d’une femme appartenant à un haut rang social, on l’accompagne généralement d’un qualificatif approprié (franche = « noble », noble, curteise…) c) Il est enfin utilisé pour désigner l’épouse, quelle que soit sa condition sociale, notamment dans des expressions comme « prendre (a) femme » (« se marier, épouser ») ou « avoir (a, por) femme » (« être marié »). Ex. v. 397 : « Li vavasors sa fame apele » ; v. 1321 : "La la voudrai a fame prendre" (Erec au vavasseur, lorsqu'il lui annonce qu'il veut emmener sa fille à la cour d'Arthur pour l'épouser) ; « Erec s’en va, sa fame en moinne », v. 2762. Avec cette valeur, femme a supplanté peu à peu moillier, qui à l’origine, en ancien français, désignait l’épouse. [NOTE : Femme / moillier / oissour / espouse Moillier n’est pas attesté dans notre texte. Il est issu du latin mulier, qui à l’origine (voir ci-dessus) désignait un individu de sexe féminin. Mais il s’est produit dès le latin une série de glissements. Dans un premier temps, le système était le suivant : . femina « la femelle » . mulier « la femme » en général . uxor « l’épouse » Il devient ensuite : . Femina « la femme » . mulier et uxor « l’épouse » Sont passés en ancien français : . femme « la femme » de façon générale / « l’épouse » . moillier « l’épouse » (désigne toujours l’épouse légitime – au sens juridique ; s’oppose à soignant , « la concubine » ou « la maîtresse », terme dépréciatif). . oissour, « l’épouse » ; n’apparaît que très peu, dans les textes les plus anciens. Il a ensuite été supplanté par moillier (puis par femme et par espouse). Espouse : est issu du latin sponsa, part. passé du verbe spondo, –ere, « promettre », « prendre un engagement solennel », de caractère religieux ; sponsa désigne d’abord « la promise », c-à-d. la fiancée. On a eu pour ce mot un changement de sens, de « fiancée » à « épouse » (changement lié à un fait de vie familiale et sociale / religieuse – les fiançailles étaient dans la société chrétienne primitive un engagement officiel, qui créait une obligation).] 2. Dame . Au contraire de femina, l’étymon de dame, domina, avait, lui, une valeur précise : il désignait l’épouse du dominus, c-à-d. du « maître » - donc, « la maîtresse du domaine » (éventuellement, « la souveraine »). . Valeurs en ancien français Le mot a plusieurs emplois, mais sa valeur d’origine reste toujours sensible. a) Dame désigne la maîtresse, la suzeraine, en conservant le sème d’autorité essentiel dans l’étymon. C’est l’équivalent exact du masculin sire/seigneur. Ex. v. 401, la dame désigne la femme du vavasseur ; v. 746, « li sire et la dame » (elle est la femme du seigneur), v. 1017, v. 1030... Le mot désigne fréquemment la reine, utilisé notamment comme terme d'adresse (v. 1114, 1120, 1139 etc...) ; parfois avec le possessif, marquant la soumission respectueuse (Erec parlant de la reine, "je vuil que ma dame l'atort", v. 1346 ; s'adressant à la reine : "ma douce dame", v. 1575). Erec l'utilise de la même manière pour désigner sa future belle-mère, chérie et respectée pour sa noblesse (même si son rang social n'est pas très élevé) : "vostre fame / qui est la moie chiere dame" (v. 1342). . le terme a été transposé dans le langage amoureux pour désigner la femme aimée ; la dame est « la suzeraine », celle qui a tout pouvoir sur son « vassal » qui la sert (métaphore féodale). Il a d’abord été employé dans la poésie des troubadours (en langue d’oc), puis en langue d’oïl, dans le Nord, dans la poésie et le roman dits « courtois ». . le terme a pu également être transposé dans le langage religieux : Nostre Dame désigne la Vierge Marie (de la même manière que Nostre Sire / Nostre Seigneur désigne Dieu, plus précisément le Christ, Dieu incarné). b) La notion d’autorité peut passer au second plan. Le sème essentiel est alors celui de « noblesse », de « haut rang social ». . Dame a une nuance aristocratique. Dans les romans courtois, il désigne le plus souvent un personnage d’un rang élevé dans la hiérarchie féodale (la reine, par exemple) ; ou des femmes dont l’origine et le caractère noble sont soulignés : ainsi, les « dames et puceles » des v. 33 sq. . Dame désigne le plus souvent des femmes nobles mariées, par opposition à pucele ou a dameisele : v. 2104, Enide est « dame novele » au matin de ses noces (mais voir aussi, plus loin, à pucele, le sens plus précis : jeune femme qui n’est plus vierge) ; v. 2804, le chevalier voleur hésite sur la qualité de la jeune femme (« Ne sai s’ele est dame ou pucele »). Cependant le sème « mariée » n’est pas obligatoire. L’appellation de « dame » peut désigner une jeune fille noble (par politesse). . Dame désigne enfin celles qui accompagnent une personne de la haute noblesse – les « dames de compagnie » ou suivantes ; elles appartiennent elles aussi à la noblesse (tenir compagnie à la reine est une fonction honorifique, réservée à des femmes de haut rang – les femmes ou amies des seigneurs et chevaliers qui constituent l’entourage du roi). Dans Erec et Enide, ce sont plutôt des « demoiselles de compagnie » (voir plus loin, pucele). 3. Pucele, dameisele, meschine Les trois termes ont un trait commun : le célibat (ce qui les oppose à dame). Ils impliquent le plus souvent aussi une notion de jeunesse. Mais il existe aussi quelques différences entre eux. 3.1 Pucele . Etymon : latin impérial *pullicella, « jeune fille ». Il s’agit d’un diminutif formé soit sur puella (« jeune fille »), soit sur pulla (« petit d’un animal ») – les étymologistes ne sont pas d’accord. . En ancien français, pucele désigne une jeune fille non mariée, sans précision rigoureuse quant à l’âge, et surtout, sans indication d’ordre social. C’est un terme neutre, qui peut s’appliquer aussi bien à une jeune fille noble qu’à une roturière. Dans la partie du texte étudiée, elles sont le plus souvent nobles (v. 33, 47…). Enide est d'abord désignée de cette façon : "la pucele" (v. 411), "la bele pucele" (v. 755)... Quand le substantif est accompagné d’un possessif, il désigne une suivante (une jeune fille noble), v. 127(« sa pucele » : la demoiselle de compagnie de la Reine) ; ou l'amie du chevalier (v. 151, 153, 158) ou d'Erec (v. 748). Il peut se charger d'une valeur affective : Erec à la reine, "je vos amain / Ici ma pucele et m'amie..." (v. 1551 ; les deux termes apparaissent ici comme quasiment synonymes, avec sans doute une gradation dans le degré de proximité affective). Remarque : en ancien français, le trait « virginité », qui va devenir prépondérant par la suite, n’est pas dominant (même s’il est parfois présent). Voir les dérivés « pucelage » (rare avant le XIIIe siècle) et « dépuceler ». On le trouve ici à propos de la nuit de noces d'Enide : "Ainçois que ele se levast, / Ot perdu le nom de pucele ; Au matin fu dame novele..." (v. 2102-2104, avec l'opposition déjà signalée entre pucele et dame). 3.2. Dameisele . Etymon : *dominicella, diminutif de domina. . En ancien français, à la différence de pucele, dameisele est un terme très marqué : c’est une personne non mariée et obligatoirement uploads/Litterature/ td-gr-1-vocabulaire-femme.pdf
Documents similaires






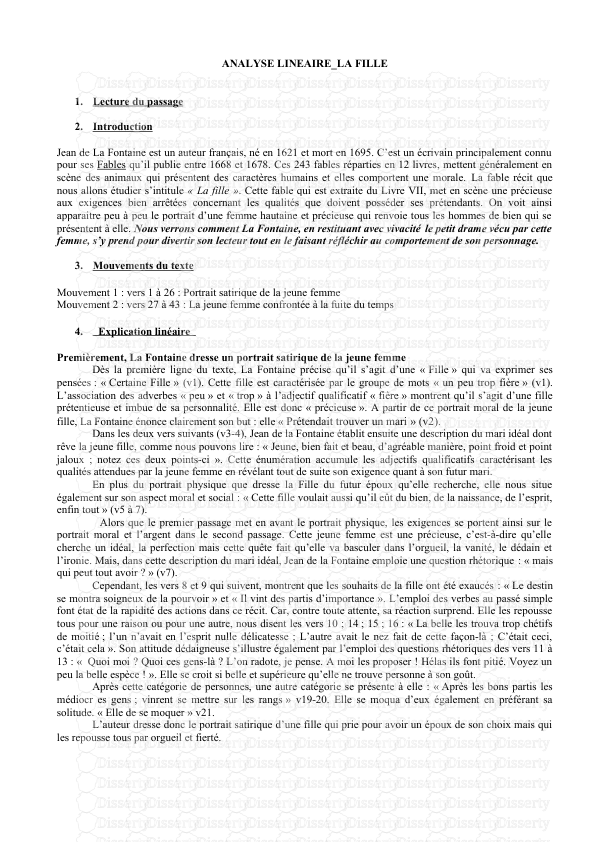



-
46
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 15, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1081MB


