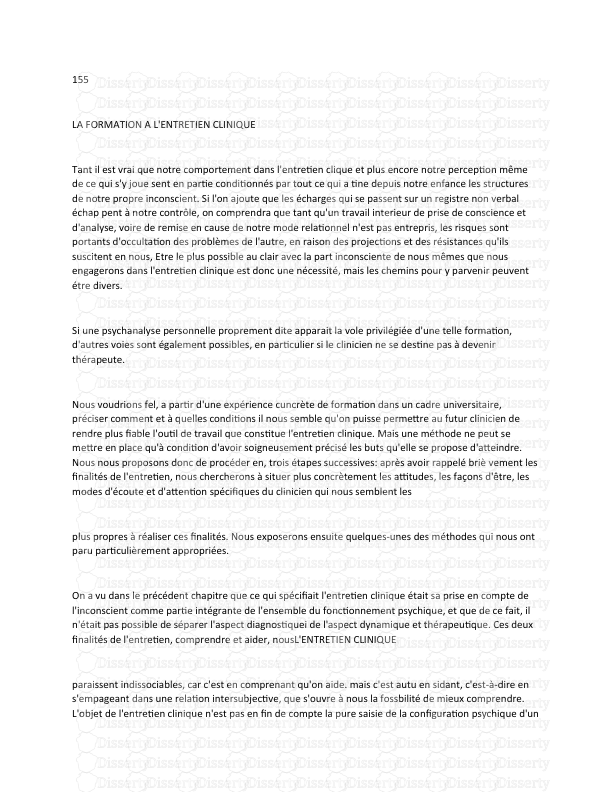155 LA FORMATION A L'ENTRETIEN CLINIQUE Tant il est vrai que notre comportement
155 LA FORMATION A L'ENTRETIEN CLINIQUE Tant il est vrai que notre comportement dans l'entretien clique et plus encore notre perception même de ce qui s'y joue sent en partie conditionnés par tout ce qui a tine depuis notre enfance les structures de notre propre inconscient. Si l'on ajoute que les écharges qui se passent sur un registre non verbal échap pent à notre contrôle, on comprendra que tant qu'un travail interieur de prise de conscience et d'analyse, voire de remise en cause de notre mode relationnel n'est pas entrepris, les risques sont portants d'occultation des problèmes de l'autre, en raison des projections et des résistances qu'ils suscitent en nous, Etre le plus possible au clair avec la part inconsciente de nous mêmes que nous engagerons dans l'entretien clinique est donc une nécessité, mais les chemins pour y parvenir peuvent étre divers. Si une psychanalyse personnelle proprement dite apparait la vole privilégiée d'une telle formation, d'autres voies sont également possibles, en particulier si le clinicien ne se destine pas à devenir thérapeute. Nous voudrions fel, a partir d'une expérience cuncrète de formation dans un cadre universitaire, préciser comment et à quelles conditions il nous semble qu'on puisse permettre au futur clinicien de rendre plus fiable l'outil de travail que constitue l'entretien clinique. Mais une méthode ne peut se mettre en place qu'à condition d'avoir soigneusement précisé les buts qu'elle se propose d'atteindre. Nous nous proposons donc de procéder en, trois étapes successives: après avoir rappelé briè vement les finalités de l'entretien, nous chercherons à situer plus concrètement les attitudes, les façons d'être, les modes d'écoute et d'attention spécifiques du clinicien qui nous semblent les plus propres à réaliser ces finalités. Nous exposerons ensuite quelques-unes des méthodes qui nous ont paru particulièrement appropriées. On a vu dans le précédent chapitre que ce qui spécifiait l'entretien clinique était sa prise en compte de l'inconscient comme partie intégrante de l'ensemble du fonctionnement psychique, et que de ce fait, il n'était pas possible de séparer l'aspect diagnostiquei de l'aspect dynamique et thérapeutique. Ces deux finalités de l'entretien, comprendre et aider, nousL'ENTRETIEN CLINIQUE paraissent indissociables, car c'est en comprenant qu'on aide. mais c'est autu en sidant, c'est-à-dire en s'empageant dans une relation intersubjective, que s'ouvre à nous la fossbilité de mieux comprendre. L'objet de l'entretien clinique n'est pas en fin de compte la pure saisie de la configuration psychique d'un sujet observé de l'extérieur. Ce n'est qu'à partir de son interrelation avec le consultant que le clinicien peut découvrir quelque chose de l'organisation dynamique interne de l'autre, à condition de ne pas oublier qu'il est partie prenante de ce qu'il observe, et se trouve de ce fait à l'intérieur et à l'extérieur de cette inter relation Doit être pris en compte-cout autant ce qui vient de consul tant, sa demande, les circonstances qui l'ont mené à l'entretien, son milieu socio-culturel, son histoire, etc, que ce qui vient du clinicien, désir de celui-ci, ss capacité d'identification et de distance, ses références à sa pratique et son savoir, son Méo- logie, son propre passé infantile, etc. Le cadre même dans lequel, se déroule l'entretien a son importance: cadre matériel (les locaux, la disposition des sièges et du bureau), mais aussi le cadre fantasmatique réverbéré par l'image que le groupe social se fait du clinicien et de celui qui le consulte, et éventuellement de l'institution (école, hôpital psychiatrique, dispensaire, etc.) où a lieu l'entretien. Le clinicien devra donc être à même de discerner l'impact de ce cadre matériel et fantasmatique de l'entretien et d'acquérir un certain nombre d'attitudes psychiques de nature à faciliter la communication avec le consultant. Ce qui facilite, chez le clinicien, le déroulement satisfaisant de l'entretien clinique, pourrait être regroupé selon deux direc tions opposées: - la prise de conscience et le dépassement de ce qui risque de faire obstacle à la communicaiton; - le développement d'aptitudes spécifiques au type de relations intersubjectives qui y sont engagées. Le clinicien se doit tout d'abord d'être au clair avec son désir et sa demande propre, face au désir et à la demande du patient. Le désir d'être psychologue n'est jamais innocent, et il est essentiel de prendre conscience des désirs refoulés ouLA FORMATION A L'ENTRETIEN CLINIQUE sublinés qui ont pu être à Forigine de ses motivations profes sionnelles, at qui risquent de gauchir à son lasu sa perception de l'autre. Au cours de travail en petit groupe dont nous decri Fons plus loin les modalités, la prise de conscience de ces ma vations sous jacentes constitue une part importante du travai de formation. En regard d'attitudes différentes d'autres membres du groupe, tel étudiant découvre l'importance de sa curiosité quelque peu voyeurhte. A propos d'un questionnement parti culièrement insistant, tel autre prendra conscience de son besoin de maîtriser constamment la situation à travers un zèle excesc à ne rien laser échapper ou une propension à proposer d'emblée des solutions aux difficultés exprimées. D'autres encore refusent d'accepter toute situation d'impuissance, ou vivent le silence du consultant comme une mise en échec de leurs propres caps- cités d'aide. D'autres enfin découvriront leur besoin de répara tion, de caractère souvent projectif, dans leurs difficultés à recon- naltre ou accepter, par exemple, les aspects ambivalents ou agres- ifs de parents vis-à-vis de leur enfant. Par ailleurs, le désir de comprendre sol-même vient souvent infiltrer le désir de compren dre l'autre, le clinicien cherchant à son insu à élucider à travers le patient les difficultés liées à son histoire passée. Aussi le clinicien aura-t- à découvrir qu'il met en jeu à son insu dans ses modes relationnels, un certain nombre de défenses, d'évitements, d'angolises liés aux avatars de son histoire person nelle. Il risque aussi de méconnaitre les obstacles à la communi- cation qui peuvent résulter de son appartenance socio-culturalls. de ses idéologies politiques ou religieuses, du groupe professionnal dont il fait partie ou de ses positions théoriques. Lors du travail en petit groupe, à partir de cas concrets, il est fréquent que cette appartenance se révèle, soit à travers le langage utilisé par l'étu diant, soit à travers son incidence sur la façon de mener l'entre- tlen. Par exemple, cette étudiante très féministe souhaitait à tout prix Imposer l'avortement à une adolescente enceinte sans tenir compte au préalable du désir de cette dernière. Tel autre étudiant utilisera une terminologie psychologique, voire psycha- nalytique que le consultant ne peut comprendre, créant de ce fait une distanciation Infranchissable, et trouvant inconsciem- ment une réassurance à son pouvoir. Quant aux aptitudes spécifiques qui doivent être développéesL'ENTRETIEN CLINIQUE chez le psychologue, on pourrait se référer à celles que Winnicott.. considère comme essentielles au clinicien, et qui s'articulent, du reste entre elles: la possibilité de s'identifier au patient, la capacité de garder la bonne distance. la jasse maltrise des interventions. L'aptitude à s'identifier à l'autre, à le percevoir de l'intérieur, à so metire dans sa peau, à ressentir en sol ce qu'il exprime non seulement à travers son dire, mais à travers sa minique et la gestuelle de son corps, est la vole élective d'une communication qui prenne en compte le contenu latents de l'expression emani- festes. Comme nous le verrons plus loin, l'entretien se déroule de façon tout à fait différente, en fonction de la perception plus ou moins grande du vécu de l'autre. Mais cette peut être aussi excessive, ne permet- tant phus uns juste appréciation de la situation relationnelle. Certains étudiants se disent génés, voire culpabilisés de leur position de psychologue et on les voit s'efforcer dans leurs entre- tiens de se mettre sur le même plan que le consultant et d'effacer au maximum la différence due à leur fonction. Ils ne perçoivent pas qu'ils oblitèrent ainsi toute projection transférentielle et se privent d'informations essentielles à la compréhension de l'autre. Etre trop près, ou immergé sol-même dans la problématique de l'autre, présente autant d'inconvénients que d'être trop loin, et, comme nous l'avons déjà souligné, l'identification, surtout lorsqu'elle est inconsciente, peut devenir un obstacle à la commu- nication. Lorsque le problème de l'autre éveille chez le psycho- logue trop de résonances parce qu'il fait resurgir des émois dés un problème semblable mal maltrisé, il peut arriver que celui- ci s'en trouve paralysé. Ainsi cette étudiante, elle-même enfant adoptée, qui ne pouvalt supporter le vécu agressif d'une jeune mère vis-à-vis de son bébé et s'avouait de ce falt dans l'incapacité d'établir une bonne relation avec elle dans l'entretien. Même lorsqu'il s'agit d'un entretien sans visée thérapeutique, - dans lequel pas conséquent le clinicien sera particulièrement sobre de toute interprétation, il Intervient cependant, qu'il le veuille ou non, par sa seule présence et même par son silence. Une attitude non-directive de bon aloi est dans l'ensemble favora125 LA FORMATION A L'ENTRETIEN CLINIQUE be & Youte et à la communication, mais ceci n'implique pas que fabience d'intervention sols toujours souhaitable. Il arriv que des consultants fulent leurs véritables questions destr un discours prolis qu'il est alors utile d'interrompre par une remarque qui pointe un détail significatif. Le discours en effet A'est pas toujours parole. Mais une attitude trop uploads/Litterature/ smida-2.pdf
Documents similaires










-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 29, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0661MB