Annales. Économies, Sociétés, Civilisations Les métamorphoses de la Cité de Die
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations Les métamorphoses de la Cité de Dieu Lucien Febvre Citer ce document / Cite this document : Febvre Lucien. Les métamorphoses de la Cité de Dieu. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 9ᵉ année, N. 3, 1954. pp. 371-374. doi : 10.3406/ahess.1954.2299 http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1954_num_9_3_2299 Document généré le 15/10/2015 LES MÉTAMORPHOSES DE LA CITÉ DE DIEU1 C'est un livre fort, ce livre cI'Ëtienne Gilson. Il est inutile de dire que les Annales ne l'ont pas reçu. Admirable sagesse des éditeurs : ne placer leurs produits que chez les acheteurs connus d'avance : « Les Métamorphoses traitent de l'évolution d'une certaine conception chrétienne de l'Univers social. Donc, travaillons à les faire connaître, et acheter, par ceux... dont on est sûr d'avance qu'ils les achèteront. Mais les faire connaître, et acheter, des lecteurs d'une Revue -d'histoire, les Annales, dont l'audience est véritablement universelle, vous voulez rire ? Ce serait gâcher de la marchandise. Et au prix où elle est ! » Ainsi nos Harpagons libraires. Donc, c'est un livre fort. D'une belle et cohérente tenue. Faut-il dire : « encore qu'il n'ait pas été conçu comme livre », mais professé comme cours, à Louvain, en 1952 du haut de la chaire Cardinal-Mercier ? Ce ne serait pas la première fois qu'un cours, dans sa liberté plus grande, permettrait mieux à un savant de s'exprimer, d'oser dégager les maîtresses lignes d'un immense - sujet — et même de traiter une grande question qui n'est pas, à proprement parler, une question pour érudits classiques : cela, avec une liberté, une ampleur que ne limite pas le souci de faire complet, ou de ne rien risquer sans être couvert par un texte précis. Ici le sujet est d'importance. Etienne Gilson, parlant devant les Louva- nistes et dans la chaire au nom illustre que nous venons de dire — Etienne Gilson insiste surtout sur l'une de ses significations. Il pose, dit-il, une question aux théologiens. La notion de Chrétienté a toute une histoire. Mais elle ne semble pas avoir retenu l'attention des docteurs. On peut l'écrire par exemple (p. vin) sans se référer à saint Thomas d'Aquin, ni, avant lui, à saint Bona- venture, ni après lui à Duns Scot. Qui par contre ont traité de la notion d'Église en théologiens. Et précisément, du point de vue auquel se place Etienne Gilson, il y a problème. La Chrétienté ou, si l'on veut, la Res publica fidelium dont parlait Roger Bacon — la notion d'un peuple que formeraient les Chrétiens dispersés de par le monde et sur les rapports temporels de qui l'appartenance à une même Église ne serait pas sans influer — cette Chrétienté n'est-elle qu'une illusion? — Ou bien arrivons-nous au moment où sa réalité doit être reconnue, décrite, intégrée dans la notion d'Église? — Fils docile de cette Église et acceptant d'avance le verdict de ses docteurs (p. ix), Etienne Gilson se défend d'apporter une solution personnelle au débat qu'il espère voir s'ouvrir. — Mais sur un point, il est catégorique. « Même si les théologiens devaient conclure qu'il n'existe pas de vraie 1. Louvain, Publications Universitaires ; et Paris, Vrin, 1952 ; in-16°, 292 pages. 372 ANNALES1, Chrétienté, nous pourrions les assurer qu'il en existe beaucoup de fausses. » - Parodies de cette Cité de Dieu, que les membres de la Cité terrestre ont voulu « temporaliser » ; expériences coûteuses « dont les deux ordres en cause font inévitablement les frais». * * Cela dit, et quel que soit l'avis que formuleront, ou ne formuleront pas, nos Maîtres, Magistři Nostri, les théologiens de Louvain, de Rome et d'ailleurs, il est évident que le livre d'Etienne Gilson a de quoi intéresser les historiens. L'auteur ne l'ignore point, qui n'a garde de négliger personnellement ce public, même si (comme tout philosophe qui se respecte, mais qui respecte moins ses voisins?) il le définit en termes qui impliquent, avec quelque dédain, un certain retard dans l'information.... — « Assurément, dit en effet Etienne Gilson (p. 2), de par sa nature même ( ?) l'histoire ne fait que raconter le passé.... » Nous voilà bien remis à notre place ! Ainsi, nous « racontons ».... Huyzinga décrivant V Automne du moyen âge, raconte. Pauvre Huyzingaqui ne se savait pas si proche parent de M. de Barante.... — Marc Bloch, analysant les ressorts et les transformations de la Société féodale, raconte. — Georges Lefebvre, reconstituant dans ses causes, son allure et ses . conséquences la Grande Peur de 89, raconte. — Fernand Braudel, méditant pendant quinze ans sur la Méditerranée au temps de Philippe II, raconte. — Et Marcel Bataillon bâtissant ce monument : Érasme en Espagne. Non moins qu'Ernest Labrousse reconstituant le climat économique en quoi prit naissance la Révolution. Sans parler de Charles Morazé, écrivant le tome I de sa Civilisation ď Occident. — Je pourrais continuer ainsi longtemps, et sans citer, comme on voit, de trop négligeables rapsodies.... Mais quoi ? ces hommes, dont l'œuvre nous nourrit et nous exalte — ces hommes, au terme de la définition imprévue (encore que dictée « par la nature ») alléguée par Gilson — ces hommes ne seraient donc pas des historiens? L'historien, le grand, le véritable historien serait ainsi feu M. Lenôtre ? Qui racontait, racontait, racontait.... Étrange vue de l'esprit. Mais si un philosophe de la taille de Gilson entretient en lui et chez ses lecteurs de pareilles confusions — quïon juge de ce que peuvent dire et de ce que ne se privent pas d'écrire des philosophes de moindre renom? Passons. Aussi bien, ce petit paragraphe méprisant (on a noté l'inévitable ne ... que) n'est-il là que pour nous avertir que les historiens n'ont pas le pouvoir, avec leur histoire, de régler la question qui passionne, à bon droit, Etienne Gilson. D'accord 1 J'ai pour ma part coutume de dire cela en deux mots : « L'historien, tout au plus, prédit le passé. » — Quand il veut prédire l'avenir, eh bien ! (oh ! ! j'ai écrit eh bien ! et je ne m'exprime pas dans le langage du Père Duchesne !) il est logé à la même enseigne que ses camarades les philosophes. Voire même que les eminences théologiques. Il cesse d'être un savant. Il n'est plus qu'un homme qui se veut intelligent. Qui peut l'être, et même beaucoup. Qui peut aussi l'être fort peu. Mais je ne vois pas de discipline scientifique actuellement constituée qui, « de par sa nature même », comme dit Gilson, ait pour mission de prédire l'avenir. LES MÉTAMORPHOSES DE LA CITÉ DE DIEU 373 - Chose curieuse : dans le courant de ce livre qui est — je n'écrirai pas, pour ma part, qui riest que — un livre d'histoire intellectuelle — notre auteur se réfère perpétuellement à cette méprisable Histoire exécutée page 2. L'histoire des historiens, par opposition à l'histoire des philosophes. Même quand ils violent « la nature » en ne racontant pas : tel Fustel de Coulanges dont Gilson cite (p. 4) la fameuse définition de l'histoire : « Son véritable objet d'étude est l'âme humaine ; elle doit aspirer à connaître ce que cette âme a cru, a pensé, a senti aux différents âges de la vie du genre humain. » — Et, de ce point de vue, la religion est une des manifestations les plus caractéristiques de ce que les hommes ont cru, pensé, senti aux divers âges de leur vie collective. Inutile de déclarer, après mon Rabelais, que j'y souscris! A condition de ne pas restreindre au monde antique cette constatation. Elle vaut pour tous les âges. Et, du nôtre, pour ceux-là mêmes des hommes qui se professent dégagés des prises d'une religion. *** Donc, on part de la Cité de Dieu de saint Augustin. De cet idéal d'une société des enfants de Dieu qu'unissent à Lui et entre eux les liens de la foi, de l'espérance et de la charité. Et descendant le cours des temps, on épuise la série des tentatives, de plus en plus éloignées de la pensée augustinienne, que des hommes de talent, et parfois de génie, risquent pour faire descendre la Cité du ciel sur la terre et pour la réaliser, sur cette terre même, en vue de l'homme et par ses propres moyens. Successivement, on s'arrête auprès du franciscain Roger Bacon, inventeur de la Res publica fidelium et dont Gilson nous dit que «jamais personne ne conçut un idéal temporel qui fût plus complètement chrétien ».... On fait halte auprès du Dante de ce De Monar- chia qui fournit la première formule moderne d'une société temporelle unique groupant le genre humain tout entier. — On rend hommage à Nicolas de Gués apportant à ses contemporains, en 1454, le message de son De Pace fidei : les religions sont des facteurs de division ; la Religion doit être un facteur d'unification ; il faut donc qu'il n'y ait qu'une seule religion — et cette religion ne peut être (mais moyennant certains aménagements) que la religion catholique, apostolique et romaine. Après quoi on s'arrête un uploads/Litterature/ les-metamorphoses-de-la-cite-de-dieu-pdf.pdf
Documents similaires

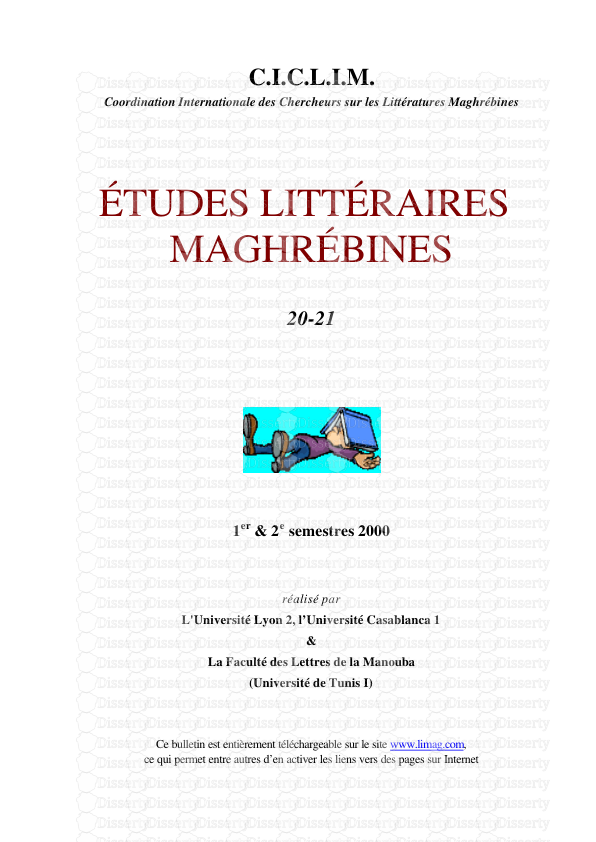








-
85
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 11, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4889MB


