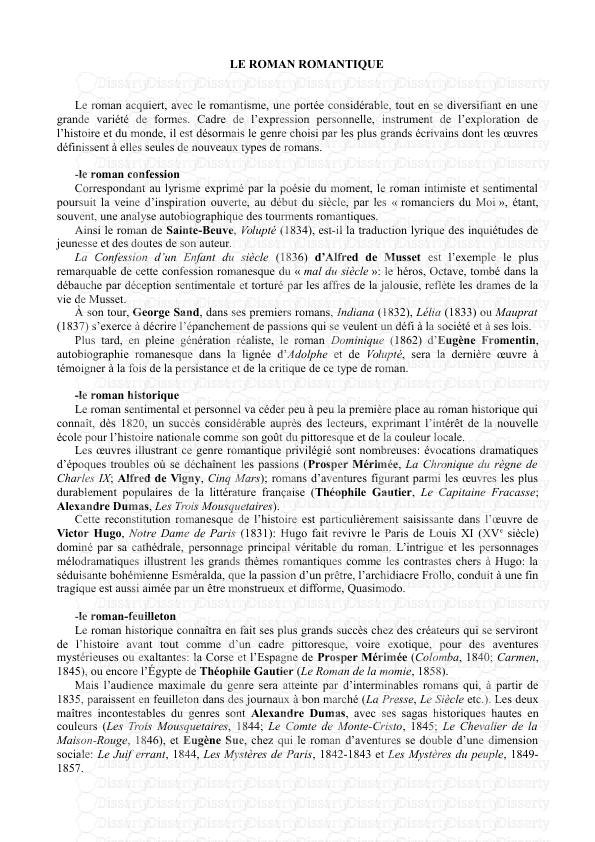LE ROMAN ROMANTIQUE Le roman acquiert, avec le romantisme, une portée considéra
LE ROMAN ROMANTIQUE Le roman acquiert, avec le romantisme, une portée considérable, tout en se diversifiant en une grande variété de formes. Cadre de l’expression personnelle, instrument de l’exploration de l’histoire et du monde, il est désormais le genre choisi par les plus grands écrivains dont les œuvres définissent à elles seules de nouveaux types de romans. -le roman confession Correspondant au lyrisme exprimé par la poésie du moment, le roman intimiste et sentimental poursuit la veine d’inspiration ouverte, au début du siècle, par les « romanciers du Moi », étant, souvent, une analyse autobiographique des tourments romantiques. Ainsi le roman de Sainte-Beuve, Volupté (1834), est-il la traduction lyrique des inquiétudes de jeunesse et des doutes de son auteur. La Confession d’un Enfant du siècle (1836) d’Alfred de Musset est l’exemple le plus remarquable de cette confession romanesque du « mal du siècle »: le héros, Octave, tombé dans la débauche par déception sentimentale et torturé par les affres de la jalousie, reflète les drames de la vie de Musset. À son tour, George Sand, dans ses premiers romans, Indiana (1832), Lélia (1833) ou Mauprat (1837) s’exerce à décrire l’épanchement de passions qui se veulent un défi à la société et à ses lois. Plus tard, en pleine génération réaliste, le roman Dominique (1862) d’Eugène Fromentin, autobiographie romanesque dans la lignée d’Adolphe et de Volupté, sera la dernière œuvre à témoigner à la fois de la persistance et de la critique de ce type de roman. -le roman historique Le roman sentimental et personnel va céder peu à peu la première place au roman historique qui connaît, dès 1820, un succès considérable auprès des lecteurs, exprimant l’intérêt de la nouvelle école pour l’histoire nationale comme son goût du pittoresque et de la couleur locale. Les œuvres illustrant ce genre romantique privilégié sont nombreuses: évocations dramatiques d’époques troubles où se déchaînent les passions (Prosper Mérimée, La Chronique du règne de Charles IX; Alfred de Vigny, Cinq Mars); romans d’aventures figurant parmi les œuvres les plus durablement populaires de la littérature française (Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse; Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires). Cette reconstitution romanesque de l’histoire est particulièrement saisissante dans l’œuvre de Victor Hugo, Notre Dame de Paris (1831): Hugo fait revivre le Paris de Louis XI (XVe siècle) dominé par sa cathédrale, personnage principal véritable du roman. L’intrigue et les personnages mélodramatiques illustrent les grands thèmes romantiques comme les contrastes chers à Hugo: la séduisante bohémienne Esméralda, que la passion d’un prêtre, l’archidiacre Frollo, conduit à une fin tragique est aussi aimée par un être monstrueux et difforme, Quasimodo. -le roman-feuilleton Le roman historique connaîtra en fait ses plus grands succès chez des créateurs qui se serviront de l’histoire avant tout comme d’un cadre pittoresque, voire exotique, pour des aventures mystérieuses ou exaltantes: la Corse et l’Espagne de Prosper Mérimée (Colomba, 1840; Carmen, 1845), ou encore l’Égypte de Théophile Gautier (Le Roman de la momie, 1858). Mais l’audience maximale du genre sera atteinte par d’interminables romans qui, à partir de 1835, paraissent en feuilleton dans des journaux à bon marché (La Presse, Le Siècle etc.). Les deux maîtres incontestables du genres sont Alexandre Dumas, avec ses sagas historiques hautes en couleurs (Les Trois Mousquetaires, 1844; Le Comte de Monte-Cristo, 1845; Le Chevalier de la Maison-Rouge, 1846), et Eugène Sue, chez qui le roman d’aventures se double d’une dimension sociale: Le Juif errant, 1844, Les Mystères de Paris, 1842-1843 et Les Mystères du peuple, 1849- 1857. -le roman social Ouverts au monde extérieur, les romantiques n’ont pas négligé leur époque: après 1830, l’affirmation des préoccupations sociales conduit à un intérêt nouveau pour le peuple. Les Mystères de Paris (1824) d’Eugène Sue évoquent avec compassion la misère populaire mais ne sont encore qu’un roman d’aventures mélodramatiques. Les Misérables (1862) de Victor Hugo développent un véritable plaidoyer pour toutes les victimes des misères du temps. Par le récit de la rédemption morale d’un forçat, Jean Valjean, condamné au bagne pour avoir dérobé un morceau de pain, Victor Hugo dresse le procès d’une société injuste, impitoyable aux pauvres qu’elle conduit à la déchéance morale par le vol ou par la prostitution. Animé de vastes fresques épiques, le roman est aussi une vaste méditation sur l’évolution de l’humanité n’évitant pas les trop longues dissertations morales. Chez George Sand, le parti pris de l’élargissement du romanesque au social devient systématique après 1840. Certaines de ses œuvres, comme Le Compagnon du tour de France, 1840 ou Le Meunier d’Angibault, 1845, peuvent être lues comme des mises en fiction du socialisme utopique, tandis que ses romans « champêtres » (La Mare au diable, 1846, François le Champi, 1850, Les Maîtres sonneurs, 1853) demeurent marqués par une sorte de mysticisme populaire et rustique. La Petite Fadette idéalise la vie paysanne et mêle une certaine nostalgie philosophique à la description réaliste des coutumes de la région de Cosse. Le roman s’inscrit dans la lignée des grandes œuvres romantiques à caractère autobiographique. L’influence du romantisme y est décelable par l’identification de quelques traits fondamentaux, dont on peut retenir : - quelques thèmes privilégiés, tels que la nature, le rêve, l’amour, la lutte contre les préjugés et les inégalités sociales, la magie qui fait tomber l’accent sur le côté légende, superstition, traditions populaires ; - le style emphatique, la netteté des images, la parfaite fluidité, la précision des figures stylistiques et la musicalité des phrases ; - ce texte romanesque est en même temps le cadre de l’expression personnelle de l’auteur, un instrument d’exploration de l’histoire et une analyse des tourments du personnage central. La personnalité de la petite Fadette présente de nombreux traits romantiques, tels que le sentiment d’être différente des autres et, par là, incomprise, celui de la solitude et du malaise devant l’existence ; - le texte s’organise autour d’un personnage central, valorisant l’individu ; - l’action du roman est placée aux derniers jours de septembre, donc les événements se déroulent en automne - saison privilégiée des romantiques ; - la mise en valeur des rêves et des rêveries du héros principal. La rêverie s’épanouit à partir des sensations et des éléments concrets. Le réel est appréhendé par le biais de la synecdoque (la signification abstraite est symbolisée par la chose concrète) ; - le choix les toponymes reflète le rapport lieu - homme ; - l’auteur illustre dans ce roman sa sympathie profonde pour le peuple ; il y introduit un grand nombre de héros populaires (deux familles de fermiers – les Barbeau et les Caillaud, la mère Sagette, la mère Fadet et ses enfants – la petite Fadette et Jeanet) etc. uploads/Litterature/ le-roman-romantique.pdf
Documents similaires










-
82
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 20, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0875MB