2 Défense de la langue française nº 251 La concordance des temps n’est pas sans
2 Défense de la langue française nº 251 La concordance des temps n’est pas sans poser quelquefois de petits problèmes… Quand la proposition principale est au passé, il est d’usage que les subordonnées qui la suivent s’installent dans le temps de la principale et se mettent donc, elles aussi, au passé. Ce n’est pas sans susciter quelques ambiguïtés. « On m’a dit, Madame, que vous étiez une excellente cuisinière… » La dame va-t-elle sursauter et répondre avec un peu d’aigreur : « Mais je le suis toujours, Monsieur… » Car cet imparfait peut exprimer le présent du temps où l’on parle, aussi bien que le passé révolu... Si cette personne avait déclaré « On me dit, Madame... », elle aurait évidemment terminé sa phrase par « que vous êtes ». Mais celui qui a prononcé ces mots avait un grand respect de la concordance des temps. C’était d’ailleurs une personne de grand talent, et pas seulement pour la cuisine : il s’agissait de Maurice Edmond Sailland, plus connu sous le nom de Curnonsky. Le fameux gastronome parlait très bien notre langue, et en goûtait toutes les saveurs. Il a donc dit : « On m’a dit, Madame, que vous étiez… » Philippe Beaussant de l’Académie française La concordance des temps Notre président a signé, le 6 janvier, le « Bloc-notes » du site de l’Académie française. Il l’a intitulé « Au plaisir des mots, au plaisir de la grammaire ». Extrait. Le français dans le monde 4 Défense de la langue française nº 251 [...] qu’est-ce que le français après tout, après toutes ces aventures qui ne sont donjuanesques qu’en apparence ? Eh bien, je dirai que je suis un enfant du français. Adoptif certes, mais enfant quand même. Pourquoi ? Parce que le français m’a nourri et élevé comme les parents nourrissent et élèvent leurs enfants. Je suis aussi un élève du français. Pourquoi ? Parce que le français m’a appris énormément de choses comme un bon professeur transmet beaucoup de choses à ses élèves. Je suis également un habitant fidèle, un hôte honoré, un locataire permanent du français. Pourquoi ? Parce que j’habite depuis plus de quarante ans sans discontinuer dans cet immense espace du français, dans cette immense maison que je n’aurai jamais fini d’explorer. Cela fait donc plus de quarante ans qu’elle dure, cette complicité heureuse. Et au bout de quarante ans, je puis dire que le français est devenu, presque au même titre que le japonais, ma langue, c’est-à-dire une langue dans laquelle et par laquelle je vis : je réfléchis, je rêve et, surtout, j’écris en français ; j’entretiens mes relations avec les êtres et les choses de ce monde par cette langue, j’effectue les gestes les plus ordinaires de la vie au moyen de cette langue. Quand je dis que le français est devenu presque ma langue, j’entends par là que j’éprouve un sentiment de proximité, de douce familiarité, de tendre attachement vis-à-vis du français. Je me sens installé dans la langue française ; je crois occuper un coin, sans avoir le risque d’être accusé d’une usurpation quelconque ; j’adhère à cette langue que j’entends surgir et vibrer en moi. Le possessif Enfant du français Professeur de langue et littérature françaises à l’université Sophia de Tokyo, Akira Mizubayashi a reçu le prix littéraire Richelieu de la francophonie pour son livre : Une langue venue d’ailleurs (cf. DLF, no 241). Avec son autorisation, nous reproduisons des extraits du discours qu’il a prononcé lors de la remise de ce prix, le 8 octobre 2013, à Bruxelles. Le français dans le monde 5 de « ma langue » ne renvoie absolument pas à l’idée de possession, mais à celle d’intimité. Le français, de toute évidence, ne m’appartient pas. S’il faut en parler en terme de possession, c’est plutôt moi qui suis possédé par le français. Mais il demeure, tout de même, inéluctablement, une distance qu’il s’agit de réduire. Je dessine donc un parcours, un trajet vers le français ; je m’engage dans un incessant mouvement vers cette langue qui m’habite, m’accompagne et ne me quitte pas un instant. C’est ce mouvement perpétuel et interminable de « tendre vers » que j’ai envie de nommer « apprentissage ». Et j’ajouterai tout de suite que ce qui est primordial ici, c’est que le champ d’application de cet apprentissage ne se limite pas au français. C’est ainsi que le japonais m’est apparu, au sein même de mon effort d’apprendre le français, dans une configuration renouvelée, voire inédite, comme une vraie langue étrangère et, par conséquent, un tant soit peu éloignée. Je me retrouve lancé en fin de compte dans la poursuite consciente de ma langue natale, dans un processus de réappropriation de ma langue d’origine. Bref j’ai appris à (ré-)apprendre le japonais. Si bien que je pourrai dire, sans le moindre souci de paradoxe ni de provocation, qu’il n’est plus tout à fait ma langue. [...] J’ai écrit, dans Une langue venue d’ailleurs, que j’habitais le français en reprenant à mon compte l’expression si percutante de Cioran. J’ai cru voir là une formule heureuse qui traduisait mon sentiment d’installation dans l’espace de la langue française. Mais c’est aussi, pour moi, une manière de dire que je n’habite pas la France ou un pays francophone, contrairement à bien des écrivains de langue française d’origine étrangère. J’écris en français alors que je vis à des milliers de kilomètres des terres où l’on parle français. Écrire en français et donc le vivre dans la solitude voulue de l’immense ville de Tokyo, c’est pour moi une nécessité intérieure vitale et, par conséquent, je continuerai encore longtemps à écrire en français, loin de vous, loin de Bruxelles, loin de Paris. Akira Mizubayashi 6 Défense de la langue française nº 251 Le français dans le monde Le 22 septembre 2013 à Montpellier, Claire Goyer (†), administrateur de DLF et présidente de la délégation de Bruxelles-Europe, a participé à l’une des tables rondes organisées par les Amis de Dalat sur les traces de Yersin (AD@lY), à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du médecin et explorateur franco-suisse. Elle avait rédigé, pour la revue, le résumé de son intervention. Au Viêt Nam Autour de la francophonie vietnamienne Une étude récente prévoit que nous serons un milliard de franco- phones en 2060. C’est très réjouissant... mais est-ce si sûr ? Espérons que les francophones d’aujourd’hui continueront d’engendrer les francophones de demain, car ceux de l’extérieur sont plus nombreux que ceux de France. Sur les 220 millions de francophones du monde, 92 millions résident en Afrique. Ils n’ont pas nécessairement le français comme langue maternelle. Souhaitons qu’ils persistent à avoir envie de français, il faut y veiller pour ne pas voir se répéter le choix du Rwanda, traditionnellement francophone, qui a pourtant remplacé le français par l’anglais. Cependant, au Viêt Nam, la francophonie se porte bien. Elle a le nom d’une ville, Dalat, 200 000 habitants, située sur les hauts plateaux du sud Viêt Nam, à 300 kilomètres de Ho Chi Minh Ville (anciennement Saïgon). Découverte quant à son site, et pratiquement « inventée » en 1893 par le Dr Yersin qui y demeure plus célèbre qu’en Europe. Patrick Deville lui a consacré un roman, Peste et Choléra, dans lequel il décrit ce personnage hors normes né dans les Alpes suisses, puis naturalisé français après son travail remarqué à l’Institut Pasteur où il découvrit la toxine diphtérique. Et enfin, sa fascination pour l’Asie qui le mène à y créer un nouvel Institut Pasteur en 1895. 7 Confronté à plusieurs épidémies de peste sur le continent asiatique, Yersin réussit à isoler le bacille de la peste bubonique (Yersinia pestis). Mais il ne parviendra pas à résoudre le problème de la transmission de la maladie du rat à l’homme ni à fabriquer un vaccin. Sur les traces du Dr Yersin, la semaine française à Dalat, qui s’est déroulée du 9 au 15 décembre 2013, a permis à Anna Owadhi- Richardson, présidente d’AD@lY, et à Nicolas Leymonerie, ingénieur français installé à Dalat, de manifester leur attachement à la francophonie. Ce dernier, en mars 2013, avait mis en scène la vie d’Alexandre Yersin avec des étudiants de l’université du même nom. Grand succès, d’où la décision de créer un centre culturel franco- phone avec l’aide des autorités locales, prêtes à investir dans la culture et la langue françaises, notamment par le biais des classes bilingues dans le secondaire. Les institutions françaises et l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) soutiennent activement ces projets. Ce développement du français dans la région de Dalat est particulièrement encourageant pour l’action de DLF Bruxelles- Europe, d'autant que la langue française est malmenée en France et en Europe. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la diversité linguistique recule. L’utilisation exclusive de l’anglais dans les sphères de l’économie, de la recherche, des brevets et des organisations internationales, conduit fatalement à l’hégémonie de la pensée anglo- saxonne. Le philosophe Michel Serres, tout en qualifiant l’anglais de langue de l’élite, a écrit dans La Dépêche du Midi : « Je uploads/Litterature/ le-francais-dans-le-monde.pdf
Documents similaires






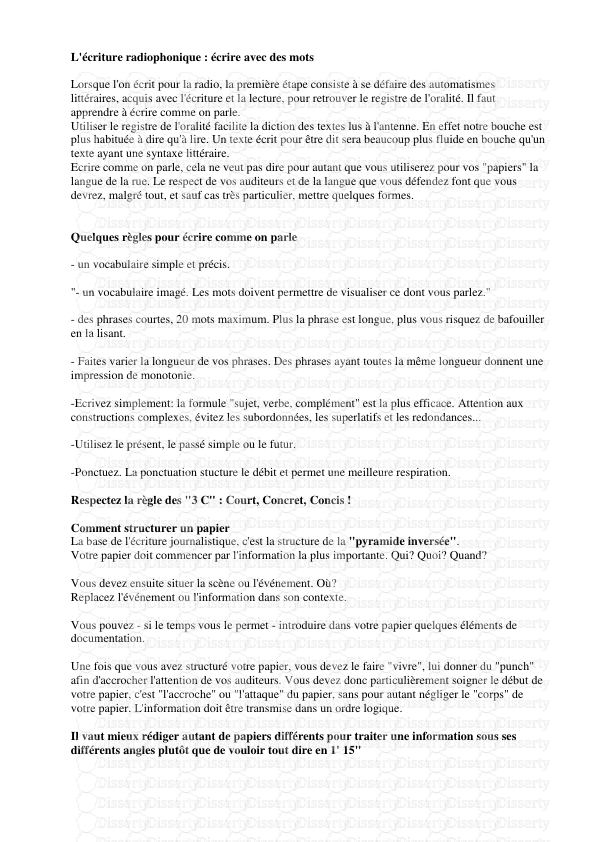



-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 20, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.8279MB


