Revue du Nord La tactique militaire des années de chevaliers Jan Frans Verbrugg
Revue du Nord La tactique militaire des années de chevaliers Jan Frans Verbruggen Citer ce document / Cite this document : Verbruggen Jan Frans. La tactique militaire des années de chevaliers. In: Revue du Nord, tome 29, n°115, Juillet-septembre 1947. pp. 161-180; doi : https://doi.org/10.3406/rnord.1947.1910 https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1947_num_29_115_1910 Fichier pdf généré le 07/04/2018 LA TACTIQUE MILITAIRE DES ARMÉES DE CHEVALIERS Les idées de Delbriiek x et de la plupart des historiens militaires de son école, sur la tactique des chevaliers, reposent sur une documentation incomplète, parfois même mal interprétée. Nous sommes persuadés que la lecture de quelques sources précieuses, qu'il paraît ignorer, l'aurait fait douter de sa propre théorie. Une étude approfondie lui aurait montré que la tactique du combat entre chevaliers était meilleure et plus avancée qu'il ne le pense. Nous ne pouvons plus nous résoudre à considérer, avec lui, les tournois commes des jeux sans risques, le chevalier comme un combattant fougueux, mais individuel, le combat comme une série de corps, à corps se déroulant au gré de la fantaisie des combattants, sans plan, sans chefs, sans commandement, sans tactique, c'est-à-dire sans intelligence. C'est ce que nous voudrions montrer ici. 1 . Les Tournois. Letjb influence. L'erreur principale de Delbriick, en effet, réside d'abord dans le peu d'importance qu'il accorde aux tournois, ainsi que dans la description peu heureuse qu'il en fait. Il prétend que les chevaliers s'y battaient avec des lances dont la pointe était émoussée 2, et, beaucoup plus tard seulement, avec des armes réelles. Or l'évolution s'est, en fait, produite en sens inverse : au xne siècle on se battait dans les tournois avec des armes réelles et ce n'est que beaucoup plus tard que l'on eut recours à des armes dont les pointes et les tranchants étaient émoussés. D'ailleurs plusieurs historiens ont déjà attiré l'attention sur ces jeux brutaux. 1. Hans Delbbùck, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, t. III, 2e édit., Berlin, 1923. 2. Ibidem, p. 264-265. — E. Daniels, Geschichte des Kriegswesens, t. II. Dos mittel- ulterliche Kriegswesen (Sammlung Gô3chen, fasc. 498, 2e édit. Berlin et Leipzig, 1927), donne tin résumé de la théorie de Delbriick, et a corrigé cette- erreur sans en tirer de nouvelles conclusions (t. II, p. 81-82). — P. Schmecthenneb, Krieg und Kriegsfùhrung im Wandel der Weltgeschichte (dans le « Museum der Weltgeschichte », édité par P. Herre ), Potsdam, 1930. — J. Ullrich, La Guerre à travers les Ages, 2e edit., trad, de H. J. Ferget. Gallimard, Paris, 1942. Revue du Nord 162 REVTTE DIT NOED L. Gautier 8, P. Meyer 4, H. Pirenne 5 comparent les tournois à de vrais combats où l'on se bat vigoureusement avec armes réelles comme sur un champ de bataille. La belle description de Paul Meyer est d'ailleurs confirmée par d'autres sources, par exemple Gislebert de Mons 6: L'influence des tournois sur la formation collective des chevaliers et sur la tactique du combat entre chevaliers ner peut être méconnue '.On sait par exemple que, du xie siècle au début du xne, les chevaliers flamands trouvèrent un entraînement très réaliste dans les guerres privées où « ils se détruisent avec fureur » 8. Lorsque Baudouin VII eut imposé la paix, à ses guerriers turbulents, il les conduisit lui-même à l'entraînement dans toutes les rencontres de chevaliers où l'on se battait 9, c'est-à-dire aux tournois. - Charles le Bon, dans ce dessein, les emmenait même à l'étranger. Gaïbert de Bruges nous raconte qu'il s'en alla « pour l'honneur de son pays et l'entraînement de ses chevaliers, chez les comtes ou princes de la France, ou même hors du royaume, pour y participer aux tournois avec 200 de ses chevaliers » l0 ! Politique suivie par ses successeurs, et en particulier par Philippe d'Alsace. Celui-ci n'est-il pas loué partout comme un grand seigneur « expert eu choses militaires » u ? Ces combats ne se déroulaient pas à l'aventure ; au temps de Philippe d'Alsace, on préconisait la tactique suivante : tenir sa formation de chevaliers, composée de groupes plus petits ou conrois (conrei), biefc serrée, en bon ordre, et foncer ainsi sur l'ennemi. Désorganiser la formation de celui-ci, le battre, et faire autant de prisonniers que possible. Ceci indiqae clairement que le tournoi même n'était pas une 3. L. Gautier, La Chevalerie, 3e édit., Paris, 1895. 4. P. Meyer, Histoire de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke et régent d'Angleterre de 1216 à 1219 (Société de l'histoire de France, 3 vol. Paris 1891- 1901), t. III, p. xxxvii-xxxix. 5. H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. I (Bruxelles, 1929, 5e édit.), p. 152. 6. Gisi^ibert de Mons, Chronique, édit. L. Vanderkindere (Comm. royale d'histoire, in-8°, Bruxelles, 1904), c. 57 (p. 97-98), c. 69 (p. 108-109), c. 77 (p. 116-117), c. 85 (p. 123-124), c. 92 (p. 127), c. 100 (p. 140-141). 7. Delbrûck, op. cit., p. 262, n'y voit que l'entraînement individuel ! Déjà au temps de Nithard il y a des jeux de chevaliers : véritables exercices collectifs (p. 110). — Nithard, Histoire des Fils de Louis le Pieux, édit. et trad, de Ph. Lauer (Les classiques de l'histoire de France au. Moyen Age, fasc. 7), Paris 1926. ' 8. H. Pirenne, op. cit., p. 153. 9. Herman de Tournai, Liber de restaurations, monasterii Sancti Martini Torna- censis, édit. G. Waitz, M. G. H., SS., t. XIV (1883), c. 24, p. 284. 10. Gaxbert de Bruges, Histoire du meurtre de Charles le Bon (1127-1128), édit. H. Pirenne (Collection âe textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'Histoire, fasc. 10, Paris, 1891), c. 4, p. 9. 11. Hist, de Guill. U Maréchal, t. I, p. 134 (vers 3688-89), p. 99 (vers 2716), p. 112 (vers 3064 et sq.), p. 118 (vers 3243-44). — Gautier Map, De nugis curialium, édit. R. Pauli, M. G. H., SS., t. XXVII (1885), IV, i, p. 70. LE TACTIQUE DES ARMÉES DE CHEVALIERS 163 multiplication de duels entre chevaliers, mais qu'on connaissait la valeur de choc d'une forirtation bien serrée, et la^valeur de l'ordre, pour mieux désorganiser et battre les adversaires. ; Les descriptions de tournois dans Y Histoire de Guillaume le Maréchal ne laissent aucun doute à ce sujet. Dans un tournoi quiopposa des chevaliers Anglais à des Français, ceux-ci arrivèrent en désordre, « par leur orgueil et parce qu'ils sont plus nombreux: ». Mais ils furent vaincus par les Anglais parce que ceux-ci se tinrent « serré et .bataillé » 12 ! Philippe d'Alsace suivait une tactique particulière, ce qui prouve bien que la 'politique des comtes de Flandre, au sujet des tournois, a. porté ses fruits. Il conseilla cette tactique au jeune Henri, fils du roi Henri II d'Angleterre, et qui avait reçu sa formation de chevalier chez lui l3. Il feignait d'abord de ne pas prendre part au tournoi. Aussitôt que ses adversaires paraissaient fatigués et en désordre, et qu'il estimait le moment favorable, il les attaquait par surprise, peut- être même de flanc 14. Avec son groupe compact il réussissait à battre ses adversaires et à faire beaucoup de prisonniers. Cette tactique lui fit remporter beaucoup de victoires u. Les contemporains voyaient d'ailleurs dans les tournois un entraînement efficace. Guillaume de Newburgh ne dit-il pas que les Français, habitués à ce genre d'exercices, étaient tellement supérieurs aux chevaliers anglais dans les batailles, que Richard Cœur de Lion introduisit les tournois en Angleterre 16 ? L'effet de cette mesure n'a pas tardé à se faire sentir. Ce roi d'Angleterre a battu plusieurs fois l'armée de Philippe Auguste : à Fréteval (3 juillet 1194), à Gisors (28 septembre 1198). Et les Anglais sont devenus si sûrs d'eux-mêmes, qu'ils n'hésitent pas à attaquer 40 Français avec 30 chevaliers, ce qui n'était pas le cas auparavant 17 ! 2. Naissance de petits corps tactiques. Les Conrois. Ceci nous amène à parler des conrois, unités de combat, nées pour ainsi dire aux tournois. Les chevaliers s'y battaient par groupes de 12. Hist, de GuiU. le Maréchal, t. I, p. 92 (vers 2497-2508), p. 48 (vers 1307-08)* p. 128 (vers 3527-29). 13. Ibid., I, p. 99-100 vers 2715-2740. A ce moment le comte de Flandre était un des rares seigneurs qui amenaient des fantassins aux tournois. 14. Ibid., loc. cit., vers 2729 : « à la traverse ». 15. Cette conduite, qui nous paraît peu chevaleresque, était louée à son époque comme celle d'un homme courageux et intelligent. Ibid., he. cit., vers 2728. 16. Cité par L. Gatottheer, La chevalerie, p. 676 (Guillaume de Newburgh : lib. v c. iv). 17. Hist, de Guillaume le Maréchal, t. II, p. 34 (vers 11063-11068). 164 REVUE DU NORD 30 ou 40 combattants, se ralliant autour de la bannière de leur cnef ls dont ils portaient les signes distinctifs ou armoiries -19. . - . Le nombre de chevaliers dans un conroi n'est pas fixe. Ces groupes sont à l'origine des petites unités tactiques dé la chevalerie. De même qu'on parle d'une unité tactique d'infanterie, la phalange, n'ayant pas de nombre fixe de combattants, on peut parler d'une uploads/Litterature/ la-tactique-militaire-des-annees-de-chevaliers.pdf
Documents similaires

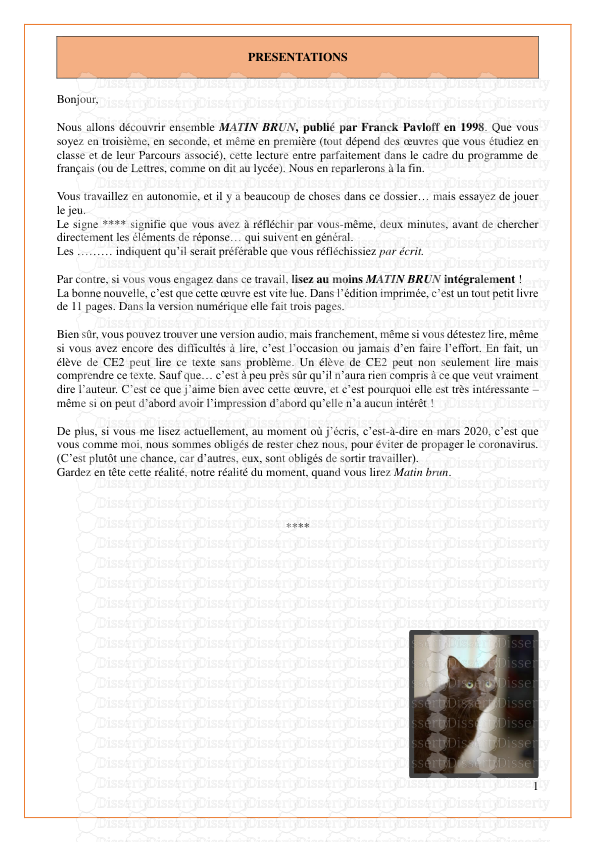




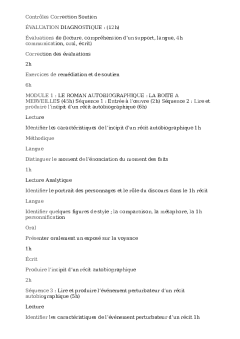



-
29
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 14, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9253MB


