La conjuration des dictionnaires Vérité des mots et vérités de la politique dan
La conjuration des dictionnaires Vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne Jean-Claude Waquet DOI : 10.4000/books.pus.7851 Éditeur : Presses universitaires de Strasbourg Lieu d'édition : Strasbourg Année d'édition : 2000 Date de mise en ligne : 19 septembre 2019 Collection : Sciences de l’histoire ISBN électronique : 9791034404568 http://books.openedition.org Édition imprimée Date de publication : 1 janvier 2000 ISBN : 9782868201416 Nombre de pages : 270 Référence électronique WAQUET, Jean-Claude. La conjuration des dictionnaires : Vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne. Nouvelle édition [en ligne]. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2000 (généré le 23 septembre 2019). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pus/7851>. ISBN : 9791034404568. DOI : 10.4000/books.pus.7851. Ce document a été généré automatiquement le 23 septembre 2019. Il est issu d'une numérisation par reconnaissance optique de caractères. © Presses universitaires de Strasbourg, 2000 Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540 La multiplication, aux temps modernes, des dictionnaires français (Estienne, Richelet, Furetière, Trévoux, etc.) a donné lieu à de nombreux articles intéressant la politique. Partant de la langue, la présente analyse saisit d'abord le sens des mots dans sa confuse dispersion, puis fait apparaître le travail de réduction et de mise en ordre opéré par les lexicographes, enfin renvoie leurs désaccords à la diversité des langages et des philosophies politiques exploités par chacun d'eux. L'enquête porte essentiellement sur quatre mots - conjuration, conspiration, cabale, complot - désignant des « entreprises secrètes » dont la Conjuration d'Amboise, celle de Cinq-Mars ou la Cabale des importants fournissent autant d'exemples restés fameux dans les annales de la France moderne. Aussi ce livre intéresse-t-il l'histoire des comportements politiques ou, plus exactement, celle de leur représentation. JEAN-CLAUDE WAQUET Professeur d'histoire moderne à l'Université de Paris XII, après l'avoir été à l'Université Marc Bloch de Strasbourg, Jean-Claude Waquet est l'auteur de plusieurs livres portant sur l'histoire de la France et de l'Italie modernes : Les grands maîtres des eaux et forêts de France de 1689 à la Révolution française, Genève, 1978 ; De la corruption. Morale et pouvoir à Florence aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1984 ; L'Italie au XVIIe siècle, Paris, 1989 (en coll.) ; Le grand-duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens Etats italiens, Rome, 1990. 1 SOMMAIRE Abréviations Introduction Première partie. L'universelle confusion des mots L’universelle confusion des mots Chapitre Ier. Toutes les apparences de l’ordre I II III Chapitre II. Un ordre dispersé I II III Chapitre III. Des événements indéfinis I II Deuxième partie. L'illusoire clarté des dictionnaires L’illusoire clarté des dictionnaires Chapitre Ier. Le sens des mots I II III Chapitre II. L’histoire des choses I II III IV Chapitre III. Le jugement des hommes I II III 2 Troisième partie. La discrète officine des vérités contraires La discrète officine des vérités contraires Chapitre Ier. Dans l’atelier du lexicographe I II III IV Chapitre II. L’organe des particuliers I II III Chapitre III. Les vérités de la politique 1. Estienne, Monet I II Chapitre IV. Les vérités de la politique 2. L’Académie, Furetière, Richelet I II III IV Conclusion Sources Bibliographie 3 NOTE DE L’ÉDITEUR Les Presses Universitaires remercient le Conseil Scientifique de l’Université Marc Bloch et la Société des Amis des Universités pour le soutien accordé à cette publication. 4 Abréviations 1 Dans la première partie, les références aux textes comprennent un numéro d’ordre, un nom d’auteur et un numéro de page, éventuellement précédé d’un no de volume (ex. : 88 Goulas, 1, 452). Les références complètes des œuvres se trouvent p. 242sq. 2 Dans l’ensemble de l’ouvrage, les références aux dictionnaires français-latin et aux dictionnaires monolingues du français comprennent un millésime et une abréviation ou un nom (d’auteur, de collectivité-auteur ou de lieu), suivis du renvoi à l’article concerné. Ex. : 1767 G.V.F., s.v. cabale ; 1690 Furetière, s.v. monarchie ; 1694 Académie, s.v. sagesse ; 1704 Trévoux, s.v. ordre. On trouvera p. 239sq une description des éditions utilisées. 5 Introduction1 1 « Les mêmes hommes en différens âges ont considéré les mêmes choses en des manières très différentes, et néanmoins ils ont toujours rassemblé toutes ces idées sous un même nom ; ce qui fait que prononçant un mot, ou l’entendant prononcer, on se brouille facilement, le prenant tantôt selon une idée, et tantôt selon l’autre »1. Arnauld et Nicole déplorent en logiciens cette confusion qui gâte nos discours, obscurcit nos pensées et rend vaines bien des controverses. D’autres la combattent en tant qu’hommes de lettres : ils veulent depuis Malherbe plus de clarté dans le français, plus de netteté dans les constructions, plus de justesse enfin dans l’emploi du lexique où chacun doit puiser. Il est urgent, explique un jour Chapelain, de « régler les termes et les phrases ». Il faut à tout le moins, déclare une autre fois Faret, établir « un usage certain des mots »2. Les grammairiens y travaillent. Plus tard, au XVIIIe siècle, les synonymistes s’y consacrent. Tous, de Vaugelas à Bouhours, puis de Girard à Roubaud, s’efforcent de mettre un ordre clair et distinct dans le désordre de la langue. 2 Les dictionnaires, notamment celui de l’Académie française et ses deux rameaux détachés - le Richelet et le Furetière -, participent de cette vaste entreprise de clarification. Ils contrôlent, a-t-on écrit, « le jeu des dérivations à partir de la désignation première des mots »3 ; ils tracent, a-t-on encore observé, « des limites rigoureuses dans des terrains que l’usage articule et peuple confusément »4 ; bref, ils ordonnent et définissent et, ordonnant et définissant, ils fondent une « orthodoxie langagière »5 ou, à tout le moins, présentent le lexique et le sens des mots de façon que chacun puisse à la fois exprimer correctement ses pensées et entendre aisément celles d’autrui. Les académiciens donnent ainsi la « véritable signification »6 des termes qu’ils expliquent, et leur ouvrage constituera demain le meilleur « interprète des livres »7 transmis à la postérité par le siècle de Louis le Grand. Le lecteur des dictionnaires, proclame la préface du Furetière, acquiert en s’en servant une « justesse d’esprit » qui lui sera d’un « usage merveilleux » dans l’exercice de sa profession8. Quelques décennies plus tard, l’abbé Goujet juge les productions lexicographiques de la fin du XVIIe siècle du point de vue de leur pureté, netteté, précision et exactitude. Le Furetière, explique-t-il, « démêle fort bien toutes les propriétés et les diverses significations des mots. Tout y paraît développé avec tant d’ordre et de clarté, que cet ouvrage est très propre à instruire ceux qui savent le moins ». La deuxième édition du dictionnaire de l’Académie mérite également des éloges pour son « attention 6 particulière à expliquer, à déterminer, et à bien faire sentir la véritable signification de chaque mot par des définitions exactes et des exemples »9. Peu après, la Question des dictionnaires renvoie sous la plume de l’abbé Bellet l’écho de ces propos favorables : ce qui fait, y lit-on, le prix du travail des académiciens, ce sont leurs définitions « exactes et précises » et leur souci de marquer le « véritable usage » de chaque terme10. 3 Chacun sait que le public n’a pas toujours réservé au dictionnaire de l’Académie des appréciations aussi flatteuses. De sa première édition, on a dit et répété depuis l’époque de Louis XIV qu’elle reflète un état de langue vieilli, voire périmé, et qu’elle pèche en outre par une présentation incommode, une nomenclature lacunaire, une absence totale de citations, des définitions inexactes et des entorses à l’usage policé du français11. Ces jugements peu charitables sont ceux que devaient rendre des grammairiens irrésistiblement portés à s’ériger en censeurs. Leur verdict toutefois n’est pas de nature à impressionner les chercheurs, dont le but n’est pas de corriger le dictionnaire, mais de comprendre comment les académiciens ont « construit »12 la langue sous le prétexte bien commode d’en déclarer l’usage. Il reste enfin sans prise sur qui voit dans leur répertoire et, plus généralement, dans les grands lexiques monolingues de la fin du XVIIe siècle, autant d’interprétations du français et du monde, incomplètes bien sûr, discutables sans doute, tendancieuses immanquablement, mais toujours porteuses d’un sens digne d’être élucidé. Ce point de vue est celui qu’on a adopté ici, en l’appliquant non seulement aux trois monuments imprimés du vivant de Louis XIV, mais aussi et plus généralement à l’ensemble des dictionnaires du français publiés de la première moitié du XVIe siècle à la Révolution avec un succès dont le propre fut d’être considérable13. * * * 4 L’étude des dictionnaires publiés sous l’Ancien Régime et, plus précisément, des interprétations de la langue française qu’ils fournissent, doit être conduite en tenant compte des caractères propres à cette catégorie d’ouvrages. Les travaux d’histoire de la lexicographie sont ici d’une évidente utilité. Linguistes pour la plupart, leurs auteurs ont établi une typologie des dictionnaires, retracé la carrière de leurs rédacteurs, suivi les étapes de leur composition, analysé les procédés de leur fabrication et révélé la structure de uploads/Litterature/ la-conjuration-des-dictionnaires.pdf
Documents similaires




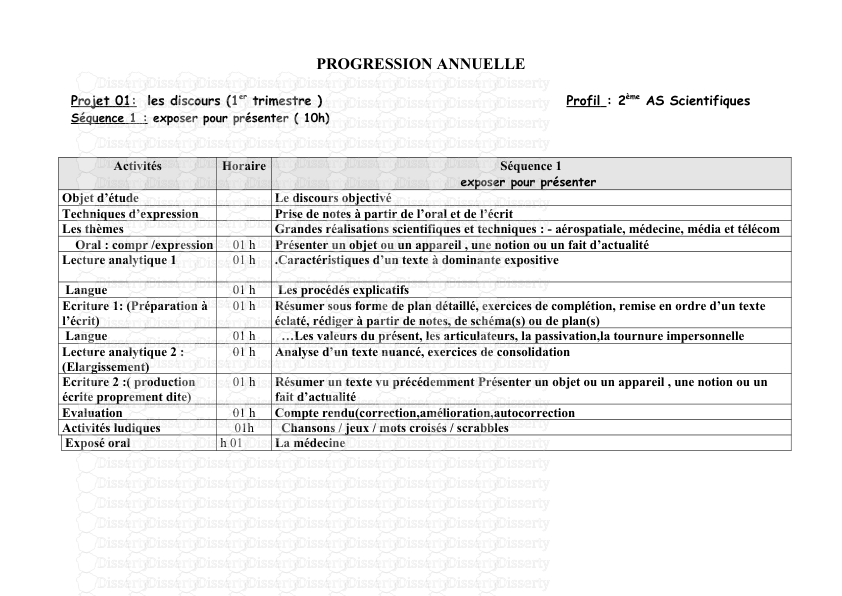





-
60
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 17, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.7606MB


