Réfléchir en écrivant sur une feuille ouvre des possibilités très intéressantes
Réfléchir en écrivant sur une feuille ouvre des possibilités très intéressantes, par la rapidité des rapprochements, la clarté des tableaux synoptiques. À la main, on peut utiliser aisément flèches de dissociation et d'association, dessiner, schématiser, c'est-à-dire rendre sensible à soi-même ce qui est abstrait ou intelligible. Comme la figure du cercle le fait pour la définition du cercle. Une fois l'esquisse sur les rails, il importe de bien déterminer le moment, impératif, du passage du brouillon à la copie. Ainsi, pour une épreuve en quatre heures, ne jamais consacrer au brouillon plus d'une heure et demie. Ce qui laisse au moins deux heures et demie pour le recopiage de l'introduction et de la conclusion, la rédaction du développement avec argumentaires et illustrations, et la relecture qui est essentielle. En juin dernier, à HEC, lors du compte-rendu exectué par le responsable de l'épreuve de dissertation de culture générale, il a été indiqué qu'il y avait en moyenne 10 à 15 fautes par copie. Le record a été atteint, lors de la session 2014, par une copie contenant 134 fautes. Il a été rappelé qu'un point était retiré par tranche de 5 fautes. D'où la nécessité de se réserver au moins dix minutes pour la relecture attentive. Il est important de prendre les indications qui suivent comme des suggestions qui sont à adapter en fonction de la personnalité de chacun. Tel d'entre vous, après avoir montré que le sujet donnait quelque chose à penser, se plaira à annoncer dès le départ tous les enchaînements, alors que tel autre aura besoin de ménager une certaine dramatisation plus surprenante, néanmoins explicitée et cohérente. Certains, pour se sentir bien dans l'acte d'écriture, auront besoin d'homogénéiser les illustrations, ou de faire monter en puissance les tensions théoriques… Le seul point non négociable : ne jamais laisser votre lecteur, c'est-à-dire, ici, l'examinateur, deviner tout seul la logique de vos enchaînements. Autant, pendant l'année, on peut avoir la tentation d'être allusif, puisque l'on s'adresse à un professeur dont on sait qu'il connaît tel contexte ou telle transition… Autant, au concours, il est impératif de tout expliquer. D'où l'importance d'éviter ce que les jurys appellent les topoï — pluriel grec du terme topos —, des enchaînements et références déjà constitués, que l'on voudra de force " réussir à placer ", et qui font intervenir des présupposés disparates. Ne surtout pas passer l'année à constituer une " dissertation type " sur la vérité en général, qui ne pourra en rien constituer un traitement circonstancié de tel sujet particulier. Les citations hors contexte, vestiges pitoyables d'une pensée démembrée, sont également indésirables. Ce que l'on notera au brouillon Le sujet lui-même, pour relever en lui les équivalences, les oppositions, les présupposés, la forme ouverte, fermée, les rapports de condition à conséquence. L'indication schématique de ce qui, en lui, est fragile. Il y a deux manières d'interroger un sujet apparemment hermétique : quels sont ses fondements, quelles sont ses conséquences ? Ce qui amène à relever, pour l'énoncé proposé, une incertitude, ou une tension. On appelle dissertation l'écriture d'hypothèses successives qui formulent et travaillent cette incertitude. Pour chacune de ces étapes, noter, sans tout rédiger : l'argumentaire pressenti ; l'illustration qui est une incarnation particulière de la thèse ; la limite sans laquelle on ne comprendrait pas pourquoi la dissertation se poursuit. Vérifier que les étapes en question sont bien successives et non pas juxtaposées. Noter de manière très lisible quel est leur lien logique : déduction, apparition d'un élément nouveau (or), qui va lui-même interagir sur ce qui précède et le modifier (donc)… Ne rédiger intégralement que l'introduction et la conclusion. La formulation fine et aboutie du raisonnement qui introduit une étape sera à réaliser directement sur la copie ; ainsi que l'explicitation de l'illustration de culture générale, mythologique ou littéraire, historique, philosophique, sociologique… Problématiser une dissertation de culture générale Principe Il est important de se représenter la dissertation comme une démarche cohérente, d'un seul tenant, et d'éviter le malentendu d'une construction qui serait constituée d'une suite de formalités. Il m'arrive de renvoyer mes étudiants à la métaphore qui est celle que Platon, dans le Parménide, met dans la bouche de Parménide lui-même : disserter relève de " la traversée à la nage d'un vaste océan de discours ". Savoir disserter est un peu et même beaucoup comme savoir nager : une fois qu'on a compris qu'on pouvait prendre appui sur l'eau elle-même pour mieux l'axronter, on est assuré de trouver en elle des ressources, de bien s'y poser, éventuellement de s'y reposer pour mieux rebondir… Expression également souvent utilisée dans les rapports de concours, " se battre avec le sujet ". Non pas se débattre, mais combattre, se mesurer à ce de quoi il faut d'abord saisir la configuration, la complexion. Dans la dissertation de culture générale, donc, les opérations s'appellent l'une l'autre. La première et la plus fondamentale consiste à se donner un objectif. En quoi cet énoncé, cette forme syntaxique dont je vois bien qu'elle est en rapport avec le thème de l'année, est-il porteur d'une anomalie, d'une incertitude, d'une ambiguïté, de façon telle que mon intervention soit requise pour la travailler ? Autant d'indices contenus dans le sujet qu'une lecture un peu attentive va débusquer afin de diligenter une investigation réfléchie. Qu'il s'agisse d'une notion (" L'authenticité "), d'un couple de notion (" Vérité et sincérité "), d'un adjectif substantivé (" L'invraisemblable "), d'un nom suivi d'un adjectif qualificatif (" La parole vraie "), d'un verbe (" Vérifier "), d'une triade (" Doute, certitude et vérité "), d'une alternative (" Vérité ou évidence ? "), d'une question qui reste arbitraire tant qu'elle n'est pas problématisée (" Comment discerner le vrai ? "), il importera de relever teneur apparente, teneur sous-jacente, statut temporel, spatial, sujet supposé, registre, contraposée… Chaque sujet de dissertation est absolument spécifique et la " chair de l'énoncé " impose une stratégie de lecture plastique, constamment prête à se reconfigurer. Un peu comme les veines du marbre s'imposent successivement à qui tente d'y faire surgir une figure. L'introduction consiste à montrer à l'examinateur pourquoi il y a du sens à établir les limites d'une première interprétation, et à se laisser guider par les indices qui apparaissent. Le terme de problématisation rend assez justement compte de cette première démarche. Montrons que la teneur de ce mot n'est pas intimidante ni exrayante. Le terme problème veut dire, pour une dissertation de culture générale comme un devoir de mathématiques, obstacle. Il vient du grec pro, " devant " et blêma de ballà, " jeter ", soit " ce qui est jeté devant ". Relever dans le sujet une dixiculté, un obstacle, quelque chose qui nous arrête et nous empêche d'avancer, revient à avoir la garantie de réfléchir avec une réelle envie de comprendre, moteur décisif. La dissertation se trouve alors exectivement enclenchée, et ce qui apparaît progressivement est suxisamment ordonné pour avoir en lui-même une logique qui dispense de tout agencement factice. Certes, restera toujours la question de la conclusion, qui ne pourra jamais prétendre être une solution intégrale, puisque à mesure que les propositions se font plus précises, elles sont amenées à rencontrer d'autres apories et scories. Dans la dissertation de culture générale, s'arrêter a toujours une part d'inaccompli, comme le disait déjà Aristote : " Il est nécessaire, toutefois, de s'arrêter. " La construction s'interrompt en exet, et il convient de négocier comment le faire de la façon la plus lucide et élégante, avant même que toutes les dixicultés se soient trouvées dépassées. Le schéma le plus simple est donc celui d'une hypothèse initiale qui, rencontrant des limites, donne lieu à une première reformulation, qui elle-même, pour la même raison, donne lieu à une nouvelle et dernière reconfiguration. Mais, pour le dire à nouveau, l'essentiel est que la proposition soit animée du dedans par une continuité démonstrative, comme la traversée du nageur, qui prend appui sur ce de quoi il faut parler autrement et mieux. Le moment moteur est celui de la lecture du sujet. C'est pourquoi nous allons maintenant montrer comment, à partir d'un sujet sur la vérité, bien s'approprier la teneur d'un libellé revient à se donner des atouts pour avancer et relancer à chaque fois l'exigence de construction. L'introduction qui, comme son nom l'indique, a pour fonction de conduire le candidat et son lecteur " à l'intérieur " du sujet, si elle est correctement construite, contient déjà en elle-même les matériaux pour les étapes suivantes. Application du principe à un sujet : " Être dans le vrai. " Constitution d'un brouillon, crayon en main L'introduction est une problématisation Supposons donc que l'expression " Être dans le vrai " soit proposée au concours. Une lecture globale devra alors être pratiquée, qui évitera soigneusement de se contenter de constituer, pour chacun des trois termes, un paragraphe disjoint : " être ", " dans ", " le vrai ". Être dans le vrai, après y être parvenu, ou avant d'en sortir ? Quelle teneur du substantif, dire le vrai, pour éviter de dire la vérité comme totalité uploads/Litterature/ exemple-de-traitement-d-x27-un-sujet-au-brouillon-etre-dans-le-vrai-studyrama-grandes-ecoles.pdf
Documents similaires








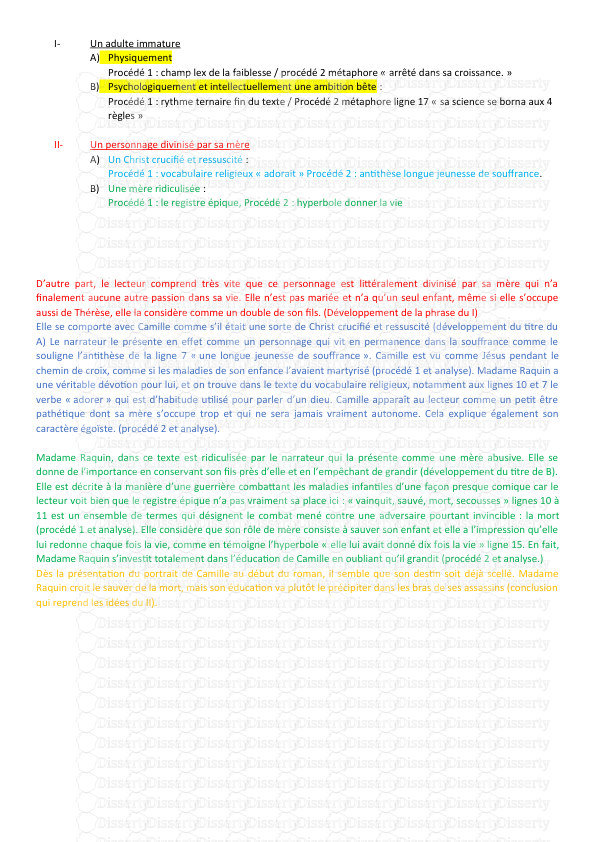

-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 20, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 2.8159MB


