Baudelaire, sociologue de la modernité Author(s): Françoise Coblence Source: L'
Baudelaire, sociologue de la modernité Author(s): Françoise Coblence Source: L'Année Baudelaire , 2003, Vol. 7, Baudelaire, du dandysme à la caricature (2003), pp. 11-36 Published by: Honoré Champion Stable URL: https://www.jstor.org/stable/45073560 JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to L'Année Baudelaire This content downloaded from �������������193.255.241.2 on Fri, 12 Mar 2021 11:30:29 UTC������������� All use subject to https://about.jstor.org/terms Baudelaire, sociologue de la modernité Baudelaire sociologue ? La formulation sonnerait-elle comme un oxy- more sacrilège pour celui qui affirmait : « La poésie ne peut pas sous peine de mort ou de défaillance, s'assimiler à la science ou à la morale ; elle n'a pas la Vérité pour objet, elle n'a qu'Elle-même. Les modes de démonstra- tion de vérité sont autres et sont ailleurs.1 » Certes, la sociologie ne pré- tend pas avoir la Vérité pour objet, mais elle prétend néanmoins à une certaine scientifiche. L'impassibilité de « l'humeur démonstrative », que Baudelaire juge incompatible avec les diamants et les fleurs de la muse, ne peut lui être totalement étrangère. Même s'il arrive à Baudelaire d'être moins virulent dans sa condamnation d'un art « utile », voire de dénon- cer, à propos des chansons de Pierre Dupont, « la puérile utopie de l'art pour l'art », on ne saurait en faire le tenant d'une poésie doctrinaire ou même seulement sociale. Cependant, il y a bien des manières de faire de la sociologie. À la suite des magistrales études de Walter Benjamin, qu'il projetait de réunir sous le titre de « Charles Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capita- lisme » 2, il est devenu assez courant, pour ne pas dire banal, de se mon- 1. Notes nouvelles sur Edgar Poe (1857), OC II, 333. On trouve le même passage repris dans le texte sur Théophile Gautier paru en 1859 avec la variante « déchéance » au lieu de « défaillance », OC II, 113. 2. W. Benjamin, Charles Baudelaire , un poète lynque à l'apogée du capitalisme , tra- duction J. Lacoste, Petite Bibliothèque Payot, 1 982. Dans ce livre sont rassem- blées les principales études de Benjamin sur Baudelaire : Le Paris du second Empire chez Baudelaire (1938), Sur quelques thèmes baudelaińens (1939), Fragments sur Baudelaire (Zentralpark). Il faut ajouter les multiples extraits sur 11 This content downloaded from �������������193.255.241.2 on Fri, 12 Mar 2021 11:30:29 UTC������������� All use subject to https://about.jstor.org/terms FRANÇOISE COBLENCE trer attentif à Tinté ret que Baudelaire a toujours porté au social et au poli- tique. Cet intérêt traverse son œuvre de part en part et, pour reprendre encore une expression de Benjamin, se donne à lire en des « thèmes bau- delairiens », qui sont comme des thèmes ou des motifs musicaux et poé- tiques, mais qui sont aussi autant de traits caractéristiques dépeignant la société de son temps. Ce en quoi Baudelaire fait aussi œuvre de socio- logue, même si tel n'est évidemment pas son objectif premier. Le terme de « sociologie » a été créé en 1839 par Auguste Comte dans le Cours de philosophie positive pour désigner ce qu'il appelle aussi « physique sociale », c'est-à-dire une science qui se donne pour objet l'étude des phénomènes sociaux considérés dans leur spécificité, et en tant qu'ils sont « assujettis à des lois naturelles invariables 3 ». On conçoit d'emblée que le Catéchisme positiviste et la religion du Progrès ne pouvaient qu'être aux antipodes des idées de Baudelaire. Pas davantage ne tro uvera- t-on dans l'œuvre du poète un éclairage sur les faits sociaux considérés « comme des choses », suivant la formule célèbre de Durkheim 4. Dans quelle mesure alors l'œuvre de Baudelaire rencontre- t-elle la sociologie ? Il n'est évidemment pas question d'entrer dans les détails des débats sur la naissance et les fondateurs de la sociologie, la pluralité de ses tradi- tions ou ses méthodes. À la mesure peut-être de la crise de la société, la sociologie est régulièrement « en crise », ces débats sont récurrents et par- tagent son champ en définissant différemment son objet et renouvelant ses objectifs. Les partisans d'une sociologie objective et explicative se sont opposés à ceux d'une sociologie compréhensive et interprétative, sou- cieuse de toujours distinguer les faits et les valeurs (Max Weber) ; on a pu distinguer une sociologie critique et une sociologie fonctionnaliste (A. W. Gouldner), ou une sociologie marxiste et historique, qui dégé- nère en idéologie, et une sociologie américaine empirique (R. Aron). Baudelaire que contiennent les textes rassemblés dans Paris capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, trad. J. Lacoste, Éditions du Cerf, 1 989, et la correspondance avec Horkheimer et Adorno pendant ces années. 3. A. Comte, « Considérations philosophiques sur les sciences et les savants » (1825), Du pouvoir spińtuel, Le Livre de poche, coll. Pluriel, 1978, p. 234. 4. E. Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique (1895), PUF, 1981, p. 15. 12 This content downloaded from �������������193.255.241.2 on Fri, 12 Mar 2021 11:30:29 UTC������������� All use subject to https://about.jstor.org/terms BAUDELAIRE, SOCIOLOGUE DE LA MODERNITÉ Au-delà de ces clivages, je retiendrai ici la définition proposée par Raymond Aron de la sociologie comme « étude qui se veut scientifique du social en tant que tel ». Selon cet auteur, la sociologie au XIXe siècle marque « un moment de la réflexion des hommes sur eux-mêmes, celui où le social en tant que tel est thématisé, avec son caractère équivoque, tantôt relation élémentaire entre les individus, tantôt entité globale » 5. Pour Raymond Aron, l'exposition de la sociologie moderne entendue comme diagnostic du présent aboutit à une galerie de « portraits intellectuels », et il importe peu de savoir si cette galerie est plutôt constituée de philosophes ou de sociologues 6. Parmi les « fondateurs », R. Aron fait émerger des traits dominants : il retient chez Auguste Comte la primauté du fait indus- triel, chez Marx celle du fait capitaliste, et chez Tocqueville celle du fait démocratique. Or on peut souligner que ces trois dimensions de la société du XIXe sont explicitement présentes dans l'œuvre de Baudelaire, même si ce dernier n'en fait pas l'objet d'une étude spécifique ou frontale. Car si on insiste, suivant en cela Claude Lefort, à la fois sur la part de méconnais- sance que comporte toute œuvre prétendue de connaissance, et sur la dimension nécessairement interprétative de la sociologie, on sera tenté de trouver dans les œuvres « qui portent la marque d'interprétations singu- lières » une contribution à la tentative de compréhension de la nature du lien social, et ceci quelle que soit la nature « scientifique » ou non de ces œuvres 7 . En définitive, si c'est bien la réflexion sur ce lien qui est l'objet de la sociologie, l'œuvre de Baudelaire offre un incomparable terrain de questionnement, d'élaboration. Elle est un miroir où émergent aussi bien les dimensions reconnues de la société (pour simplifier : industrielle, capi- taliste, démocratique) que les thèmes qui apparaissent à la fin du siècle chez des écrivains comme Taine ou Zola, Tarde ou Le Bon, et seront ceux d'une génération suivante (et de Simmel tout particulièrement, mais aussi de Caillois, Canetti, Adorno ou même Foucault) : la grande ville, la foule, la mode et, bien entendu, la notion centrale de modernité. Qu'on le comprenne bien : il n'est nullement question de voir en Baudelaire un précurseur de la sociologie du début du XXe siècle. Georges Canguilhem, à la suite d'Alexandre Koyré, a fait de la notion de précur- 5. R. Aron, Les Étapes de la pensée sociologique, Gallimard, 1967, p. 16. 6. Ibid., p. 17. 7. C. Lefort, article « Sociologie », Encyclopaedia Universalis. 13 This content downloaded from �������������193.255.241.2 on Fri, 12 Mar 2021 11:30:29 UTC������������� All use subject to https://about.jstor.org/terms FRANÇOISE COBLENCE seur, et du « virus du précurseur », une critique que Ton peut dire déci- sive. Il a montré combien cette notion était aberrante tant sur le plan his- torique qu'épistémologique puisqu'elle extrait les concepts de leur contexte et les penseurs de leur environnement culturel 8. Il ne s'agit pas de réduire pour autant l'œuvre de Baudelaire à ce que Roger Caillois nomme « une sorte de sociologie littéraire », dans laquelle le lecteur appré- hende les démarches sociales de l'imagination 9, mais où la force inter- prétative de la dimension poétique elle-même n'est pas prise en compte. Mais on peut reconnaître au poète une position privilégiée dans l'appré- hension de ce qui l'entoure et, singulièrement, des mutations encore peu perceptibles qui sont en train de se produire. Comme l'écrit Jean Starobinski : « La parole poétique se situe dans l'intervalle qui sépare le savant et cette uploads/Litterature/ baudelaire-sociologue-de-la-modernite.pdf
Documents similaires


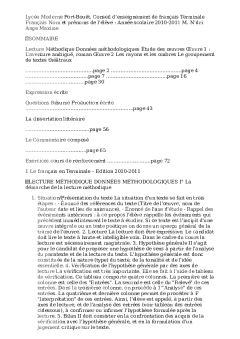







-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 07, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6996MB


