in Colletta J.-M. & A. Tcherkassof (éds) (2003), Les émotions. Cognition, langa
in Colletta J.-M. & A. Tcherkassof (éds) (2003), Les émotions. Cognition, langage et développement, Hayen, Mardaga, 137-152 ; Prépublication : Colletta J.-M. & A. Tcherkassof (éds) (2001), Emotions, interactions, développement, Actes du Colloque international Grenoble juin 2001, LPS, Université Pierre Mendès France, Grenoble II, & LIDILEM, Université Stendhal, Grenoble III, 11-25. Compétence discursive et co-occurrence d’affects: “ blends expérientiels ” ou (con)fusion d’émotions?1 Antoine Auchlin Département de linguistique Université de Genève A la mémoire de la Professeure B. Schlieben-Lange 0. Avant-propos Dans l’interaction verbale se déploient en nous des affects complexes, issus de sources aussi diverses et hétérogènes que la situation et l'environnement, les objets représentés, les actes et jugements présentés ou accomplis verbalement, l'interaction, le ou les autres partenaires (Traverso 2000, Chabrol 2000, Caffi 2000, Maury-Rouan 2000, notamment). La parole à la fois subit cette irrigation affective (Scherer et les traces vocales des états émotionnels et motivationnels), mais aussi la régule (Cosnier 1986; travaux sur la ré-évocation, etc.) ; ce faisant, enfin, la parole alimente le vécu affectif, de trois façons différentes: par son contenu, tout d’abord ; par l'appréciation qualitative qui la guide, évalue et 1 Merci à A. C. Simon pour ses commentaires. - 2 - Colletta & Tcherkassov (éds) (2003) Les émotions. Cognition, langage et développement, Hayen, Mardaga, 137-152 sanctionne sa réussite ou son échec en termes de plaisir/déplaisir (Cosnier 1994, 1996 ; Auchlin 1993, 1997; Gardin 1993; Parret 1993) ; et par le mélange qui résulte de cet apport hédonique aux autres composantes - voir, dans la déclaration d’amour, la combinaison de l’amour, du désir de le déclarer, et de la peur qui s’y oppose (Auchlin1998b); l’apport hédonique peut envahir tout le volume expérientiel disponible : angoisse de la page blanche (Yessouroun 1996; Martins 1993; Madigan, Linton & Johnson 1996), stress de la parole publique, ou… bonheur conversationnel (Auchlin 1995). Le discours est pour moi une donnée d'expérienciation subjective particulière dans laquelle se mêlent et à laquelle contribuent données perceptives immédiates et représentations complexes associées aux suites d'unités linguistiques; ce que nous nommons "discours", c'est du vécu. A ce titre, son étude ne se réduit légitimement ni à des manipulations cognitives conceptuelles- inférentielles, ni à des séquences d'unités linguistiques, fussent- elles complexes et organisées2. Analyser ou décrire du discours, c'est tenter de rendre compte de ce donné: non pas sans doute de l'infinie diversité des vécus langagiers singuliers, faits "de parole" dirait Saussure, mais des dispositions générales hypothétiquement responsables de cette expérienciation3. L'analyse expérientielle du discours suppose ainsi un dispositif, "organe" ou "système", ayant à charge d'élaborer en expérienciation le traitement séquentiel d'unités linguistiques, et inversement d'articuler l'expérience interne en séquences d'unités linguistiques; c’est cet "organe de l'expérienciation discursive" que je nomme "compétence discursive". 2 Auchlin 1998 développe ces critiques à l'encontre respectivement du "réductionnisme cognitiviste", et de l'"immanentisme", qui assimile plus ou moins expressément le "discours" au produit "stabilisé", "inerte", que sont les séquences d'unités linguistiques. 3 Comme, par exemple, sa contiguïté avec l'expérience musicale (Auchlin 2000a). A. Auchlin, « Compétence discursive et co-occurrence d’affects » - 3 - Je renvoie à mes travaux récents pour une présentation générale de l'approche "systémique" de la compétence discursive et de la pragmatique expérientielle4. Pour illustrer la manière dont cette pragmatique articule "émotions, interaction, et développement" au discours, je voudrais me pencher ici sur un petit objet encore bien incertain, que je nommerais volontiers le "mixage ou blend expérientiel". 1. Du « mixage(blend) expérientiel » Les quelques cas de figure discutés ci-dessous ont comme point commun de réaliser un mélange, particulier, de données conceptuelles-représentationnelles, issues du contenu des unités linguistiques (du traitement interprétatif), et de données de nature perceptive liées au traitement de la chaîne parlée ; le mélange qui en résulte, intégrant percepts et constructions conceptuelles, consiste à son tour en une donnée expérientielle. (1) "Marguerite Duras n'a pas écrit que de la merde. Elle en a aussi filmé." (P. Desproges) L'estime préalable que l'on voue ou non à Marguerite Duras joue sans doute un rôle important dans l'appréhension de cette boutade; celle que l'on peut vouer à P. Desproges aussi. Mais en deçà du résultat final, que l'on rie ou pas, le dispositif humoristique de Desproges mérite quelque attention. Si l'on nomme {S1, t1} et {S2, t2} les deux couples 'segments (phrases)' et leur 'moment d'occurrence', l'humour consiste à un premier niveau dans le fait que {S2, t2} entraîne une ré- interprétation de S1: en effet {S1, t1} communique une intention charitable à l'endroit de M. Duras, bien qu'énoncée d'un point de vue qui ne l'est pas : "ne pas écrire que de la m." présuppose en effet "en écrire" ce qui, en soi, est une insulte; cette insulte demeure 4 Voir Lakoff & Johnson 1985 pour la notion d'expérientialisme au plan épistémologique. Prolongements chez Núñez 1997, 1999, entre autres. - 4 - Colletta & Tcherkassov (éds) (2003) Les émotions. Cognition, langage et développement, Hayen, Mardaga, 137-152 cependant "potentielle", elle n'est pas accomplie comme telle: d'une part elle n'est pas posée mais présupposée, et d'autre part elle est présupposée par un énoncé qui fait attendre un enchaînement non dépréciatif. A {S1, t1} on attribue à l'auteur l'intention de nous faire part d'une appréciation favorable à MD. A {S2, t2} et à sa faveur, cette interprétation est "invalidée" par une interprétation concurrente, qui lui est diamétralement opposée, notamment en ce qui concerne les bonnes dispositions de Desproges vis-à-vis de MD. Il faut noter que ce dispositif est strictement "occurrenciel" : il requiert la mise en place de deux "temps" successifs distincts, associés respectivement au traitement de S1 puis de S2. Le point typographique marque une séparation entre occurrences, par laquelle S1 subit une compactification cognitive, qui le fait passer du statut d'énoncé en cours d'interprétation, "dilaté", quand on le lit et qu’on élabore cette charité attribuée à Desproges, à son statut d'entité "ponctualisée" (Ferrari & Auchlin 1995); sans cette ponctualisation de S1, le witz est beaucoup moins net - si, par exemple, on remplace le point par une virgule, ou par deux points, qui indiquent un mouvement périodique unique5: (1') Marguerite Duras n'a pas écrit que de la merde, elle en a aussi filmé. (1'') Marguerite Duras n'a pas écrit que de la merde: elle en a aussi filmé. A t1, S1 reçoit l'interprétation charitable{I}; à t2, S1 est ré-interprété {I'}, méprisant. Dans ses aspects généraux, le phénomène, loin d'être unique, se décrit formellement en termes de variation (Reboul 1991); dans ses ressorts psychiques, on peut le saisir à 5 Et donc une incrémentation transitoire de la mémoire discursive, pour emprunter les termes de Berrendonner 1993, là où le point typographique incrémenterait comme "état-but" l'état de la mémoire discursive obtenu par S1; un état-but est un état qui se représente lui-même comme état-but. Mouvement périodique est entendu ici au sens de Grobet 1997, Roulet 1999. A. Auchlin, « Compétence discursive et co-occurrence d’affects » - 5 - l'aide de la théorie des censeurs mentaux (Freud) revue par Minsky (1984): on rit (ou l'on est fâché) à {S2, t2} parce qu'on réalise que les censeurs mentaux supposés refouler les pensées peu avouables ont laissé entrer S1dans notre esprit, cheval de Troie qui s'avère après coup d'une nature opposée{I'}à celle {I} sous laquelle il a été admis, et ratifié par sa ponctualisation même. Les censeurs mentaux se sont laissés prendre, et le rire est avant tout la réaction de surprise à cette découverte. Si ce croquis explique partiellement le fait qu'on rie ou qu'on soit fâché, il y manque une chose importante : par sa forme, S1 ne permet pas de construire l'interprétation {I'} qui lui est pourtant attribuée de force à t2 ; en effet: (2) Ne pas Vx que Nx (il n’a pas mangé que des pâtes) ne peut pas recevoir d'enchaînement de type (3) aussi Vy Nx (*il a aussi préparé des pâtes) mais seulement de type (4) aussi Vx Ny (il a aussi mangé des légumes) Dans cette structure qui induit une attente par ne pasVx que Nx c'est Nx qui est focalisé et désigné comme terme à remplacer, non pas Vx. Pour installer {I’} à t2, Desproges force donc une structure linguistique à signifier quelque chose qu'elle ne peut, conventionnellement, pas signifier. Ou plutôt qu'elle peut signifier, puisque cette deuxième interprétation est bel et bien installée, mais moyennant un certain sentiment linguistique d'anomalie renvoyé par la perception syntaxique (Milner 19896; Marandin 1994). 6 Notamment pp. 660 sq. Précisons que si le syntacticien recourt en permanence à ce type de donné, en explorant les frontières du « possible de langue », il n’a, par sa position, pas à en rendre compte. Toute autre est la posture de l’analyste de discours… - 6 - Colletta & Tcherkassov (éds) (2003) Les émotions. Cognition, langage et développement, Hayen, Mardaga, 137-152 Ce percept, cette intuition de malformation grammaticale associée à {S1-t2}, alimente directement la jouissance du dispositif: comme percept, il constitue une donnée quasi-sensorielle immédiate, qui garantit l'ancrage expérientiel du traitement: ça a bien lieu, puisque je le sens. Mais en outre, dans ce contexte, ce percept est uploads/Litterature/ auchlin-2001-competence-discursive-et-cooccurrence-d-x27-affects-blends-experientiels-x27-ou-con-fusion-d-x27-emotions.pdf
Documents similaires



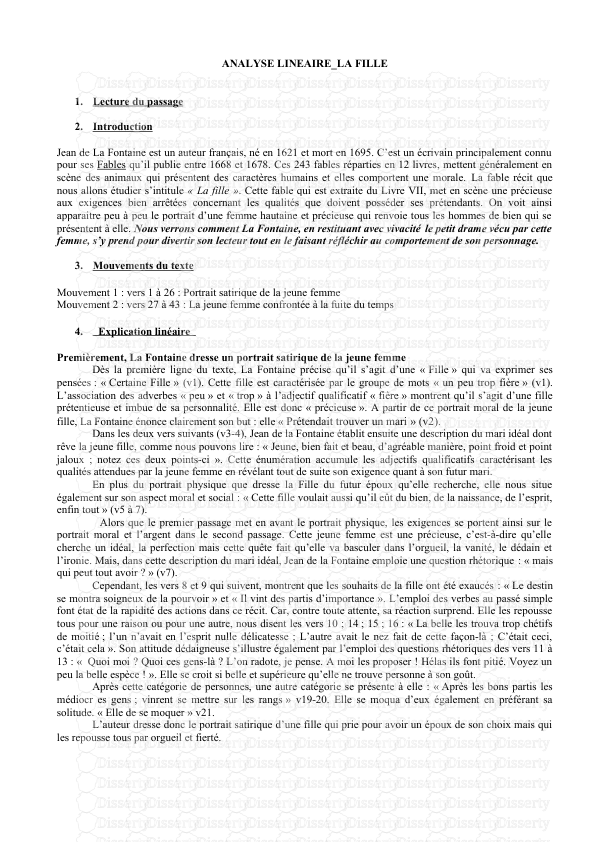






-
84
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 22, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4540MB


