Cet article est disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info/article
Cet article est disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=LHOM&ID_NUMPUBLIE=LHOM_187&ID_ARTICLE=LHOM_187_0007 Métamorphoses et anamorphoses des “miroirs transatlantiques” par Jackie ASSAYAG | Éditions de l’EHESS | L’Homme 2008/3-4 - n° 187-188 ISSN 0439-4216 | ISBN 9782713221866 | pages 7 à 32 Pour citer cet article : — Assayag J., Métamorphoses et anamorphoses des “miroirs transatlantiques”, L’Homme 2008/3-4, n° 187-188, p. 7- 32. Distribution électronique Cairn pour les Éditions de l’EHESS. © Éditions de l’EHESS. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. ON SAIT QUE Jorge Luis Borges a transposé sur le plan littéraire les principes d’équivalence cardinale de l’aleph zéro, ainsi baptisé par le génial mathématicien Georg Cantor. Une des nouvelles de l’Œdipe argentin, intitulée « Le Congrès », y déploie une nouvelle fois cette veine allusive et fantastique, courte et sobre, qui signe son génie aussi insolite qu’abrupt. Irrigué par une monadologie facétieuse, ce récit s’encastre dans un volume significativement titré : Le Livre de sable 1. En voici un bref résumé. Un homme qui avait échoué à se faire élire député dans son pays conçoit le projet de créer un « Congrès du Monde ». Celui-ci représenterait tous les hommes de toutes les nations. Mais, progressivement, le nombre d’éléments qui peut représenter l’infini du monde se ramifie de façon alarmante. Inversement, le nombre d’attributions représentatives de chaque membre du groupe ne cesse de se réduire. Des hommes, on passe donc aux livres et, des livres, aux langages. On cherche alors la langue universelle, la bibliothèque capable de représenter toutes les écritures. Mais la tâche semble vaine. Quatre ans après la conception de ce projet, Don Alejandro, le vieux vision- naire, décide de brûler tous les livres. Il vend ses propriétés, et abandonne l’en- treprise du Congrès. Cet échec apparent est pourtant vécu par les protagonistes comme un succès ! Le Congrès du Monde, constate-t-il, existe bel et bien. Seulement il est composé de chaque individu, de chaque parcelle de réalité, de chaque événement. De fait, il n’est pas de représentation du monde qui n’ait besoin de chaque atome de ce monde, mais en même temps, chaque atome est une forme particulière de représenter la totalité. Conforme à l’inspiration philosophique de l’écrivain, adepte du baroque laby- rinthique, cette trame narrative semble tisser le rapport du même et de l’autre en soulevant la question de l’un et du multiple. L’apologue met ainsi à l’épreuve la condition de la représentation et la nature de la totalité, en relation à l’idée d’infini. INTRODUCTION L’ H O M M E , Miroirs transatlantiques, 187-188 / 2008, pp. 7 à 32 Métamorphoses et anamorphoses des “miroirs transatlantiques” Jackie Assayag L’histoire des idées est une histoire des malentendus. Siegfried Kracauer, L’Histoire des avant-dernières choses. 1. « Le Congrès du Monde », in Le Livre de sable. Paris, Gallimard, 1978 (« Folio »). Si l’entreprise du « Congrès du Monde » a échoué et réussi à la fois, c’est parce que la représentation totale est impossible, du moins par les procédés mécaniques de l’addition ou de l’accumulation. En même temps, tout reste infiniment possible. Le « Congrès du Monde » raconte, en effet, l’évasion de son propre récit dans toutes les directions de la planète. Dès lors, la production des récits et des savoirs, la circulation profuse des idées et des œuvres, ainsi que leurs traductions aussi bien au Nord qu’au Sud, contribuent à l’édification d’une Babel nouvelle, plus dispa- rate, davantage bigarrée, plus ou moins métissée, variablement acculturée, et simultanément régionalisée ou globalisée. Désormais, toutes les humanités peu- vent (en droit) participer à la production de la connaissance et à la diffusion des idées dans les cinq parties du monde. Chacun, selon sa situation et sa puissance d’agir, peut, s’il le veut et s’il le peut, enrichir la Babel devenue enfin mondiale. En ce sens la Terre est vraiment devenue ronde, en termes de savoirs, d’actes de pensées et quel que soit le type de discursivité. Aujourd’hui la bibliothèque de Babel n’est donc plus un jardin protégé : ses frontières se sont ouvertes ou tendent même à disparaître. Ce Fort Knox du savoir a cessé d’être destiné aux seuls représentants du monde occidental, dits « civilisés ». La Bibliothèque du Congrès, en tant que clé de voûte d’une politique du savoir exclusivement occidental, n’est plus réservée aux détenteurs de l’uni- versalisme abstrait. Car cet universalisme fut trop souvent assimilé à une pro- priété particulière de la culture dominante, sous couvert d’une rhétorique du pouvoir qui sert à légitimer toutes sortes de politiques de type impérialiste 2. « Il est parfois nécessaire », comme l’écrit Marshall Sahlins (1993), « de se rappeler que notre discours à prétention rationaliste est prononcé dans un dialecte cultu- rel particulier ». L’intérêt de l’anthropologie de l’« ailleurs » est de nous apprendre à voir le monde depuis la périphérie. Du même coup, l’universel se découvre intrinsèquement polémique : il y a des universels concurrents et irréductibles (Assayag 2007a : 251-257). Mais un tel constat n’empêche pas les relations entre les États-Unis et l’Europe. Comme en atteste Carlo Ginzburg lorsqu’il raconte sa découverte de l’Amérique universitaire (en 1973) à travers son « œil de l’étran- ger », c’est-à-dire en exprimant les prémisses de sa méthode historiographique qui vise à « défamiliariser » et à ne vouloir connaître que le « singulier ». Cette relation aux États-Unis est par ailleurs ancienne en anthropologie, comme l’illustre la rencontre « transatlantique » entre Paul Rivet et Franz Boas qui « firent cause commune » de 1919 à 1942 pour lutter contre la guerre et le racisme à travers une longue amitié politique et scientifique, étudiée ici par Christine Laurière. Certes, la puissance paneuropéenne continue de s’adosser à une « économie- monde » dominante. Mais une majorité d’observateurs considère qu’elle s’affai- blit et traverse du même coup une crise d’hégémonie sans précédent. Au point 8 Jackie Assayag 2. Immanuel Wallerstein (2006) expose clairement l’argumentaire classique selon lequel le concept d’« universalisme européen » servit à justifier tous les colonialismes, y compris sous la forme dudit « droit d’ingérence ». que, pour beaucoup, les « Barbares » frappent déjà à la porte… Mais qui pourrait nier que, depuis quatre décennies, le fond de l’air intellectuel et des idées s’est partiellement modifié pas seulement sous les effets de ladite globalisation. La politique des lieux du savoir et la géopolitique de la cognition ont changé le sens de la vocation et du métier jusqu’à transformer l’idée de reconnaissance interna- tionale. C’est d’ailleurs en pariant sur ce changement de climat qu’une partie du personnel lettré s’est renouvelée, que les disciplines furent réarticulées et que le « Canon » se diversifie et se complexifie. Entre-temps, de nouveaux entrants, intellectuels, universitaires ou artistes bigarrés, parfois autoproclamés « diaspo- riques » ou issus des anciens « Tiers-Mondes », s’installent douillettement en chaires et dans les départements universitaires aux côtés de collègues moins mili- tants, mais nonobstant fort savants et réticents à collaborer la plupart du temps. Vous avez dit “miroirs transatlantiques” ? Ce florilège d’articles, intitulé les « miroirs transatlantiques », analyse et met en scène quelques-unes des transformations intellectuelles, cognitives et théoriques dans le champ de la recherche en sciences sociales. L’objectif est de penser à nou- veaux frais quelques « cas de figure » transfrontières, certains relativement anciens mais d’autres plus récents. L’usure des grands paradigmes impose l’association de l’étude des particularités circonstanciées aux changements de contextes sur les- quels doit statuer la « pensée par cas » ; constatons que cette méthodologie a étendu ses effets dans l’ensemble des sciences sociales (Passeron & Revel 2005). En la circonstance des « miroirs transatlantiques », tous les topoï rassemblés dans ce volume sont dotés d’une singulière puissance d’expression en remplissant les exigences d’une fonction d’universalisation. Soucieux de traquer les perspectives neuves, cet assemblage d’études s’ouvre à la pluralité des mondes et des disci- plines, mais sans ambition systématique ni intention exhaustive ; aucune enquête ne vise la clôture. L’essentiel est de garder l’esprit en éveil face aux comparaisons que l’on considère comme suggestives, constructives, heuristiques et parfois même dissonantes – et c’est tant mieux 3. L’exploration privilégie les compa- rables qui s’ouvrent au grand large, telle une invitation au voyage ! Que place soit donnée aux transfuges et aux transferts (intra- ou interculturels 4). « Mieux qu’Athènes, le pont d’un bateau en route vers les Amériques offre à l’homme moderne une acropole pour sa prière. Nous te la refuserons désormais, anémique déesse, institutrice d’une civilisation claquemurée ! […] Hurons, Iroquois, Caraïbes, Tupi me voici uploads/Litterature/ assayag-el-congreso.pdf
Documents similaires








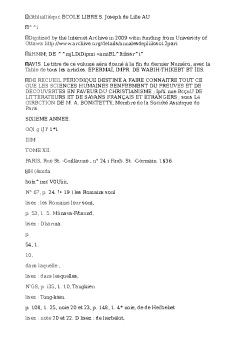

-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 16, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3146MB


