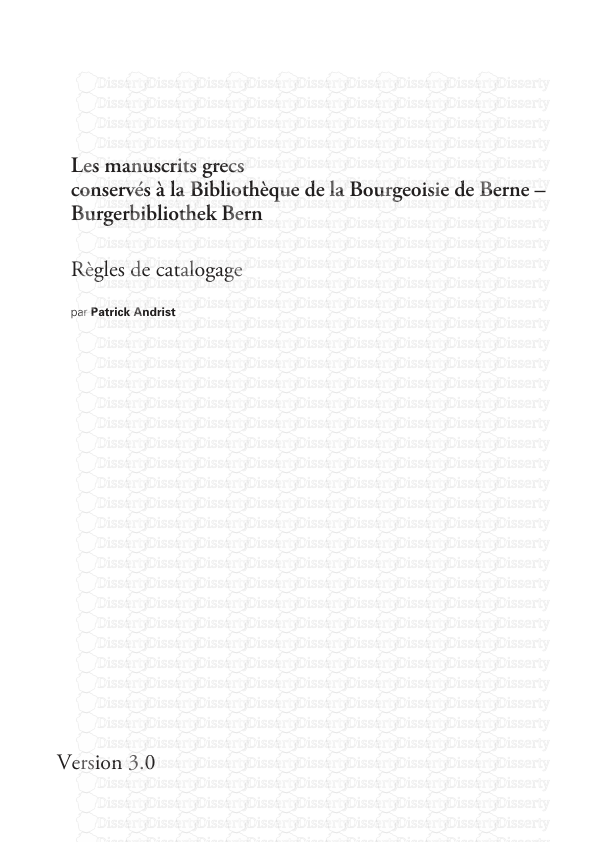Version 3.0 Les manuscrits grecs conservés à la Bibliothèque de la Bourgeoisie
Version 3.0 Les manuscrits grecs conservés à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne – Burgerbibliothek Bern Règles de catalogage par Patrick Andrist Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne Münstergasse 63 Postfach CH-3000 Bern 8 Tel. (++41) 031-320 33 33 Fax (++41) 031-320 33 70 www.burgerbib.ch Pour tout contact, patrick.andrist@burgerbib.ch ISBN 3-9521914-1-8 Dernière version disponible sur le site : www.codices.ch Version 1 Non publiée Version 2 Parue sous le titre, Catalogus co dicum graecorum Helveticorum : Règles de catalogage élaborées sous le patronage du Kuratorium « Katalogisierung der mittel alterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz » : version 2.0 - Mars 2003 Table des matières Avant propos (2007) 5 Avant propos (2003) 6 I. Introduction 7 A. Césures, Blocs et Unités codicologiques 8 B. Notes, Pièces ajoutées et Éléments adventices 9 C. Production des UC et histoire du manuscrit 10 D. Organisation des notices 11 E. Présentation squelettique d’une notice 11 II. Règles pratiques de catalogage 12 F. Généralités 12 1. Règles globales 12 2. Position dans les marges 15 3. Règles pour les libellés et les lignes associées 17 G. Première section : présentation générale du manuscrit 17 4. En-tête de la notice 17 5. Chapeau (schéma de composition) 18 H. Description des UC (début de la deuxième section) 21 6. En-tête de l’UC 21 7. Contenu 21 8. Organisation du contenu 23 9. Matière 24 10. Organisation des cahiers et des pages 27 11. Écriture et ornementation 31 12. (Peintures) 32 I. Éléments adventices 32 K. Notes 33 13. Notes relatives au texte 33 14. Autres notes 33 L. Reliure 33 M. Histoire 35 N. Bibliographie 35 O. Abréviations 37 Appendice : Règles typographiques 39 Index 41 4 5 1 P. Andrist, Catalogus codicum graeco rum Helveticorum. Règles de catalogage, élaborées sous le patronage du Kuratorium « Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz », version 2.0, Bern, 2003 (ci-des sous « Règles 2003 ») ; également disponi bles à l’adresse http://www.codices.ch. Compte rendu par P. Augustin, dans Scriptorium 58, 2004, p. 122-127. 2 ��� P. Andrist, La descrizione scientifica dei manoscritti complessi: fra teoria e pratica, Segno e testo 4, 2006, p. 299-356, + 8 planches (ci-dessous « La descrizione »). 3 J����� J. P. Gumbert, Codicological Units: Towards a Terminology for the Stratigraphy of the Non-Homogeneous Codex, Segno e testo 2, 2004, p. 17-42. Les conséquences de cette publication sur notre travail sont décrites dans La descrizione, p. 321-323. Voir aussi ci- dessous p. 8. 4 ������������������������������������������ Pour d’autres projets basés sur ces mêmes principes, cf. J. P. Gumbert, Inventaire illustré de manuscrits médiévaux, Gazette du livre médiéval (ci-dessous « GLM) 5, 1984, p. 11-15 ; Idem, IIMM. Experimental Precursor 2, Leiden, 1985 ; Idem, IIMM. Introduction. Rules - Instructions, Jerusalem, 1991. Plus récemment, C. Sirat, Cataloguer les manuscrits hébreux du moyen âge, à paraître dans GLM 50, 2007. 5 ����������������������� Voir les exemples dans Règles 2003, p. 47‑69, dans La descrizione, p. 344-354, ainsi que le prochain article sur le Vat. gr. 469, cf. ci-contre. Avant propos (2007) Depuis la publication, en mars 2003, des règles que nous avions l’intention de suivre pour la préparation du catalogue des manuscrits grecs conservés à Berne1, celles-ci ont été modifiées en plusieurs points. Les principales raisons de cette évolution, décrites ailleurs en détail2, sont les suivantes : ⋅ Tout d’abord, en 2003, en faisant connaître notre pratique, notre but était de susciter des réactions et des discussions, dont le catalogue lui-même puisse pro fiter. Cet objectif fut pleinement atteint, puisque nombreuses furent les réactions de ceux qui, par courrier ou de vive voix, nous ont amicalement fait part de leurs remarques et de leurs conseils, et que nous remercions chaleureusement. Parmi celles-ci, mentionnons particulièrement les précieuses observations du regretté Jean Irigoin, de riches discussions avec Paul Canart et Marilena Maniaci, et le compte-rendu de Pierre Augustin dans la revue Scriptorium1, qui ont toujours stimulé notre réflexion et très souvent infléchi notre pratique. ⋅ Ensuite, au cours d’un colloque qui fait date, la définition des unités codico logiques, pierres angulaires et fondement scientifique de nos notices, a été profondément modifiée par leur concepteur, J. P. Gumbert, notamment dans le sens d’une hiérarchisation plus précise d’un plus grand nombre de concepts3. Dans le cadre d’un catalogue « expérimental » tel que le nôtre, il eut été regret table de ne pas utiliser ces nouveaux instruments et, à travers des notices plus structurées, d’en faire profiter les utilisateurs. ⋅ Enfin, la dynamique interne du projet a toujours tendu à une clarification du « langage descriptif » et à l’exploration de nouvelles solutions formelles. C’est ainsi que furent parfois introduites certaines formules, expressions et tournu res non utilisées en 2003. Alors que le catalogue est sur le point d’être achevé, il est nécessaire de mettre ce texte à jour, pour qu’il corresponde aux notices que le lecteur aura sous les yeux. Par rapport à l’édition de 2003, les règles ont été entièrement revues. La plupart des exemples, notamment les exemples finaux, ont été remplacés par de plus nom breux renvois aux notices du catalogue, maintenant disponible. Les règles typogra phiques ont été conceptuellement distinguées des règles de catalogage ; elles sont brièvement esquissées en appendice, sauf pour certains points de détails, qu’il était plus clair de préciser en notes à l’endroit où la règle de catalogage correspondante est présentée. Aujourd’hui comme hier, le principal destinataire de ces instructions est bien l’auteur du catalogue, à qui elles devaient surtout permettre de mieux harmoniser les détails formels des descriptions et, partant, de rédiger des notices plus cohéren tes. Elles se concentrent donc sur les aspects plus novateurs ou plus techniques du catalogue, alors que d’autres, non problématiques, sont traités plus rapidement. Cependant, dans la mesure où elles ont paru pouvoir aider le lecteur à mieux comprendre le catalogue, dans ses principes comme dans ses détails, il a été jugé utile, malgré leurs limites, de les rédiger plus avant et de les rendre publiques. Si ces règles sont bien une tentative de mettre concrètement en œuvre les principes développés par J. P. Gumbert en 2004, elles ne prétendent pas en être la seule interprétation possible, ni la meilleure4. De même, les règles typographiques, qui représentent un niveau de mise en forme plus général et moins directement lié au sens, peuvent être envisagées de multiples façons différentes, comme on s’en rend compte, par exemple, en parcourant nos publications antérieures5. Le lecteur s’apercevra bien vite que les unes comme les autres sont parfois le fruit de compro mis difficiles, peut-être pas encore tout à fait satisfaisants ; qu’il nous en excuse et nous fasse l’amitié de nous communiquer ses remarques. Depuis la préparation du catalogue des manuscrits grecs de Berne, nous avons poursuivi cette recherche, notamment en collaboration avec notre maître Paul Canart. C’est ainsi que nous avons décrit ensemble le Vat. gr. 469 suivant les 6 principes du présent catalogue, améliorés sur quelques aspects, principalement en ce qui concerne les réglures, l’ornementation, l’emplacement dans la notice de la description des notes et des éléments adventices, ainsi que sur quelques détails typographiques6. Ci-dessous, ces innovations sont signalées en notes. Qu’il nous soit enfin permis de remercier chaleureusement Paul Canart et Romain Jurot qui ont eu l’extrême amabilité de relire le présent document et de le discuter avec nous. On ne saurait cependant leur en imputer les trop nombreuses lacunes, dont nous sommes naturellement seul responsable. Patrick Andrist patrick.andrist@burgerbib.ch Avant propos (2003) Les règles contenues dans ce document ont été mises au point grâce aux conseils et aux remarques de MM. Paul Canart, Paul Géhin, Philippe Hoffmann et Jean- Paul Gumbert, que nous remercions vivement. Elles ont été adoptées, pour le Kuratorium « Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz », par MM. André Hurst, Martin Steinmann, Martin Germann, et Patrick Andrist, lors de la séance du 23 août 2001, en tant que tentative d’intégrer, dans les catalogues des manuscrits grecs, les résul tats de la recherche codicologique moderne. Elles ont été, depuis lors, complétées et précisées au fur et à mesure des besoins du catalogue et des remarques des spé cialistes. La version la plus récente peut être téléchargée depuis le site web www. codices.ch. Nous avons le plaisir de remercier également toutes les autres personnes qui ont généreusement partagé leurs connaissances avec nous, en particulier MM. Ernst Gamillscheg et Romain Jurot. Enfin, pour leur confiance et pour leur soutien, notre reconnaissance sincère va également à la Commission de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne, à M. J. Harald Wäber, directeur de la Bibliothèque de la Bourgeoisie, aux collaborateurs et amis de cette institution, à la société OSEA Services et au bureau d’ingénieurs Michel Buffo. Vos commentaires et remarques sont les bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante [patrick.andrist@burgerbib.ch]. 6 Article à paraître. Pour les innovations, cf. ci-dessous n. 20, 45, 50-52, 55. 7 I. Introduction Pour paraphraser J.-P. Gumbert7, le codex médiéval ou renaissant est comme un manoir dans lequel vivent en seigneurs les textes et les enluminures. Leurs hôtes habituels, uploads/Litterature/ andrist-les-manuscrits-grecs-conserves-a-la-bibliotheque-de-la-bourgeoisie-de-berne.pdf
Documents similaires










-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 27, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.1156MB